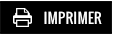Marché et démocratie, démocratie ou marché ? - Manuel Bridier
Publié par , le 13 mars 2007.
Que l’économie capitaliste de marché soit aujourd’hui la forme dominante, hégémonique, des rapports de production et d’échange dans le monde entier, c’est tout simplement l’évidence. Nous le savons tous. Nous le subissons chaque jour. Et ce n’est pas une nouveauté. Cette victoire par défaut, le capitalisme l’avait déjà remportée depuis longtemps, quand le mur de Berlin est tombé. Les tentatives de « planification centrale » avaient échoué bien avant. Ce que les évènements des dernières années ont balayé par la suite n’était déjà plus que débris d’un grand rêve. Mais les contradictions du capitalisme lui-même n’ont pas disparu pour autant. En quoi l’échec retentissant du « socialisme réel », l’effondrement des systèmes politiques et des économies qui s’en réclamaient apporteraient-ils la preuve par l’absurde que les mécanismes du marché, tels que l’histoire les a faits, sont eux-mêmes les plus efficaces et les plus rationnels possibles ?
Pour les partis et pour les Etats qui se disent socialistes - quelle que fût par ailleurs leur réalité sociale - les résultats catastrophiques accumulés, les crimes commis étaient la négation de leurs principes, la réfutation de leur discours officiel et des espoirs qu’il avait soulevés. C’est à la lumière de ces espoirs que nous pouvions les juger. Et cela non plus ne date pas d’hier.
Le marché comme volonté et comme représentation
Il n’en va pas de même pour l’économie capitaliste de marché. Les misères et les dysfonctionnements qu’elle engendre ne sont pas en contradiction avec ses principes, ils ne trahissent pas des promesses faites. Ils sont au contraire la conséquence logique de ses lois. Ils sont présentés comme inéluctables, au même titre que les variations de la météo ou les grands cataclysmes naturels. Le glorification du marché, aujourd’hui religion d’Etat, ne s’accompagne le plus souvent d’aucune promesse abusive, d’aucune anticipation hasardeuse. Ses porte-parole n’en ont pas besoin puisque leurs idées ne se présentent pas comme une doctrine, comme une opinion parmi d’autres, mais au contraire comme une simple constatation des réalités objectives (« La dure leçon des faits »).
Sous le masque rassurant d’un pragmatisme de bon sens, le discours économique officiel de notre XXeme siècle finissant (celui des institutions internationales, de l’ajustement structurel ») ne véhicule pas seulement ainsi une idéologie qui n’ose pas dire son nom. Il proclame la mort de toute idéologie pour mieux imposer, au nom de la Réalité, une idéologie totalitaire (moins l’illusion et l’espoir) fondée sur la sacralisation et la justification pure et simple des « choses comme elles sont ». Les mécanismes du marché n’y sont plus présentés comme un produit de l’histoire - ou bien alors comme son produit final : la forme suprême, définitive, intemporelle de la rationalité économique. Mais il ne suffit pas, pour que cette idéologie fonctionne en tant que telle, que ces mécanismes régissent en fait l’économie mondiale. Il faut encore qu’ils soient reconnus comme un système universel, dans le temps comme dans l’espace, et que tout autre point de vue soit éliminé, sur le plan des idées comme dans la réalité elle-même (privatisations généralisées, démantèlement des services publics, remise en cause des acquis sociaux, effets dévastateurs de la concurrence incontrôlée, aussi bien dans chaque pays qu’à l’échelle internationale).
Cette bataille pour l’élimination de tout obstacle à l’hégémonie du marché, pour sa généralisation à tous les domaines d’activité comme à toutes les régions du monde, revêt aujourd’hui la forme d’une véritable croisade. Elle n’est pas limitée au seul plan des institutions et des réglementations économiques (les programmes d’ajustement structurel ou les négociations du G.A.T.T. par exemple), elle s’étend au contraire de plus en plus - et d’autant plus facilement que la résistance y est la plus faible - sur le plan idéologique.
Mais il s’agit là d’une croisade bien particulière, d’une croisade négative en quelque sorte. Elle a moins pour objet de mettre en valeur les aspects positifs du système capitaliste que de le justifier par son existence même, en affirmant l’impossibilité (la « non-faisabilité ») de tout autre système et plus généralement de toute transformation des structures sociales par l’action volontaire des hommes.
Les conclusions tirées de la faillite du stalinisme et des sociétés post-stalinennes ainsi que des difficultés rencontrées par les expériences de la social -démocratie, sont à cet égard exemplaires. Il s’agit moins d’analyser les conditions et les causes historiques de ces échecs, que d’en tirer un enseignement général, valable à tout jamais, quant à l’impossibilité absolue, on pourrait dire l’impossibilité « physique », d’une alternative économique, au nom des lois objectives, des lois naturelles de l’économie, assimilées pour la circonstance (dans une logique bien peu moderne à vrai dire) aux lois de la physique ou de la chimie. On comprend alors l’acharnement de certains à détruire toute réminiscence des « idéaux dépassés », toute illusion quant à la recherche d’une autre voie. Le premier ministre tchèque, par exemple, émule du chancelier Kohl et de l’école monétariste de Chicago, a prononcé récemment un jugement très dur sur le « printemps de Prague », à l’occasion de son anniversaire. Il ne s’agissait naturellement pas pour lui d’en critiquer les faiblesses, encore moins de s’interroger (comme nous l’avions fait en son temps) sur les réformes économiques proposées alors par Ota Sick, ministre de l’économie du gouvernement Dubcek, et sur les risques possibles. L’objectif de cette nouvelle offensive était plus simplement de « mettre tout le monde dans le même sac » et d’affirmer une fois de plus l’existence d’une voie unique, seule raisonnable, seule compatible avec le monde extérieur.
Les classes dirigeantes de nos sociétés, les institutions qu’elles contrôlent, les moyens d’information et de formation dont elles disposent n’agissent pas autrement en cela, que tous leurs prédécesseurs à travers l’histoire. Faire accepter par les dominés, les opprimés, les exploités (tout cela, je sais, n’est pas la même chose mais ce sont des rôles souvent tenus par les mêmes) - leur faire accepter la nécessité, rationalité, légitimité (ce n’est pas non plus la même chose, mais enfin...) de leur propre situation, n’a-t-il pas toujours été le rêve des plus puissants ?
Ce rôle de légitimation, qui fut longtemps celui des légendes et des religions, souvent aussi de l’histoire et de la géographie, revient aujourd’hui à la science économique officielle, avec des résultats très différents mais tout aussi redoutables. Contrairement aux civilisations précédentes, dont les mythes fondateurs quêtaient l’adhésion et le respect, la civilisation du marché n’a besoin que d’une acceptation. Il n’est pas nécessaire de vénérer, sans parler d’aimer, le système que l’on subit, pourvu que l’on « sache » qu’il n’en existe aucun autre possible et que l’on « comprenne », une fois pour toutes, que tout le reste est folie.
Le marché dans la crise ou la crise du marché
C’est ainsi que se met en place un nouveau consensus, fondé surtout sur la résignation et le sentiment d’impuissance. L’idée se répand d’une économie sans visage, dont les vrais agents ne sont plus des hommes, pas même des entreprises, mais le Marché lui-même, non plus des spéculations mais « la spéculation », la Bourse, tout un réseau d’abstractions reliées entre elles par des mécanismes extra-humains. Les chefs politiques et les hommes d’affaires, dont les portraits nous harcèlent à chaque instant, ont beau faire semblant de maîtriser la machine, ils sont comme les dieux de la Grèce antique, souvent redoutables, mais soumis eux-mêmes à des contraintes plus fortes, à des lois obscures et anonymes.
Ce curieux mélange de fatalisme et de déterminisme économique, masque avantageusement la réalité des forces sociales et des conflits qui les opposent. Il dissimule, sous l’apparente rigueur de mécanismes idéaux, la complexité des affrontements réels, économiques, politiques, sociaux, culturels - nationaux et internationaux - inextricablement imbriqués. La vision simplifiée de l’économie qu’il impose devient ainsi, pour les catégories « perdantes », c’est-à-dire pour l’immense majorité des gens, un puissant facteur de désespérance.
Il peut sembler paradoxal, au prime abord, que cette acceptation généralisée du modèle capitaliste libéral comme voie unique du développement, coïncide avec la remise en cause, au niveau des faits eux-mêmes, des mécanismes tant vantés. Ce n’est pas en effet le capitalisme triomphant, celui de la croissance et des niveaux de vie les plus élévés, qui obtient cette reconnaissance universelle. C’est au contraire un capitalisme en crise, confronté à des contradictions de plus en plus aiguës, mais assuré pour l’instant d’un monopole idéologique, fondé sur la faillite de l’adversaire plutôt que sur ses propres succès, jusqu’à tirer argument de ses difficultés elles-mêmes pour renforcer sa domination.
Dans les pays les plus pauvres du tiers monde, en Afrique en particulier, la mise en œuvre systématique des programmes d’ajustement structurel, en subordonnant le développement aux impératifs financiers à court terme, a conduit des peuples entiers au bord de la catastrophe. La réduction des déficits budgétaires et la stabilisation relative des balances de paiement n’ont pas créé, comme on l’annonçait, les conditions d’une reprise. Elles ont pour contrepartie un effondrement de la production. La diminution massive des dépenses publiques s’est traduite par une quasi disparition des systèmes d’enseignement et de santé. Famine, épidémies, augmentation de la mortalité infantile en sont les conséquences, tandis qu’une minorité de profiteurs s’enrichit sur la misère générale et accumule, dans les banques étrangères, des réserves souvent égales - et quelque fois supérieures - à l’endettement des pays. Quant au problème de la dette enfin (qu’on dit parfois résolu parce qu’il n’inquiète plus les créanciers), il continue de peser lourdement sur l’économie des pays pauvres qui transfèrent chaque année vers les pays les plus riches des sommes supérieures à ce qu’ils en reçoivent.
Ce grand marasme, il est vrai, n’a pas eu que des effets négatifs. Il a miné la base sociale des régimes néo-coloniaux et contribué à l’émergence d’oppositions démocratiques très larges, stimulées par l’exemple des pays de l’Est (et tout particulièrement, parce que le plus spectaculaire, le renversement de Ceausescu en Roumanie). Portés à la fois par les aspirations, souvent contradictoires, d’une partie des masses populaires et des couches moyennes, ces mouvements ont remis en cause les structures politiques auroritaires et les structures économiques étatiques de ces Etats. Ils se sont développés sous la double invocation de la démocratie politique (identifiée au système parlementaire pluripartiste), chacune devant apporter à l’autre les conditions nécessaires à son épanouissement.
Mais seul un volet de ce programme s’est effectivement réalisé. Les structures étatiques de l’économie, en pleine déconfiture, ont été brisées en effet, mais, à de très rares exceptions près (et pour combien de temps encore ?) aucune amélioration ne s’en est suivie, bien au contraire. L’aggravation de la misère et des inégalités sociales, la paralysie des appareils d’Etat, la prolifération des activités mafieuses ne sont pas seulement un mauvais moment à passer, elles sont le produit logique d’une économie incontrôlable et font peser, sur les démocraties naissantes ou renaissantes, la double menace de l’anarchie et de la dictature.
Dans ce contexte différent, mais aussi avec bien des points communs, la problématique est la même en Europe de l’Est. Là aussi, l’ouverture de la « transition vers une économie de marché » a soulevé d’abord bien des illusions - en même temps que bien des appétits de la part des grandes entreprises occidentales. Là aussi, le niveau de vie, déjà bien précaire, s’est effondré. Les mécanismes de protection sociale ont disparu. La privatisation des entreprises n’est, le plus souvent, qu’une spoliation pure et simple, au profit des seuls détenteurs de richesse, anciens prédateurs de la nomenklatura défunte ou nouveaux princes du marché noir.
Une société désagrégée, démoralisée, où fleurissent le banditisme et la prostitution galopante, où sévissent les vieux fantômes du chauvinisme et du racisme et où reparaissent les guerres tribales, de la Yougoslavie au Caucase et aux fontières de l’Islam... Que cette situation soit en grande partie le produit de la société stalinienne et post-stalinienne elle-même, comme celle du tiers monde, est le produit du colonialisme, n’enlève rien aux responsabilités du présent, à l’échec sanglant de la restauration libérale.
Dans les pays économiquement avancés enfin, la régulation de l’économie par les mécanismes du marché ne se montre pas plus efficace. Le capitalisme triomphant destabilisé par sa propre victoire, privé d’adversaires à l’intérieur comme à l’extérieur, n’en est que plus incapable de surmonter ses propres contradictions.
Le déclin des grandes idéologies, des utopies sociales a d’abord été salué comme une victoire de la raison. Ce devait être la fin de l’histoire, la disparition de la politique au profit de la « bonne gestion » et de la « gouvernance ». Le capitalisme allait ainsi réaliser, par d’autres moyens, les prédictions de Marx sur le passage du gouvernement des personnes à l’administration des choses.
Mais voici que cette rationalité se retourne contre elle-même. Face à une crise dont ni l’ampleur ni la durée n’étaient prévues, les entreprises et les Etats essayent de s’y adapter, de naviguer comme ils peuvent dans la tempête, en espérant que le beau temps revienne. Des mesures sont prises par les uns et par les autres, dont beaucoup sont tout à fait rationnelles, selon les règles habituelles d’une bonne gestion, c’est-à-dire au niveau de chaque centre de décision, de chaque entreprise, de chaque Etat - mais leur addition à l’échelle des économies nationales, et plus encore à l’échelle mondiale, transforme cette logique de micro-rationalité en une absurdité globale.
Les mesures de licenciement, par exemple, allègent les charges des entreprises, mais le coût du chômage est reporté sur la collectivité toute entière, avec un formidable effet de boule de neige, à travers la diminution de la demande finale, le déséquilibre des systèmes de sécurité sociale, la fragilisation de la société dans son ensemble. Les restrictions budgétaires décidées par les Etats visent à l’assainissement des finances publiques. Ils n’y parviennent que très partiellement et pour un temps limité, tout en rendant de plus en plus difficile l’accomplissement par ces mêmes Etats de leurs fonctions habituelles, principalement dans le domaine social. Quant aux politiques de commerce extérieur préconisées dans le monde entier, elles poussent chaque pays à exporter toujours plus, tout en important toujours moins, ce qui n’est manifestement pas possible, à moins que ce ne soit finalement les pays les moins compétitifs qui absorbent les excédents des pays les plus riches, ce qui est tout simplement absurde.
La libéralisation à outrance, et l’affaiblissement des Etats qui en découle se traduisent ainsi, à tous les niveaux, par une succession de blocages dont les interminables négociations du G.A.T.T sont le plus bel exemple à l’échelle internationale. Cet « accord général » est d’ailleurs lui-même la parfaite expression de la loi du plus fort qui régit le marché mondial. On se souvient sans doute que les institutions internationales créées au lendemain de la deuxième guerre mondiale, devaient comporter à l’origine quatre organismes complémentaires les uns des autres : un organisme politique, l’O.N.U ; un organisme monétaire, le FMI ; un organisme bancaire, la B.I.R.D ; un organisme de réglementation du commerce international enfin, dont le texte constitutif, approuvé par la délégation américaine elle-même à la conférence de La Havane, ne fut jamais ratifié par le Congrès des Etats-Unis. Le refus des Etats-Unis, alors au faîte de leur puissance économique, politique et militaire, a fait échouer définitivement ce projet, laissant la place à la C.N.U.C.E.D, organisme plein de bonnes intentions, mais dépourvu de tout pouvoir, et au G.A.T.T, avec pour objectif la suppression des barrières douanières et la soumission de l’économie mondiale aux « lois » du marché, sans guère de considération pour les inégalités évidentes entre les pays et les grandes régions du monde.
Ce comportement n’a cessé depuis lors. Aujourd’hui encore, à chaque blocage nouveau, à chaque augmentation de la misère et des inégalités dans le monde, la réponse est à peu près la même. Ce ne sont pas les mécanismes du marché qui sont en cause puisqu’ils sont l’expression de la réalité économique et de sa rationalité elle-même. Si les choses vont mal c’est donc que le marché ne domine pas encore assez l’ensemble des activités humaines. C’est qu’il faut encore plus d’ajustements, encore plus de libéralisme économique, pour que les mécanismes du marché, par delà une période difficile (mais pour qui ?) réalisent enfin leur merveilleux équilibre.
La démocratie pour quoi faire ?
Il ne s’agit pas cependant que d’un problème économique, loin de là. L’économie capitaliste de marché n’est pas seulement présentée comme la seule efficace, la seule opérationnelle, puisque la seule conforme à la nature des choses. Elle est aussi et surtout considérée, y compris par ceux qui en regrettent les excès, comme la mère, et pas conséquent la meilleure garante de la démocratie.
Ce lien (ou cette confusion ?) entre les libertés économiques et les libertés politiques est depuis longtemps, mais aujourd’hui plus que jamais, l’argument le plus fort, surtout dans les pays occidentaux, en faveur d’une économie de marché. Présent dans tous les débats du XIXeme et de la première moitié du XXeme siècle, il apparaît désormais comme sans réplique, renforcé par les désastres de la dictature stalinienne et des régimes totalitaires inspirés de son expérience. Que pèsent encore les critiques sur les « libertés formelles » de la « démocratie bourgeoise », face à la réalité du goulag, au pouvoir écrasant de la nomenklatura, détentrice de l’autorité politique, du contrôle de l’économie et du bien-être matériel ?
Le lien historique entre la démocratie et le marché n’est-il pas au contraire évident ? L’histoire ne montre-t-elle pas, d’abord en Europe mais aussi, progressivement, dans d’autres pays du monde, que l’économie de marché a besoin d’un cadre démocratique pour se développer ? Mais la question est aujourd’hui de savoir si la démocratie elle-même a besoin du marché - plus exactement si le marché, tel qu’il fonctionne en devenant le moteur unique, ou le moteur principal, de l’économie ne devient pas à son tour un obstacle au développement de la démocratie, à l’exercice des libertés politiques et des libertés individuelles en général.
Cette ambiguïté est apparue dès le commencement de l’ère capitaliste. Lorsque la bourgeoisie se battait, en s’appuyant sur les couches populaires, pour abattre les barrières du système féodal, c’était pour conquérir à la fois sa participation au pouvoir et la possibilité d’entreprendre, de posséder, d’exploiter, de tirer parti plus efficacement des nouveaux moyens que lui apportait l’évolution des forces productives. En France, par exemple, l’abolition des privilèges fut aussi le démantèlement des corporations et des protections qu’elles représentaient pour d’autres catégories sociales. Au nom d’une égalité juridique et d’une liberté réduite aux individus, la loi Le Chapelier interdisait aux travailleurs de se regrouper pour des actions collectives, et il fallut plus d’un siècle pour que la classe ouvrière arrache à la bourgeoisie la liberté syndicale.
La démocratie portée par la montée du capitalisme, c’est d’abord la démocratie censitaire, celle ou le pouvoir des hommes est proportionnel à l’argent qu’ils possèdent. Son infléchissement vers d’autres structures (le suffrage universel, le droit syndical, la sécurité sociale etc...) n’est pas le produit de l’évolution du marché, du progrès scientifique et technique, d’un nouvel essor des moyens de production, ou plutôt il ne l’est qu’à travers les contradictions nouvelles qu’ils ont engendrées, à travers les luttes qu’ils ont suscitées de la part de la petite bourgeoisie et de la classe ouvrière.
Ce sont ces luttes elles-mêmes qui ont sauvé le capitalisme de ses propres incohérences, en permettant l’extension des marchés intérieurs, l’augmentation des niveaux de vie, la consommation de masse et une certaine régulation des tensions sociales. C’est sur la base de ce nouveau rapport des forces qu’a pu s’établir, pendant plusieurs décennies, le compromis social-démocrate, c’est-à-dire l’alliance de fait entre le monde du travail et le capitalisme moderne.
Certes, la situation a beaucoup changé depuis lors. La société d’aujourd’hui ne ressemble ni à celle de Germinal ni à celle de 1936. La doctrine officielle s’appuie sur cette constatation pour proclamer que les rêves d’hier sont caduques, les analyses périmées, les idéaux sans objet. Reste pourtant à savoir si les changements intervenus, incontestables en eux-mêmes, sont bien ceux que l’on nous décrit si complaisamment. Qu’en est-il en particulier de cette « immense classe moyenne » indifférenciée, avec sa culture unique et son accès général au marché, qui serait aujourd’hui le fondement de la société, renvoyant la lutte des classes aux musées d’archéologie ?
Ne suffit-il pas d’une promenade de quelques heures, dans n’importe quelle ville d’Europe (et à plus forte raison dans les autres) pour démasquer ce mensonge ? Quel rapport y-a-t-il, en termes de pouvoir d’achat et de pouvoir tout court, en termes de culture aussi, entre les villas des beaux quartiers et les immeubles utilitaires ? Les quartiers ouvriers proprement dit ont pratiquement disparu, mais la vaste couche majoritaire des salariés, toutes catégories confondues dans la grisaille et l’uniformité de ses grands ensembles, ne ressemble pas plus à la moyenne bourgeoisie d’autrefois qu’à la classe ouvrière historique. Frappée par la diminution de son niveau de vie, menacée par l’extension du chômage, elle est constituée d’anciens et de nouveaux prolétaires, sans conscience prolétarienne, il est vrai, mais sans non plus d’adhésion profonde aux valeurs des classes dirigeantes.
Rien n’est plus dérisoire, à cet égard, que les efforts entrepris par les Etats et les patronats pour tenter de promouvoir, à travers les privatisations d’entreprises publiques et les ouvertures de capital dans les entreprises privées elles-mêmes, l’idée d’une démocratie économique fondée sur la généralisation de l’actionnariat : le « pan-capitalisme ». Les résultats obtenus en termes de souscription initiale font généralement l’objet de communiqués victorieux, mais combien de ces actions restent effectivement dans le portefeuille des petits porteurs ?
Les nouveaux actionnaires ne tardent pas à s’apercevoir de la duperie dont ils font l’objet. Ils voient bien qu’ils ne sont pas de vrais partenaires, qu’ils ne pèsent rien dans une assemblée générale (à moins de se regrouper, ce qui n’est pas le cas pour l’instant), quand il s’agit d’approuver la direction et de prendre les décisions qu’ils auront à subir en tant que salariés.
Cette couche sociale majoritaire ne ressemble pourtant guère aux classes moyennes d’autrefois. Elle n’est pas une classe à proprement parler. Elle demeure extérieure au système enplace, et ne lui apporte rien que son consentement ou sa simple résignation. Elle ne constitue pas encore pour lui une véritable menace, mais pas non plus un appui. La ligne de fracture a beau se situer plus loin, à la hauteur des banlieues, le monde des exclus n’a beau n’être encore qu’une minorité, son existence même est le talon d’Achille du capitalisme libéral.
Non que la paupérisation de masse, l’expulsion, le déracinement de populations entières soient en eux-mêmes des réalités nouvelles. La révolution industrielle du siècle dernier avait aussi plongé dans la misère des millions d’hommes sans travail, et des théoriciens du socialisme, comme Rosa Luxembourg, prévoyaient déjà le moment où le système capitaliste ne pourrait plus « racheter sa propre production ».
Ce sont les luttes ouvrières, luttes économiques et luttes politiques, facilitées par le cadre même de la démocratie bourgeoise et par son élargissement, qui ont contribué, en même temps que le progrès des techniques et des méthodes de production, à reculer cette échéance. Mais la crise actuelle, le raz de marée du chômage, ne replacent-ils pas l’économie capitaliste dans la même impasse de surproduction, dans un contexte encore plus instable, encore plus dangereux pour elle, parce que les contre-poids de la démocratie et du marché ne fonctionnent plus ?
Une démocratie censitaire
Le passage de l’exploitation à l’exclusion est à cet égard décisif. Le capitalisme triomphant avait prolétarisé les masses paysannes et les travailleurs individuels ruinés, c’est-à-dire qu’il les avait intégrés à son système de production, parce qu’il en avait l’« usage », à la fois comme producteurs et comme consommateurs - et finalement comme citoyens, si manipulés fussent-ils. Le capitalisme d’aujourd’hui dispose, au contraire d’un instrument de production si perfectionné, avec une productivité si énorme, qu’il n’existe plus de corrélation directe entre la quantité de production et la quantité de travail. . Contrairement au prolétaire d’autrefois, l’exclu d’aujourd’hui n’a plus de « valeur » sur le marché, la société capitaliste n’en a plus « besoin » - ou plutôt elle en a besoin comme consommateur, mais non plus comme producteur, ce qui est pour elle une contradiction redoutable.
Devant une crise de cette ampleur, qui n’est plus liée à des diminutions conjoncturelles de la demande, mais à un déséquilibre structurel, inhérent au système de production lui-même, les dirigeants économiques et politiques sont désarmés. Ils détournent l’attention sur l’importance du phénomène en isolant son aspect le plus voyant, celui des populations immigrées, cherchant ainsi, par une véritable « exclusion dans l’exclusion », à en minimiser la portée générale.
Chaque jour, chaque bulletin d’information apporte pourtant la preuve que c’est la société toute entière qui se lézarde, à l’échelle de chaque Etat comme à l’échelle internationale, jusqu’à voir se profiler, avec la montée du racisme, du chauvinisme et de la violence sous toutes ses formes, la menace d’une nouvelle sauvagerie.
Que font, dans tout cela, les mécanismes stabilisateurs du marché ? Comment fonctionne la démocratie ? Plus les inégalités sont grandes, plus le champ social de l’exclusion s’élargit, moins le marché est capable d’assurer un équilibre entre la production et les besoins, c’est-à-dire d’orienter la première vers la satisfaction des seconds.
Il ne l’est, bien sûr, jamais complètement, même lorsqu’il s’agit en apparence, sur la place du village, d’un échange entre personnes libres. La démocratie du marché ressemble toujours aux régimes de la restauration : c’est une démocratie censitaire, dans laquelle la demande de chacun est pondérée par son propre pouvoir d’achat. Les besoins collectifs et les besoins individuels des catégories non solvables y sont naturellement sous- représentés. Ils ne peuvent pas être satisfaits par le jeu de l’offre et de la demande, mais par l’intervention d’autres forces, qui se manifestent par une autre demande, à travers des interventions politiques.
La distorsion naturelle entre la demande solvable et les besoins sociaux, indissociable des mécanismes du marché, prend aujourd’hui des proportions accrues, dans notre société improprement appelée « de consommation », qui est dominée au contraire par l’antériorité de l’offre sur la demande, de la production sur l’expression des besoins.
Ce fossé devient plus large encore avec la prolifération du marché financier, dont les moyens techniques nouveaux, informatique et télécommunication notamment, ont rendu possible un développement autonome. La masse monétaire et les profits financiers s’accroissent beaucoup plus vite que la production matérielle, aggravant le déséquilibre et la fragilité du système en même temps que son abstraction, que son éloignement des réalités et du besoin des hommes.
Quant au pouvoir politique, il n’est plus en mesure de redresser la barre. Les gouvernants font semblant de gouverner, sous le regard sceptique des « citoyens » désabusés, mais les décisions les plus importantes leur échappent. L’évolution économique dans chaque pays est conditionnée par la guerre des grandes sociétés internationales, au niveau d’un marché mondial dont les mécanismes eux-mêmes ne peuvent être modérés par aucune instance démocratique, en l’état actuel des institutions.
Ainsi, après avoir contribué à la naissance de la démocratie moderne, l’économie capitaliste de marché, sous sa forme la plus avancée, la paralyse par ses propres contradictions et conduit à son dépérissement.
Cette évolution ne fait-elle pas apparaître une troublante analogie entre la crise du marché et la faillite du « socialisme réel » ?
Sur le papier, les thèses de Pareto et celles de Kantorovitch se rejoignaient. Les modèles de la planification centrale devaient aboutir aux mêmes résultats que la « concurrence parfaite », quant à l’optimisation des ressources, à partir d’une évaluation des besoins et des gammes de production qui en découlaient. C’est le projet collectif qui l’emportait, en principe, sur les choix des individus. Mais qui décidait en réalité de ce projet, sinon les détenteurs du pouvoir, maîtres de l’appareil économique et des centres de décision politique, en l’absence de tout contre-poids et de toute représentation effective des consommateurs ?
Dans le système de concurrence du marché capitaliste, l’équilibre est atteint, non moins théoriquement, lorsqu’il n’est plus possible d’améliorer la situation d’un individu sans pénaliser tous les autres. Mais que vaut cette définition de l’optimum quand la remise en cause du partage est précisément l’objectif ? La régulation par le marché n’est alors finalement qu’une régulation par l’argent, une régulation au profit de ceux qui détiennent la richesse et la puissance, même si elle préserve - du moins dans les conditions normales de son fonctionnement - de plus grands espaces de liberté et plus d’initiative de la part des producteurs.
C’est finalement le déficit démocratique, l’incapacité des plus pauvres et des plus faibles à faire valoir leurs besoins, dans l’un et l’autre cas, qui est la source principale des blocages économiques. Il serait donc illusoire de s’en tenir à la position minimaliste, à quoi s’est résignée la social-démocratie dans sa plus grande majorité, consistant à ne défendre que les libertés politiques sans leur donner un contenu. La démocratie elle-même est un moyen, mais ce moyen n’a de sens que s’il est au service d’un progrès social, d’un rééquilibrage de la société au profit de ceux qui en sont aujourd’hui les victimes. Un moyen de transformer le monde et non plus seulement de le faire accepter.
Vers une économie pluraliste
C’est dans cette perspective que nous devons aborder le problème des relations marché-démocratie et rechercher des solutions concrètes, non seulement pour les discuter et les confronter entre nous, mais essayer d’en promouvoir la mise en œuvre pratique, en partant de la réalité, non pour la justifier et la figer dans le temps, mais pour la transformer par une action progressive, en évitant à la fois les utopies dévastatrices et le faux réalisme de la résignation.
Manuel Bridier