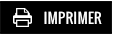Marché national ou marché international ? - Marc Chervel
Publié par , le 13 mars 2007.
Les systèmes économiques fondés sur une planification centralisée se sont effondrés de l’intérieur, minés par le népotisme, la corruption et en définitive l’inefficacité.
Le système capitaliste a connu ainsi une victoire éclatante, tout à fait inattendue. Sur le plan théorique, il est devenu difficile d’opposer quelque chose aux tenants du libéralisme à tout va : ainsi leur thèse tend-elle à devenir parfaitement hégémonique. Tout au plus ira-t’on chipoter sur quelques considérations sociales : en fait, on en est revenu, à peu près, aux discours du XIXème siècle sur les pauvres et la nécessaire charité, qu’elle soit chrétienne ou pas, à vocation nationale ou internationale.
C’est quand même aller un peu vite en besogne !
Car loin d’être résolus par le libéralisme en vigueur, les problèmes de développement tendent à s’aggraver : en France pour 3 millions de chômeurs, 300 000 sans abris ; en Afrique, dans le tiers monde ; ils concernent en fait les 3/4 de 1’humanité .
Il faut donc reprendre la réflexion sur « le marché et le plan », mais sans dogmatisme et avec le plus grand souci de la réalité.
A notre sens, il importe tout d’abord de distinguer dans l’analyse ce qui est du ressort du marché national de ce qui est du marché international, car c’est entre les deux que doivent se situer des régulations indispensables qui, actuellement, font défaut : celles de l’Etat national.
Notre thèse s’explicite en deux mouvements contraires :
- L’efficacité économique nécessite qu’une large part de la régulation économique soit assurée par le marché, à l’intérieur de l’ensemble national.
- Mais la marche vers la justice sociale, vers le plein emploi, et la lutte contre l’exclusion nécessitent que cet ensemble national ne soit pas confronté directement, sans précautions, à la violence de la concurrence internationale.
Autrement dit, par rapport aux errements antérieurs et actuels, une meilleure régulation de notre économie, condition nécessaire de la démocratie, doit être obtenue :
- par un marché national développé,
- et par moins de marché international.
Contrairement à ce que nous pouvions penser il y a 10 ou 20 ans, les expériences de planification centralisée n’ont pas conduit à une croissance accélérée et harmonieuse de l’économie.
Certes, dans la période héroïque de la guerre et de la reconstruction, la planification en quantités a démontré son efficacité : aucun pays n’a pu atteindre ses objectifs stratégiques de production sans cette gestion centralisée de la main-d’oeuvre et des biens. Mais cette gestion et cette austérité n’étaient possibles que dans le climat frugal de mobilisation nationale, qui prévalait alors.
Une fois la paix revenue, la reconstruction bien engagée, ce système économique n’a pu répondre à l’aspiration à un meilleur niveau de vie, et à la demande des multiples biens et des services qui lui correspond. Dans les pays occidentaux, on a observé un glissement progressif de l’économie de guerre, à l’économie centralement planifiée (en France, le plan Monnet 1947-52), puis à une économie de plus en plus libérale : cette évolution du système, spontanément réalisée, a permis une hausse sans précédent de la production intérieure (les 30 glorieuses). Dans les pays de l’Est, le blocage du système, son inefficacité et son inadéquation de plus en plus criantes, au fur et à mesure que le niveau de vie montait, ont conduit à l’effondrement brutal que l’on sait.
Il semble maintenant évident que, passé les périodes aiguës de guerre et de disette, un marché intérieur développé (avec ce que cela implique concernant la décentralisation de certaines décisions et la propriété privée de certains moyens de production soitun gage d’efficacité économique ; aux rapports de force en présence de faire en sorte que ce soit également un gage de justice sociale et de démocratie.
Il y a certainement à ré-étudier la ligne de séparation entre le marché et le plan dans l’allocation intérieure des ressources, mais le problème le plus important actuellement ne porte pas là : il porte sur le marché internationnal.
Le marché international
Si on lit dans la presse économique, non pas les interprétations théoriques et les propositions de politique, mais la seule recension des faits, l’évidence est que notre économie est confrontée quotidiennement à des problèmes (fermetures d’usines, licenciements) qui trouvent leur origine dans le commerce international, qu’il s’agisse d’importations ou d’exportations.
Nos productions sont victorieusement concurrencées sur le sol national par ce types d’importations : celles en provenance de pays plus développés, et celles en provenance de pays moins développés. Pour les premières, les prix établis sont souvent des prix de surplus, qu’il est impossible d’atteindre pour une production de moyenne importance ; un bon exemple est donné par les séries télévisées américaines. Pour les secondes, elles résultent du fait que les conditions de production sont incroyablement plus avantageuses dans ces régions du monde (Maghreb, Sud-est asiatique, Europe centrale) qui ne bénéficient pas, et de loin, de nos lois sociales, de nos régimes de solidarité et de nos niveaux de rémunération (1).
L’alternative est claire : ou nous nous alignons sur les standards sociaux de ces pays ou, d’une façon ou d’une autre, nous protégeons nos productions.
Faute de telles mesures, on voit céder, sous la pression, des pans entiers de notre économie : de nos productions textiles aux constructions navales en passant par la production de charbon, de chaussures, de prothèses dentaires ou d’aspirateurs, la pêche, la saisie informatique et même la fabrication des santons et des petits Jésus de nos galettes des rois (2).
Partout le mécanisme est le même, bien décrit, sauf la phase ultime, dans « La guerre des petits Jésus » : la production nationale à 3 francs/pièce cède devant l’importation asiatique à 60 centimes, revendue 1 franc. Tout le monde semble y gagner : le consommateur voit le prix baisser de façon parfois très importante (ici le prix est divisé par 3, et le consommateur gagne 2 francs ! Le producteur devenu importateur augmente considérablement ses marges (10 centimes).
Mais les agents engagés dans la production, salariés, caisses sociales, perdent 3 francs : et l’économie dans son ensemble perd 60 centimes (+2 + 0.4 - 3).
L’analyse économique montre que, alors que le gain pour le consommateur est élevé du fait de la baisse de prix, c’est une perte que l’on enregistre au niveau de l’économie : toutes ces opérations, à première vue si bénéfiques, conduisent peu à peu à détruire le revenu national et l’emploi, et à marginaliser des couches de plus en plus importantes de la population.
Ainsi, contrairement à 1a publicité des magasins Leclerc, il y a des prix trop bas : ce sont de manière générale les prix internationaux qui conduisent à délocaliser nos productions. Le tout n’est pas d’avoir des prix très bas, encore faut-il disposer de revenus pour pouvoir acheter (3) !
Mais il y a aussi des prix trop haut ! Ainsi des taux d’intérêt.
Les deux phénomènes (prix des produits trop bas, taux d’intêret trop haut) se conjuguent : au total, les détenteurs de capitaux ont plus d’avantages à placer leurs capitaux sur le marché financier, à importer des produits à bas prix, à spéculer sur le marché international ou les monnaies : tout plutôt que d’investir dans la production sur le sol national.
Ainsi, la concurrence internationale, qui joue tout autant sur les biens ou les services que sur les capitaux, rend impossible toute action d’envergure sur la production nationale de richesses et sur l’emploi (4).
D’accord, dira-t-on, pour protéger nos productions des importations intempestives, mais quid alors des mesures de rétorsion sur nos exportations ? Ne faudrait-il pas au contraire renforcer ce secteur, améliorer notre système de formation et notre compétitivité, et gagner de nouvelles parts de marchés extérieurs ?
L’accent mis sur l’exportation comme moteur de notre développement et de l’emploi remonte à quelque 20 ans : c’était le triptyque (le « théorème d’Albert ») : compétitivité, exportations, emplois. Peut-on dire maintenant que cette politique, qui s’est traduite parfois par des subventions considérables, a conduit au succès ? Et que penser de la stabilité d’un tel développement qui repose sur l’accroissement de nos parts de marchés, c’est-à-dire sur la défaite commerciale des autres pays ? Que vont-ils faire ? Et ne peut-on s’enrichir que de l’appauvrissement des autres ?
Contrairement aux idées en vogue, être le quatrième exportateur du monde n’est pas une force de notre économie : c’est une faiblesse. Notre économie est trop dépendante et trop fragile, car trop ouverte sur l’extérieur (ratio, importations sur PIB, supérieur à 20% contre moins de 10%, pour les USA ou le Japon). D’un coté, ceci nous interdit toute politique nationale de relance (on l’a vu en 1981-82) ; et d’un autre, ceci nous expose sous des prétextes divers à des mesures de rétorsion portant soit directement sur ces exportations, soit indirectement sur des exportations dans des pays tiers. Pour rester dans l’actualité, il suffit de penser aux avions de transport ou de chasse, à l’acier, au vin blanc, aux métros etc.
Il ne s’agit nullement de choisir l’autarcie et le modèle albanais. mais nous sommes allés trop loin, il n’est plus possible de laisser jouer ainsi la concurrence internationale. Et il n’y a pas d’autre solution, maintenant, que de recentrer progressivement notre économie sur nos besoins, de la consolider et d’offrir moins de prises à ce type de mesures extérieures.
Lutte contre l’exclusion : plein emploi et démocratie ou rompre avec certains tabous
C’est en apparence paradoxal : le problème de l’emploi ne peut pas être abordé par des calculs d’emplois (car on ne sait pas les mesurer et à la limite cela n’a pas de sens), mais par des calculs d’effets sur la croissance. Et cela on sait le faire : des dizaines et des centaines de projets ont été étudiés ainsi de par le monde, depuis 30 ans (5).
Ces calculs montrent que de nombreuses actions de développement sont susceptibles d’avoir un impact important sur la croissance, donc sur l’emploi ; mais que ces actions ne sont pas mises en oeuvr.e, car elles ne sont pas rentables financièrement dans le système des prix internationaux.
Contrairement à ce qui est dit, une croissance plus forte est donc possible ; et en conséquence, une répartition plus satisfaisante des revenus, une diminution du temps de travail et un retour progressif au plein emploi : mais cette démarche implique une rupture avec certains tabous de la pensée économique et des pratiques actuelles :
– la régulation de l’économie ne peut pas résulter d’une immersion sans contrôle dans le marché international ;
– en sens contraire, il faut mettre en place une instance qui permette :
• de définir les objectifs, le projet de société,
• d’étudier les programmations d’actions sur la base d’un calcul économique pertinent,
• de mettre en oeuvre, de manière cohérente, les politiques économiques et sociales correspondantes.
On ne peut plus se situer dans le cadre d’une économie subie, analysée de l’extérieur comme « classique » ou « keynésienne », ou autrement : il faut se situer dans le cadre d’une économie voulue, et la développer en tenant compte évidemment des enseignements de l’histoire récente, il faut revenir à la définition de politiques nationales de développement, à la planification, au calcul économique public faute de quoi, le chômage et l’exclusion continueront de se développer, qui viendront saper les bases mêmes de la démocratie.
Justification théorique
La justification du commerce international se trouve dans la « théorie des coûts comparatifs ». Ricardo compare, dans deux pays, les coûts de production d’un bien industriel (le drap) et d’un bien « naturel » (le vin), plus exactement il s’agit d’un bien directement issu d’un bien naturel, le raisin (6).
On comprend alors l’intérêt qu’il y a à commercer : bien sûr, on doit pouvoir faire pousser des vignes en Angleterre (ou des bananes en Finlande), mais c’est quand même plus commode au Portugal (ou aux Caraïbes). Chez Ricardo, l’origine de l’avantage tient aux conditions naturelles, au climat, à la géologie des deux pays.
L’extension de cette comparaison vin-drap à l’ensemble des biens industriels, « justification théorique » du commerce international, est abusive et relève de la mystification : car, alors quelle est l’origine de l’avantage ? Dans le cas des délocalisations, l’avantage réside bien sur dans les salaires de misère et l’absence de protection sociale des pays d’accueil.
Mais autant le dire tout de suite, plutôt que d’invoquer pompeusement Ricardo.
1 - Par exemple, 7,50 francs pour la journée de travail près de Djakarta. Le Monde 22/12/1992, Marchands d’uniformes.
Voir également le Rapport d’information sur les délocalisations, Sénat session 1992-1993, J. Arthuis.
2 - Le Monde 5/1/1993, La guerre des petits Jésus, P. Krémer.
3 - Le Monde 17/8/1993, Les consommateurs au secours du libre-échange, Billet de E. Izraelewicz.
4 - Le Monde 22/12/1992, Ni dévaluation ni inflation, J.M. Jeanneney.
5 - La méthode des effets trente ans après, M. Chervel, Revue tiers monde n°132, Octobre-décembre 1992.
6 - Dans les méthodes d’évaluation de projets, on appelle « bien national » ces biens non susceptibles de commerce international (le raisin ou le jus de raisin pour faire le vin).
Marc Chervel