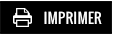La politique de la Ville... et les habitants ? - Sonia Fayman - 1996
Publié par , le 6 mars 1996.
Cet article est paru dans la revue “ Les Annales de la recherche urbaine ”, n°68-69, 1995.
L’une des finalités de la politique de la Ville est d’intégrer les quartiers défavorisés dans la dynamique urbaine. Cette dimension a été présente tout au long de son évolution, depuis le développement social des quartiers, et même depuis les prémices de cette politique, dans les années 70 au cours desquelles sont apparus les thèmes de la réhabilitation de l’habitat social et de l’habitat ancien populaire concrétisés dans les opérations Habitat et Vie Sociale. Elle a pris des formes différentes, selon que l’accent était mis sur les quartiers comme microcosmes sociaux à re-dynamiser (période DSQ), sur la relégation de leurs habitants à ré-insérer (DSU), ou sur la nécessité d’englober ces démarches dans la politique urbaine des collectivités territoriales et de l’Etat (contrats de ville).
Au fond, à travers cette diversité, c’est bien la question du droit à la ville qui est posée, c’est à dire le droit au logement, à l’emploi, aux services, à la culture, à la qualité urbaine et à la citoyenneté. Certes ces droits sont de moins en moins simultanément respectés, et pas seulement dans les quartiers défavorisés. Mais on s’accorde généralement sur le fait que les quartiers dits en difficultés sont les lieux du plus grand cumul de handicaps face à ces droits fondamentaux.
En ce sens, le projet d’intégrer les quartiers défavorisés dans les villes porte en lui la possibilité d’une égalité face au droit à la ville. Mais cette thématique est peu abordée dans les documents de programmation des actions, comme dans les recherches et évaluations ; ou plutôt, elle est abordée à partir de la représentation que les professionnels se font de la situation des populations de ces quartiers, plus qu’à travers l’expression des habitants eux-mêmes. C’est là un effet d’un consensus tacite dans les milieux politiques, administratifs et intellectuels, sur la disparition des solidarités de classe avec la désindustrialisation et l’affaiblissement de la classe ouvrière et de ses modes d’expression collective traditionnels. Or, on a un peu trop vite fait de classer les quartiers périphériques d’habitat social dans le domaine de l’exclusion, leurs habitants dans le quart-monde, et leur vie sociale dans l’anomie et la désespérance.
Michel Anselme s’était déjà élevé contre ce catastrophisme simplificateur, en observant les modalités de la solidarité familiale et la production sociale, dans les quartiers nord de Marseille. Les travaux d’Alain Tarrius peuvent également être évoqués ; lorsqu’il explique que "la ZUP de Marseille...remplit la fonction de relais pour les échanges institués entre Belsunce et le deuxième périmètre régional" , il va à contre-courant de la perception dominante de quartiers purement et simplement relégués, et leur confère au contraire une place importante dans des réseaux économiques de vaste amplitude.
Sans nier les problèmes de chômage, d’effritement familial, d’absence de perspectives pour les jeunes, qui sont là souvent à leur paroxysme, il faut réfréner une tendance à la diabolisation des "quartiers" qui ne fait qu’en accroître la stigmatisation, tout en n’en donnant qu’une vision schématique alimentant des politiques fondées sur des a priori. Au sein de ces quartiers, des pratiques sociales généralement sous-estimées, participent de la politique de la ville, tendant, de manières diverses, à accéder au droit à la ville.
Nous examinerons deux modalités de cette implication des habitants dans la politique de la Ville : l’expérience d’associations de jeunes d’origines étrangères, et les actions de médiation de femmes africaines.
Les associations de jeunes face au dilemme : reconnaissance conflictuelle ou paternalisme clientéliste ?
Des femmes et hommes nés dans les années 60, de parents immigrés, élevés dans les quartiers d’habitat social, ont eu vingt ans dans les années 80. Ils ont vécu comme un espoir l’arrrivée de la gauche au pouvoir, l’abrogation du décret-loi de 1939 qui privait les étrangers du droit d’association, et ont animé les marches pour l’égalité parties des banlieues des grandes villes de France, qui ont donné lieu à un renouvellement de la vie associative issue de l’immigration jusqu’alors contrôlée par les Amicales (algérienne, marocaine, tunisienne...) liées aux gouvernements des pays d’origine. Le mouvement politique de l’immigration qui s’est développé sur ces bases, composé de tendances allant de l’entrisme dans les partis de droite à la théorie de la nouvelle citoyenneté, en passant par le communautarisme et l’interculturalisme, a créé un tissu de relations entre militants et associations de quartier ; celles-ci se sont spontanément tournées vers les opérations de développement social des quartiers promues par la CNDSQ, qui offraient alors aux habitants une place pour concevoir et mettre en oeuvre des initiatives d’intérêt général en coopération avec les collectivités locales et les services de l’Etat.
Mais, entre le début et la fin des années 80, cette dynamique s’est sclérosée sous l’effet de plusieurs éléments affectant soit l’ensemble de la société, soit des processus territorialisés. Au plan général, citons la faiblesse de la gauche au pouvoir face à la montée du chômage et de la xénophobie, l’exacerbation des contradictions au sein du mouvement politique de l’immigration, marquée par une bi-polarisation sur le repli communautaire d’un côté et l’antiracisme apolitique de l’autre, enfin les effets en profondeur de la crise sur les projets de vie, sapant les perspectives de la jeunesse. Au plan territorial, les pouvoirs locaux s’approprient le DSQ qui devient DSU ; si des emplois sont créés dans les quartiers, c’est par multiplication des niveaux d’intermédiation professionnelle entre les habitants et les dispositifs prévus pour leur insertion, tandis que le travail des équipes opérationnelles est parcellisé. Dans ce contexte, les associations de jeunes qui avaient fleuri un peu partout, s’essoufflent lorsqu’elles n’avaient fonctionné que sur la révolte, ou s’exaspèrent du peu de moyens qui leur sont octroyés pour faire du développement social, quand elles ne sont pas cooptées par les institutions comme courroies de transmission des politiques publiques.
Les années 90 voient la politique de la Ville entrer dans une phase de compulsion de répétition, sous l’égide du tandem Pasqua-Veil. Les lois Pasqua, notamment, fragilisent le tissu social des quartiers populaires en opérant des classifications du type de celles de l’apartheid, qui divisent la population en Français de souche, Français sous conditions, parents étrangers d’enfants français... Le centre n’invente plus rien en matière de développement social urbain, tandis que les configurations politiques locales et régionales déterminent les modalités d’un partenariat de plus en plus administratif qui fonctionne en circuit fermé, comme si, après tant d’années, il n’était plus nécessaire de travailler avec les habitants, ni même de les consulter, pour orienter les projets sur les quartiers.
Au stade actuel de cette évolution, les associations dans les quartiers sont soumises à des pressions contradictoires, émanant respectivement de leur base, du reste de la population, des collectivités territoriales et de l’Etat.
Le public de base des associations est formé d’adolescents et de jeunes adultes qui expriment de façon directe, voire violente, une tension permanente entre le fait d’intégrer l’image dévalorisée des quartiers où ils vivent (ayant le sentiment que cette image "leur colle à la peau") et le désir de vivre et d’être perçus comme n’importe quel jeune. Ils ont des revendications simples, telles que la jouissance de salles ou de terrains, qui apparaissent cependant inaccessibles tant les pouvoirs locaux y voient des risques de désordre et de déviance collective. Ils font pression sur les associations, sans admettre facilement la nécessité de passer par des processus de négociation parfois longs et sinueux, usant facilement de la menace et passant parfois à exécution en des actes destructifs.
La population familiale s’adresse également aux associations parce qu’elles s’occupent des enfants (soutien scolaire et centres de loisirs) et parce que le dénuement culturel, la perte des liens avec l’extérieur dûe au chômage, accentuent la fracture sociale et urbaine, la relégation, et rendent toute démarche administrative difficile. Les habitants des quartiers se tournent vers ces associations qui représentent pour elles un pont vers le monde environnant, un moyen d’accéder à l’information sur l’emploi, sur l’aide sociale, sur les projets concernant leur quartier. Ce type de demande est inépuisable et les militants bénévoles ou permanents des associations peuvent difficilement s’en extraire.
Les municipalités sont dans une certaine ambivalence vis-à-vis des associations de jeunes issus de l’immigration : d’un côté elles saluent leur existence, dans la mesure où elles y voient des remparts contre les explosions sociales toujours possibles ; mais dans le même temps, leur attitude dictée soit par un paternalisme bienveillant, soit par une méfiance raciste, revient à les tenir à distance plutôt qu’à les associer à la conduite de la politique de la Ville. En ce sens le développement des associations est éminemment dépendant du bon vouloir des maires. A Goussainville (Val d’Oise), un projet d’accompagnement pédagogique de demandeurs d’emploi vers les dispositifs d’insertion, n’a pas été inscrit au contrat de ville et n’a pu jusqu’à présent bénéficier d’aucune subvention parce qu’il n’a pas eu l’agrément de l’ancien maire, alors qu’il avait retenu l’attention de représentants de services de l’Etat.
Parmi les partenaires institutionnels de la politique de la Ville au plan local, certains sont directement concernés par l’implication des populations dans le développement social et urbain : les organismes logeurs, les services sociaux de l’Etat et des départements, les caisses d’allocations familiales, les services déconcentrés de l’équipement, de la jeunesse et des sports, de l’éducation, du travail, de la culture, ainsi que le FAS, Fonds d’Action Sociale pour les immigrés et leurs familles. Cet établissement est particulièrement emblématique des contradictions internes à la politique de la Ville. Créé pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie, et traditionnellement alimenté par la part des allocations familiales qui ne revenaient pas aux travailleurs étrangers, il a longtemps fonctionné sur le double principe de la redistribution de ces fonds au profit des immigrés et de la mise en oeuvre de moyens d’éduquer cette population pour lui faire assimiler les codes de la vie en France. Cette idéologie capacitaire a progressivement fait place à une aide au développement socio-culturel tenant compte à la fois du spécifique et de l’universel. Mais l’existence même du FAS institue les immigrés (et les enfants d’immigrés nés en France) en catégorie sociale, transcendant les différences d’origines géographiques, sociales, de nationalités, de projets migratoires, de générations, d’éducation, d’insertion professionnelle, de modes de vie. Elle nourrit le consensus institutionnel sur la gestion séparée des populations, même si paradoxalement c’est parfois le FAS qui va au-devant de ses partenaires administratifs pour les inciter au décloisonnement, comme cela a été le cas dans la région provençale par exemple. Les associations, dès lors qu’elles reçoivent des subventions du FAS, tendent à être cataloguées comme relevant de la seule aide et tutelle de cet établissement.
Les associations créées par des jeunes d’origine étrangère sont donc dans une situation complexe, peu favorable à leur insertion pleine et entière comme acteurs de la politique de la Ville. Il faut que leur projet associatif soit suffisamment charpenté et mobilisateur pour que leurs animateurs ne soient pas envahis par le doute et ne disparaissent de la scène des quartiers. De l’intense floraison d’associations nées dans la mouvance des marches pour l’égalité, certaines se sont épuisées, d’autres ne survivent que pour justifier les emplois d’animateurs et d’administratifs qu’elles ont créés et financés par l’obtention de subventions. La capacité à rester innovant dans le champ du développement social repose non seulement sur la solidité du projet, mais sur le renouvellement des cadres, sur la reconnaissance de la part du partenariat local et sur l’appartenance à des réseaux extérieurs au quartier.
L’ensemble de ces conditions est rarement réuni. Citons par exemple une association particulièrement créative dont le renom dépasse son quartier d’origine, mais qui demeure un partenaire de second rang dans le DSU local. Il s’agit de l’association Nejma, créée par des étudiants en 1984 dans la ZUP des Canourgues à Salon-de-Provence où d’autres associations, l’une de femmes, l’autre de jeunes, sont apparues ensuite . La définition de son recrutement et de son objet par ses fondateurs instaure d’emblée une rupture avec les définitions traditionnelles : "essentiellement composée de Maghrébins, elle est complètement anti-communautaire", déclarait son président dans une interview de la revue Hommes et Migrations en 1991 ; cela ne fut pas clairement perçu par le milieu local pour qui un regroupement de Maghrébins ne pouvait être que communautaire , et créa un premier malaise. Animée par le projet politique de la nouvelle citoyenneté, cette association a fait du développement culturel l’axe principal de son intervention, à travers une certaine conception du soutien scolaire et des loisirs de la jeunesse, mais aussi en créant des événements tels que conférences de spécialistes de différentes questions, invitation d’associations d’autres pays, obtention d’une résidence d’écriture pour une écrivain qui a produit, avec les habitants, un livre sur l’histoire du quartier - toutes ces initiatives ayant pour cadre non seulement la ZUP mais sa partie la plus défavorisée par la politique ségrégative d’attribution des logements sociaux (8,7% de locataires étrangers, pour une moyenne d’environ 2% dans le reste du quartier, en 1982, la ségrégation n’ayant pas diminué par la suite). Cette stratégie n’a jamais été celle de la municipalité qui a plutôt fait en sorte que fonctionnent un centre social du côté des étrangers, et un centre culturel de l’autre côté du grand ensemble. Les actions de Nejma sont venues perturber ce traitement différentiel et, si elles ont eu un certain retentissement au-delà de la ville, elles n’ont pas pour autant permis à l’association d’être reconnue comme partenaire à part entière du DSU : elle a su se faire écouter par l’équipe opérationnelle et appuyer par la municipalité qui prend en charge le loyer de l’appartement attribué par l’organisme logeur, mais elle n’a jamais été associée aux choix stratégiques sur le développement social et urbain.
Dans cet exemple, comme dans d’autres, les pouvoirs locaux méconnaissent, s’il ne la craignent, la capacité d’innovation sociale des associations de quartier ; ils sont dès lors largement responsables du manque d’évolution et de la tendance au repli de ces groupes. Alors qu’elles avaient constitué des creusets de la mobilité sociale collective et individuelle, les associations créées par des jeunes des quartiers tendent à s’inscrire dans le syndrome de la relégation.
Le travail socio-éducatif a été une filière promotionnelle dans les années 80, qui a fait assez rapidement l’objet de plusieurs critiques, promotion bloquée à des niveaux intermédiaires et ethnicisation de la fonction notamment. Les permanents d’associations de quartiers, les animateurs et directeurs de centres sociaux sont souvent originaires non seulement de l’immigration mais des quartiers dans lesquels ils sont employés. Même titulaires de diplômes universitaires dans les sciences du développement local et de l’économie sociale, ils obtiennent rarement des postes de chefs de projet du développement social urbain. Autant leur connaissance des quartiers et des populations est valorisée dans les postes intermédiaires qu’on leur offre, autant leur "appartenance" d’origine joue en leur défaveur, implicitement bien sûr, s’il s’agit d’accéder à des statuts professionnels supérieurs. Ils tendent ainsi à constituer une population captive des quartiers qui ont été le terreau de leur mobilisation et de leur professionnalisation - captivité calquée sur celle des parents, selon un processus différent : la génération précédente n’a pas ou peu eu accès à d’autres filières de logement, celle-ci a peu ou pas accès à d’autres filières professionnelles que celle de l’encadrement social ou culturel de la population dont elle est issue. Cette rigidification de la mobilité socio-professionnelle est entretenue et rationalisée par l’enfermement dans une éthique de responsabilité perpétrée par un mélange de prestige local et de manque de clefs d’accès au monde extérieur, qui se renforcent mutuellement. Le quartier fonctionne alors comme espace-temps d’identification statique.
Comment casser l’emprise, et s’inscrire dans des processus créatifs ?
Trois voies se présentent. La première est dans la rupture avec les filières de promotion sociale ethnicisées, notamment par l’acquisition de diplômes de l’enseignement supérieur (qui ne sont pas en eux-même une garantie de s’extraire de l’emprise) et par les carrières artistiques ou sportives.
Les deux autres sont plus complexes parce qu’elles ne se coupent pas de la vie des quartiers mais en émergent.Toutes deux interviennent dans le champ politique, l’une du côté pratique et l’autre théorique.
Sur le plan pratique, l’animation des mouvements politiques de l’immigration qui a transcendé la vie associative des quartiers n’a dans la plupart des cas permis que des échappées et non de véritables sorties des quartiers ancrées dans des projets collectifs ou personnels ; d’autre part elle est volontairement restée circonscrite à "l’immigration", ce qui correspondait à la nécessité des années 80 mais aurait dû évoluer. Une pratique politique rénovée est apparue lors des dernières élections municipales à l’occasion de la présentation de listes essentiellement composées d’habitants (jeunes en majorité) des cités, ne mettant pas en avant les problèmes des immigrés mais les problèmes socio-économiques vécus massivement dans les quartiers populaires. Quels que soient les résultats obtenus par de telles candidatures, elles résultent des campagnes menées par nombre d’associations pour inciter les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales, et, moins directement, de la revendication du droit de vote des immigrés ; mais elles sont aussi porteuses d’une dimension nouvelle qui bat en brèche les discours sur l’intégration et en confirme le retard sur la réalité.
Sur le plan théorique, quelques militants, écrivains, universitaires, cinéastes, ont travaillé à l’analyse rétrospective des mouvements des années 80 et à celle de la situation actuelle, à la recherche d’orientations, qui pour la reconstruction d’un mouvement politique, qui pour l’épanouissement de la vie associative, qui pour la jonction avec les luttes contre l’exclusion, le chômage, le mal-logement... Cette réflexion composite, tout aussi importante que l’évaluation de la politique de la ville généralement faite du point de vue des administrations et des acteurs institutionnels, mériterait d’être mieux diffusée et étudiée parmi les professionnels du développement social urbain.
Un autre parcours : celui des femmes africaines dans la médiation
L’émergence de la fonction de médiation dans les quartiers de la politique de la Ville est liée à plusieurs aspects de l’évolution de la vie politique et des rapports sociaux des quinze dernières années, dont certains ont été décrits plus haut (abrogation du décret-loi de 1939, et naissance de la politique du développement social des quartier en 1981, marches pour l’égalité et mouvement politique de l’immigration) à quoi s’ajoutent des spécificités liées à la vague migratoire des femmes d’Afrique de l’ouest dans le cadre du regroupement familial, telles que la prise de parole de femmes africaines en France contre les mutilations sexuelles et la polygamie. L’immigration africaine, traditionnellement tournée vers le retour au pays s’est peu à peu ouverte à la perspective d’une meilleure insertion en France, les femmes et les enfants jouant là un rôle de premier plan .
Dans l’immigration originaire d’Afrique, les situations migratoires, familiales, sociales, les appartenances religieuses, associatives, les pratiques linguistiques, professionnelles, varient. Mais certains éléments expliquent le rôle moteur des femmes africaines dans la diffusion des expériences de médiation dans les quartiers.
Tout d’abord, la tradition familiale : les sociétés africaines sont encore très largement structurées autour d’une organisation sociale en familles élargies au sein desquelles les relations sont codifiées et hiérarchisées de façon très précise. Les groupes familiaux ont un rôle économique (de production, en zone rurale, et de redistribution quelle que soit la localisation et la source des revenus), un rôle de protection sociale (au sens d’assurance-maladie et d’assurance-vieillesse) à travers la solidarité constitutive et le dû des enfants envers les parents, et un rôle de régulation des conflits dans le cadre des conseils de famille où s’exerce de fait une médiation familiale. Dans le contexte migratoire, il peut y avoir une certaine déperdition de ces formes d’organisation sociale, mais elles restent néanmoins une référence de base pour la majorité des migrants et de leurs enfants. Partant, il nous semble que des médiatrices d’origine africaine sont susceptibles d’être écoutées et suivies, selon deux types de rationalisation : elles peuvent éventuellement avoir des liens de famille, même lointains, avec les intéressé(e)s ; ou bien elles peuvent être perçues comme un substitut acceptable de la médiation familiale, par des individus ou des familles dont la parentèle s’est distendue et qui se retrouvent un peu isolés.
D’autre part, au sein de ces groupes familiaux, les femmes ont une autonomie économique et financière, c’est à dire qu’elles peuvent posséder des biens en leur nom propre même si elles sont mariées, produire et commercialiser des biens, selon des modalités qui peuvent varier d’un endroit à l’autre, en fonction des appartenances, du rang, du statut matrimonial, de l’âge...Dans les sociétés rurales, cette autonomie se manifeste par la possession et l’exploitation de terres cultivables et de têtes de bétail dans les régions d’élevage. En milieu urbain africain, s’agissant de ruraux récemment arrivés des villages, les femmes poursuivent éventuellement une activité agricole de type maraîchage urbain le plus souvent, et/ou ont des activités commerçantes au marché ou dans la rue : vente de produits alimentaires et de tissus... Nous ne parlerons pas des groupes sociaux plus anciennement urbanisés pour lesquels l’accès à l’éducation, à l’emploi, à la ville moderne, suit les filières et les hiérarchies socio-spatiales du modèle urbain international. En milieu urbain français, la possibilité pour les femmes migrantes, de s’assurer un revenu par l’agriculture ou le commerce, disparaît, tandis que l’absence de moyens financiers, de réseaux de relations et d’entraide, de maîtrise du français bien souvent, rend hypothétique l’accès à l’emploi autre que domestique. Il y a donc recul de l’autonomie dans le processus migratoire.
Mais l’autonomie n’est pas seulement d’ordre économique : les relations entre femmes, les modes de sociabilité corollaires d’une conception de l’intimité entre l’homme et la femme sont différents des modèles occidentaux. Entre femmes, la parole circule sur tout ce qui concerne la vie de la femme, son corps, sa santé, ses enfants... certaines femmes étant plus que d’autres en position de donner des conseils ; et ce type de rapports se perpétue dans le contexte migratoire, les connaissances linguistiques et culturelles venant compléter l’aptitude au conseil conférée par le rang socio-familial. C’est ainsi que les médiatrices sont particulièrement bien acceptées par d’autres femmes, lorsqu’elles viennent se substituer au mari qui était parfois contraint de jouer le rôle d’interprète dans des situations gênantes pour les femmes.
Sur cette base, se sont constituées et développées des associations et, en leur sein, la médiation. Les fondatrices des associations sont des femmes actives, totalement impliquées dans les pratiques professionnelles, sociales, administratives qui ont cours ici, très conscientes des sources des difficultés d’adaptation que rencontrent d’autres femmes. A la différence des associations africaines dites communautaires, c’est à dire organisées sur la base villageoise ou régionale, elles sont multinationales dans leur recrutement, et concernées avant tout par l’amélioration des conditions de vie en France.
Très vite, puisqu’elles sont de création généralement récente, elles sont devenues des points de repère dans les quartiers. La solidarité féminine aidant, leur public n’est plus spécifiquement africain, mais de toutes origines ; les médiatrices des associations réunies par FIA-ISM (Femmes Inter Associations-Inter Services Migrants) pour élaborer une charte des médiatrices associatives, soulignent que la confusion qui pouvait être faite au début entre interprétariat et médiation n’a plus cours : elles exercent leurs fonctions de médiation aussi bien avec des Turques, sans posséder de langue commune.
Elles tendent à devenir une référence aussi pour les institutions : des écoles, des PMI, des hôpitaux, des centres de sécurité sociale font appel à elles pour débrouiller des situations complexes et surtout pour permettre le bon fonctionnement de services publics en passe d’être complètement déconnectés de la population qu’ils sont censés desservir.
Si l’on compare cette démarche avec celle des associations de jeunes envisagée plus haut, on retrouve trois caractéristiques communes : la volonté d’être acteur de la vie sociale, la capacité à traiter d’égal à égal avec les représentants de l’administration et des services publics, enfin le recrutement transnational et la préoccupation de l’émancipation citoyenne. Mais l’action des médiatrices se distingue de celle des autres associations en ce qu’elle est ciblée sur les services publics et qu’elle est assortie d’une tendance à la professionnalisation et d’une recherche de statut. Déjà les expériences les plus anciennes, comme celle du Havre, ont codifié la médiation, s’inspirant des métiers du social pour définir une déontologie comportant par exemple le respect du secret professionnel. Le prestige et la confiance dont jouissent les médiatrices tant auprès des services utilisateurs que des habitants aidés dans leurs démarches, incités à se faire connaître des enseignants de leurs enfants, accompagnés dans leurs visites médicales...les placent dans une position décalée par rapport à leur statut social. Elles deviennent par exemple des partenaires indispensables dans certaines PMI ou écoles, mais sans titre. Elles sont certes reconnues pour leurs compétences, mais avec le double risque d’une ethnicisation de la fonction et d’une cooptation individuelle dans les services municipaux ou autres institutions.
L’ethnicisation des actions de médiation peut avoir comme conséquence l’inverse de ce qui est attendu, si, au lieu de faire évoluer les agents des services vers une perception différente de leur clientèle étrangère, elle aboutit à un transfert de tout ce qui concerne cette clientèle aux médiatrices ; celles-ci deviennent alors des substituts informels des services publics dans les quartiers en difficulté.
La cooptation individuelle est déjà le fait de certaines municipalités et elle a été annoncée également par S. Veil, alors ministre de la Ville, qui avait proposé de financer 800 heures d’intervention de femmes-relais dans quinze départements prioritaires, pour mieux "valoriser la fonction d’intégration" qu’elles exercent. Dans ces cas de figure, la dynamique collective est niée et ce n’est pas par hasard que le terme de femme-relais remplace celui de médiatrice.
Les expériences de médiation apparaissent finalement comme susceptibles d’être mieux légitimées que les associations de jeunes par les partenaires de la politique de la Ville, au niveau local, mais avec de fortes pressions au détournement de leur objet et de leurs méthodes.
L’enjeu de la reconnaissance
Sans opter pour une voie populiste ni participationniste,on peut néanmoins se demander quels peuventêtre les moyens de faire mieux apprécier par les pouvoirs locaux les actions innovantes de développement tentées par des associations d’habitants, afin qu’elles soient amplifiées et que leurs promoteurs soient reconnus comme citoyens-développeurs. Les réponses sont sans doute à chercher dans des interventions extérieures, les situations locales étant évidemment médiatisées par des conflits personnels et politiques. Deux types d’intervention extérieure peuvent être utiles : celle de partenaires institutionnels de la politique de la Ville, et celle des chercheurs et évaluateurs.
Les missions de bons offices de partenaires institutionnels sont délicates dans une période où le besoin de redéfinir les rapports entre le centre et le local se fait nettement sentir. Un aperçu de ces difficultés peut être illustré par l’exemple du programme 50 quartiers dont l’évaluation est en cours.
Le Programme 50 quartiers, parrainé par la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Union des Fédérations d’Organismes HLM, et l’Etat (ministère de l’Equipement), a sélectionné 60 quartiers en difficulté dans toute la France, pour y promouvoir ou pour y appuyer des projets urbains. Renouant avec l’esprit de la première commission nationale pour le développement social des quartiers, ce programme a créé une équipe d’appui formée de neuf chargés de mission siégeant à Paris et responsables chacun d’un certain nombre de sites dans lesquels ils ont eu pour tâche de faciliter la constitution de maîtrises d’ouvrage concertées (collectivités locales, organismes logeurs, DDE, préfets, directions régionales de la caisse des dépôts) pour le montage et la conduite des projets. Les premiers résultats de l’évaluation montrent que l’utilité principale du programme et de l’équipe d’appui est d’avoir légitimé le rôle des organismes HLM dans la politique de la Ville, non plus seulement dans un rôle de bailleurs mais également de concepteurs et de monteurs de projets de transformation urbaine pour une meilleure intégration des quartiers défavorisés dans les villes. Les représentants de l’équipe d’appui ont été le mieux acceptés là où ils ont réussi à lever des blocages relationnels, notamment autour de la définition et du suivi d’études préalables impliquant une coopération entre les acteurs et supposant une écoute mutuelle. Ils n’ont pas totalement échappé à la suspiscion de parisianisme de la part des acteurs locaux, qui ont tout de même majoritairement souhaité que soit maintenue pendant une certain temps la participation d’un élément extérieur jouant un rôle d’impulsion et de régulation .
L’exemple de la conduite du programme 50 quartiers permet de reposer aujourd’hui la question de la place de l’Etat dans une politique de la Ville écartelée entre centralisme et décentralisation. A cet égard, la mutation sémantique de "développement social des quartiers" à "politique de la Ville", en passant par "développement social urbain" est porteuse d’une double dimension : la notion de développement est abandonnée, mais l’Etat se réapproprie l’articulation entre finalités et moyens qui constitue une politique ; qu’en fait-il cependant ? Quelle est cette politique ? Comment est renouvelé le rapport entre le centre et le local ? Pour l’heure, les réponses n’apparaissent pas clairement. Or certains acteurs locaux, (et là il s’agit plus des partenaires "officiels" de la polititique de la Ville tels les organisme logeurs que d’associations d’habitants), dont les municipalités entendent contrôler la participation, en opposant le "territorial" au "sectoriel", appellent de leurs voeux une régulation sinon une intervention de l’Etat.
Quant à la parole des chercheurs et des évaluateurs, de quel poids peut-elle peser dans les rapports locaux ? Parmi les travaux commandités par des collectivités locales, le résultat est souvent décevant, si les commanditaires ne sont pas prêts à se remettre en cause, et si les chercheurs ne parviennent pas à les impliquer dans le processus de production intellectuelle. C’est ce qui s’est passé autour de la réalisation d’un diagnostic de la situation des immigrés dans le pays de Montbéliard, demandé au groupe ACT-GISTI par les autorités du district de Montbéliard, en vue d’élaborer une charte pour l’intégration. La méthode que nous avions proposée, outre des entretiens individuels et un travail documentaire, reposait sur des groupes de travail thématiques devant être réunis trois fois pendant la durée de l’étude, et rassemblant des professionnels, des élus, des associations et des habitants ; ces groupes devaient pouvoir débattre de façon contradictoire sur les problèmes de logement, d’emploi-formation et de vie collective, et progresser vers la formulation d’éléments d’une charte pour l’intégration dans ces différents domaines ; la méthode, en même temps qu’elle apportait un matériau très riche aux chercheurs, préfigurait le partenariat qui, à notre sens, devait être constitué pour travailler sur une charte. Alors qu’elle avait été acceptée, cette modalité du travail a été arrêtée par le comité de pilotage de l’étude, après une seule réunion de chacun des groupes de travail, la raison avancée étant que les débats avaient été insuffisamment productifs et qu’il n’y avait rien à attendre d’autres séances de ce type. En fait les représentants d’associations d’habitants qui avaient participé s’étaient montrés satisfaits parce qu’ils avaient eu l’occasion d’exprimer des attentes et des idées face à des professionnels, dans une situation inhabituelle d’écoute, non seulement sur les thèmes des groupes, mais sur l’objet même de l’étude et sur l’idée d’une charte pour l’intégration, sur laquelle ils n’avaient pas été consultés auparavant. Cette nouvelle possibilité de dialogue occasionnée par l’étude avait également recueilli l’adhésion de travailleurs sociaux de terrain et de représentants de l’administration. En revanche les élus et professionnels chargés de la politique de la Ville dans le district avaient pris peur, moins devant le contenu des échanges verbaux occasionnés par la tenue des groupes de travail, que par le processus de concertation large qu’ils ouvraient et dont ils ne savaient pas quelles exigences de participation de la population ils engendreraient. Ils ont préféré confier l’élaboration de la charte à un "chargé de mission-intégration" embauché à cet effet.
* * *
Entre l’expérimentation du développement social des quartiers et la politique de la Ville des années 90, tout se passe comme si les intervenants des différentes administrations avaient intégré une fois pour toutes ce qu’ils convient de faire pour les habitants des quartiers en difficulté, ceux-ci ayant disparu de la scène, si tant est qu’ils y aient jamais figuré autrement que comme cobayes des dispositifs et miroirs des politiques mises en oeuvre. N’est-ce pas là qu’il faut chercher au moins une des explications de la faillite de l’intégration urbaine de ces quartiers, objet une fois de plus des voeux du nouveau gouvernement, après tant d’années, d’efforts et d’investissements ?
Patrick Viveret a analysé la réticence fondamentale de l’administration française à fonctionner autrement que selon la hiérarchie traditionnelle, la difficulté à se projeter dans la transversalité, comme la faiblesse principale de la politique de la Ville. L’autre grande faiblesse réside dans la crise de l’exercice de la démocratie et de la citoyenneté. Les projets menés dans les quartiers défavorisés mettent particulièrement en lumière les limites de la démocratie représentative et du concept d’Etat-Nation.
Les habitants de ces quartiers vivent la fragmentation, le repli individuel, communautaire ou sectaire, parallèlement à ce que Jacques Donzelot décrit comme l’effritement des "grands desseins" des trente glorieuses où le couple économique-social fonctionnait sur les valeurs antinomiques, mais complémentaires, de l’individuel et du collectif .
Les élus de quartier, les associations de locataires, ne représentent plus que le résidu de l’aristocratie ouvrière des quartiers, tandis qu’une part notable de la population résidente ne vote pas - les étrangers et souvent les jeunes, quelle que soit leur nationalité, quoique les dernières élections municipales aient vu l’apparition de listes de "jeunes des quartiers".
Les professionnels de l’urbanisme, du logement et du social réunis dans les équipes opérationnelles de développement social urbain ont été absorbés par les municipalités, et dès lors en défendendent la logique, au lieu d’agir comme l’interface de groupes (élus, logeurs, habitants, services de l’Etat et des collectivités) en principe appelés à coopérer pour définir et mener des projets.
Enfin, les organismes d’éducation populaire, les gestionnaires d’équipements socio-culturels sont de moins en moins en prise sur les aspirations des habitants des quartiers. Jacques Ion a décrit les travailleurs sociaux comme animés par la volonté d’apprendre aux populations à devenir autonomes . Or on n’apprend pas aux autres l’autonomie quand on est, de par sa position institutionnelle, dans un rapport à sens unique (donner, aider, enseigner...).
Faute d’une véritable politique de la Ville, on assise à un bricolage de procédures placées sous le signe de l’urgence et majoritairement cantonnées dans le traitement des symptômes. La contractualisation de ces procédures ne concerne que marginalement les habitants des quartiers qui restent objets du développement social urbain.
Leurs tentatives pour être reconnus comme acteurs du développement des quartiers se heurtent soit à la rigidité du jeu politique local, soit au front des institutions qui fondent leur raison d’être dans l’assistanat et la pérennité de la relégation, soit à la cooptation des énergies et des compétences dans un rôle de béquille des services publics locaux.
C’est contre cette tendance que se sont créées et développées les associations de l’immigration, les associations de jeunes et les associations de femmes. Si ce ferment associatif ("l’intellectuel organique" des quartiers populaires) n’est pas jusqu’à présent parvenu à faire évoluer de façon décisive les rôles ni les représentations mutuelles, il se trouve néanmoins aujourd’hui à un moment où il peut penser et agir de manière à transformer la reconnaissance de la compétence en reconnaissance sociale - de lui-même, et au delà, des habitants des quartiers comme sujets de leur destin.
Pour atteindre un tel objectif, cette démarche passe obligatoirement par la confrontation et la coopération : confrontation “ avec tous les autres acteurs intéressés à une transformation de la société ” dit Saïd Bouamama à propos du rôle des jeunes dans le changement, en appelant à un dialogue “ constitué de conflits qui obligent à prendre en compte tous les aspects des problèmes, et dont les dépassements ouvrent à des solutions sociales ” ; et coopération entre les habitants-acteurs et les “ travailleurs du front ”, c’est à dire, selon Monique Crinon, tous ceux que leurs fonctions professionnelles appellent dans les quartiers et “ qui se trouvent sur une ligne de front qui épouse de plus en plus étroitement la cassure profonde qui s’est opérée peu à peu dans notre société ”
C’est là un enjeu mal appréhendé de la politique de la Ville, susceptible de restaurer une dimension d’universalité, au delà des segmentations techniques qui occultent la finalité du droit à la ville.
Sonia Fayman