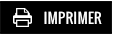La politique urbaine de la Banque mondiale dans les pays du Sahel
Publié par , le 1er septembre 2009.
Annik OSMONT
Laboratoire TMU (UMR CNRS)
GEMDEV
La politique urbaine de la Banque mondiale dans les pays du Sahel
Mondialisation / Métropolisation
La diabolisation du fait urbain a toujours été un thème dominant aux multiples facettes, jusqu’à notre époque très contemporaine. La littérature sur ce sujet est particulièrement abondante dans les périodes d’explosion urbaine et de fortes déstructurations / restructurations sociales. C’est le cas durant la deuxième moitié du XIXème siècle en Europe, un peu plus tard en Amérique, et plus récemment dans les pays en voie de développement en proie à des taux de croissance urbaine et d’urbanisation spectaculaires. La ville, c’est le mal : ce discours est récurrent, et les forts taux de croissance démographique des villes sont rendus responsables, en vrac, de l’habitat précaire, de la sous-intégration de la population urbaine, de l’importance du secteur informel , mais aussi de la délinquance, des trafics divers, de la corruption, de l’incompétence des autorités locales ; les citadins sont globalement identifiés aux "classes dangereuses" du XIX ème siècle , et les grandes métropoles font d’autant plus peur qu’elles échappent largement à tout contrôle.
D’un autre côté il faut reconnaître à certains courants universitaires, et à des organismes internationaux en charge du développement, le mérite d’avoir attiré l’attention sur l’importance du développement urbain, en raison de son lien direct avec le développement économique. La Banque mondiale inaugure ce nouveau discours au début des années 70. Elle légitimera fortement la nécessité d’intervenir dans le domaine du développement urbain parce que, pour elle, les villes sont la meilleure promesse d’efficacité économique.
Au fil des ans, la prise de position est encore plus nette, comme le dit l’ouvrage de l’OCDE sur Des villes pour le XXI ème siècle (OCDE poche, Paris, 1995), qui résume bien l’idée maintenant répandue : “ Creuset de civilisation, la ville est depuis toujours l’instrument et le produit du développement économique et social ”. Cette première proposition est suivie d’une seconde en apparence contradictoire : “ Mais ce lieu traditionnel d’échange et de solidarité concentre aussi la plupart des maux dont souffrent nos sociétés modernes : chômage, pauvreté, exclusion, criminalité, pénurie d’infrastructures et de services, atteintes graves à l’environnement ”. Le meilleur y côtoie le pire, le raisonnement est donc bien récurrent depuis le XIX ème siècle. Mais, à la différence des périodes précédentes, la ville est essentiellement considérée comme instrument du développement, économique et social, le social étant vu plutôt comme le champ d’une nécessaire régulation des conflits et mouvements sociaux en vue d’améliorer la contribution des villes à la formation de la richesse nationale.
Cette instrumentalisation de la ville en vue d’une croissance économique soutenue va marquer de proche en proche toutes les politiques d’aide au développement urbain, qu’elles soient multilatérales, régionales ou bilatérales. L’objectif est de rendre les villes plus productives : il s’agit aussi bien d’en améliorer les grandes infrastructures pour les rendre plus attractives aux investisseurs, que de mieux intégrer les populations urbaines à la fois sur le plan économique, en essayant de faire passer leur dynamisme économique du secteur informel au secteur formel, et sur le plan social, en agissant prioritairement sur deux secteurs-clés : la santé et l’éducation. En effet, une population urbaine mieux soignée, mieux nourrie et plus instruite est plus performante, donc plus productive. Et l’on a pu constater à maintes reprises que le thème de la crise urbaine intervient, là aussi de manière récurrente, pour légitimer des politiques et projets de restructuration urbaine.
A la lumière de ce bref éclairage, on comprend que c’est moins le fait d’une urbanisation croissante et parfois explosive qui a posé problème, que la nature des mécanismes de cette urbanisation, liée à la croissance économique, et des réponses qui ont été apportées soit par les pouvoirs publics, soit -et surtout - à travers l’aide au développement urbain, dans ses caractéristiques institutionnelles, financières et techniques. Dans les faits, force est toutefois de constater que l’intérêt pour les villes se déplace constamment du champ social (au sens large), vers l’économique, à mesure que la pensée libérale devenait prédominante et que s’installait dans la pratique un libéralisme sans contrainte, et la prééminence, à l’échelle mondiale, des lois du marché.
Plus récemment, on constate encore un changement de donne dans les processus d’urbanisation, en liaison avec ce que l’on désigne par la mondialisation accélérée de l’économie, qui renforce encore le déséquilibre au profit de la seule dimension économique, ce qui fait qu’on peut réduire la première proposition de l’OCDE à celle-ci : “ La ville est l’instrument et le produit du développement économique ”. Dès lors, comme de coutume dans la pensée libérale, il faut voir comme une sanction de la mauvaise gestion des villes l’apparition, voire le renforcement, des maux mentionnés ci-dessus, qui se trouvent ainsi déconnectés des facteurs – économiques notamment – qui les ont engendrés. Ces facteurs négatifs sont externalisés, en quelque sorte, par rapport à la sphère économique qui, elle, se trouve exemptée de tout soupçon d’incapacité à résoudre les problèmes de développement.
Examinons d’un peu plus près la réalité, afin de montrer que, là encore, c’est moins le fait de l’urbanisation croissante qui pose problème, que la nature des mécanismes récents d’évolution des villes, qui sont dans une forte dépendance à l’égard de la mondialisation comme forme la plus récente de l’économie libérale ; et, là encore, il s’agit de montrer que ce qui pose problème, c’est la manière dont sont abordés les problèmes urbains de la mondialisation, et leur résolution.
La plus spectaculaire évolution à laquelle nous assistons depuis une quinzaine d’années, c’est la mutation que connaissent un certain nombre de villes, dans un processus de métropolisation lié à la mondialisation. Et la question que nous nous posons face à cette évolution est celle de la modernité, d’une modernité universelle, urbaine, identique à Dakar et à New-York, à Djakarta et à Milan.
La métropolisation, produit ancien et actuel de la mondialisation dans les PED.
Un constat s’impose, en grande partie partagé par un nombre croissant de chercheurs (en dépit de la relative faiblesse des recherches menées sur ces phénomènes, concernant les PED) :
le processus de mondialisation a des effets directs sur l’urbanisation, car il renforce les processus de métropolisation.
Il faut toutefois souligner que ce mécanisme n’est pas récent, comme on peut l’analyser dans des pays ayant fait l’objet d’une colonisation et donc d’une certaine forme de mondialisation, notamment au XIXème siècle. Sous sa forme contemporaine et selon l’actuelle acception du terme, le processus de métropolisation est souvent plus ancien qu’on le dit couramment, et, surtout, il est le fait de créations exogènes, parce que la décision est imputable à la "métropole". Pour s’en tenir à l’Empire français, il en est ainsi de Dakar, souvent prise en exemple, puisqu’elle fut pendant plus de soixante ans, et à juste titre d’ailleurs, "La métropole ouest-africaine" , extension du pouvoir de la France en Afrique, et lieu de l’administration coloniale à l’échelle d’une région. Sur une presqu’île habitée par quelques villages de pêcheurs Lebou, Dakar, dès la fin du 19ème siècle, a été créée de l’extérieur comme ville de commandement, et rapidement métropolisée par la puissance coloniale. Cette décision était judicieuse d’ailleurs, puisque Dakar présentait des atouts géographico-économiques incontestables constituant des avantages comparés importants à l’échelle internationale d’alors, et qui devaient insérer la ville dans une configuration internationale avantageuse pour la métropole, mais aussi dans un système d’échanges plus vaste : Dakar fut pendant la première moitié du 20 ème siècle le seul port en eau profonde de toute la côte ouest africaine ; lors du développement de l’aviation civile, Dakar fut le lieu d’escale obligé entre l’Europe et l’Amérique latine, jusqu’à l’arrivée des gros porteurs. De ce fait, la France a installé sur place plusieurs bases militaires : navale, aérienne, terrestre, qu’elle conserve toujours en dépit de - ou à cause de ? - l’indépendance accordée à la colonie en 1960. De même l’ancienne métropole coloniale y tient encore l’ensemble des installations de contrôle aérien, civil et militaire, de l’ouest africain. Très vite, un statut municipal fut accordé à Dakar en 1884, qui érigeait la ville en commune de plein exercice. Pour bien marquer le caractère fonctionnel métropolitain de Dakar, c’est la ville de Saint-Louis qui devint la capitale de la colonie. Il s’agissait donc bien d’un acte totalement volontariste, matérialisé par un effort public important qui a marqué fortement l’organisation de l’espace jusqu’à maintenant : le premier plan d’urbanisme date de 1867, le début du 20ème siècle voit la création d’infrastructures dans des domaines variés : portuaires, routiers, mais aussi dans les domaines du logement, de l’éducation et de la santé. Pour mieux gouverner la métropole, il fallait des relais locaux. Il s’agissait de former des élites africaines, gestionnaires et politiques, et, pour certaines d’entre elles, de stature internationale - ce qui fut fait d’ailleurs . Des mécanismes d’intégration sociale à la modernité urbaine ont fonctionné à différents niveaux, faisant notamment la réputation de la main d’oeuvre de production dakaroise.
Cependant ce mode d’urbanisation, lié à une forme historique de mondialisation, a eu aussi des effets indirects dans la durée, qui ont fait l’objet de nombreuses analyses et recherches : une croissance urbaine qui est devenue à tous points de vue explosive, notamment à partir des années cinquante, une macro-céphalie déséquilibrante pour le pays (Dakar a représenté jusqu’à 25 % de la population du pays), l’apparition des maux urbains habituels, faiblesse du secteur formel de l’économie, gonflement pléthorique et continuel du secteur informel d’activité, fort développement des bidonvilles et de l’habitat irrégulier, sous-intégration croissante des populations urbaines dans les domaines de la santé et de l’éducation notamment, appauvrissement des mécanismes de gestion urbaine marqués par un abandon progressif de larges zones périphériques pour concentrer les quelques moyens existants sur la ville utile.
Tant que la croissance a été présente, peu de critiques ont été formulées concernant la maîtrise plus qu’incertaine du développement urbain, et l’aide extérieure, dans les années soixante, a plutôt visé un rattrappage d’équipements d’infrastructure, notamment dans les domaines du transport - terrestre, maritime, aérien - et du logement, qu’une structuration des capacités locales de gestion urbaine. On était, y compris après l’indépendance, dans un système très centralisé. Dans les années 70, des projets d’aménagement physique, financés notamment par la Banque mondiale, ont tenté de donner un second souffle à la métropole ouest africaine, pour l’ouvrir de manière modernisée à la mondialisation néo-libérale. Projet de Zone franche industrielle, projets agro-industriels et touristiques, projets de réhabilitation de l’habitat, importants en volume (citons notamment le projet d’aménagement de 11000 parcelles assainies dans la zone de Pikine), on visé à reconfigurer la métropole.
L’échec à peu près complet de ces grands projets a été porté au compte de leur mauvaise gestion par les responsables locaux. La critique est donc restée dans les limites de la gestion des projets de développement urbain. C’est lorsqu’a été mis en place l’ajustement structurel, sous-tendu par les objectifs de réforme économique et institutionnelle, que les projecteurs ont été braqués avec vigueur sur la gestion urbaine et ses profondes déficiences 4 .
La mondialisation contemporaine, parce qu’elle vise la généralisation de l’économie de marché, et parce que cette prééminence des lois du marché se traduit par une course effreinée à la rentabilité et donc à la productivité, obtenues par de drastiques restructurations économiques et territoriales, pèse fortement et de nouvelle manière sur le mouvement de métropolisation, qui est le résultat d’une très forte concentration des moyens et des facteurs de production dans un certain nombre de villes. La mondialisation renforce et accélère considérablement le processus de métropolisation. La recherche quasi-obsessionnelle de l’efficacité sous-tend cette accélération, et entraîne corrélativement une augmentation du taux d’urbanisation dans tous les pays. Les villes -grandes - deviennent le lieu espéré de la nouvelle modernité, et accueillent les facteurs les plus utiles au développement ; cela implique forcément une accélération des mécanismes de concentration urbaine, pour offrir de nouvelles économies d’échelle et des avantages comparés aux grandes firmes internationales, ainsi qu’une promesse de paix sociale. Je ne m’attarderai pas sur la description de ces processus. D’autres l’ont fait 5 .
Les dérapages de la mondialisation / métropolisation dans les PED.
Un autre constat s’impose :
ce double mouvement de métropolisation dans la mondialisation a renforcé de manière spectaculaire les inégalités entre le Nord et le Sud depuis que le néolibéralisme a submergé l’économie. De manière plus spécifique, la pauvreté urbaine s’est considérablement alourdie non seulement dans les PED depuis le début des années 80, mais aussi dans les pays dits émergents depuis quelques années 6 . Et bientôt il n’y eut plus d’autre alternative que, dans une fuite en avant débridée, d’essayer de faire entrer à marche forcée les pays pauvres dans ce mouvement de mondialisation, celui des grands groupes et des marchés financiers, dans l’idée que la généralisation de l’ouverture des marchés serait bénéfique aux pays pauvres. Les métropoles ont de nouveau monopolisé l’intérêt des grands investisseurs, et des politiques urbaines d’appui ont été élaborées. Le critère de l’efficacité sociale est venu doubler celui de l’efficacité économique : à la mondialisation il convient de fournir des populations urbaines mieux soignées, mieux éduquées et mieux intégrées à la ville (par le logement et les infrastructures), donc plus productives. L’hygiénisme du XIXème siècle est toujours présent.
Mais cette mondialisation / métropolisation se réalise dans des conditions de très forte instabilité qui perturbent, souvent dans le court terme, les modes d’urbanisation et de gestion urbaine, qui eux, normalement, se déroulent et visent le moyen et le long terme. Par rapport aux périodes précédentes de la mondialisation, la temporalité de la croissance économique s’est fortement contractée, en raison notamment de la volatilité des marchés financiers globalisés. Ceci est une grande difficulté, dont la soudaineté a pris en défaut bien des responsables : en raison de brutales et profondes crises financières à répétition qui affectent les grandes métropoles, c’est l’ensemble du processus d’urbanisation qui est voué à la précarité dans les villes, et cela concerne toutes les couches de la société urbaine. La métropole de Saô Paulo, dans un pays où le pouvoir d’achat a diminué en moyenne de 5 % en quelques mois, a perdu, en quelques jours au début de 1999, 15 000 travailleurs dans le seul secteur de la construction automobile. En Asie, de l’Est et du Sud, un phénomène s’est répété de manière inquiétante année après année : aux "bulles foncières" succèdent des crises immobilières ravageuses, et de nouvelles formes de pauvreté urbaine affectent même les classes moyennes économiquement et socialement favorisées. La situation de Djakarta, après la crise qui a sévi dans le Sud-est asiatique en 1997-1998, a fait la "une" des medias, avec ses cohortes d’anciens riches ruinés du jour au lendemain, et de nouveaux pauvres.
Face à des Etats affaiblis, à la fois parce qu’ils ont le plus souvent fait la preuve du caractère prédateur de leurs dirigeants, et parce qu’ils dépendent du fonctionnement de marchés financiers dont la rationalité échappe au commun des mortels, la société urbaine adopte généralement deux types de réaction, qu’on peut analyser par référence à Albert O. Hirschman 7 : des émeutes parfois violentes - les émeutes de la fain - ou des mouvements sociaux plus ou moins organisés d’expression syndicale et/ou politique, constituent la réaction de "prise de parole" de ceux qui avaient jusqu’alors été considérés comme des agents économiques individualisés et indifférenciés ; par ailleurs de manière concomitante ou non, on voit la société urbaine se réorganiser pour inventer des mécanismes de survie, notamment à travers des réseaux commerciaux et des circuits de crédit informels et internationaux, échappant largement au contrôle de l’administration douanière et fiscale, lorsqu’il ne s’agit pas d’activités connectées avec la délinquance. Ces situations expriment bien ce que Hirschman appelle la "défection" ("exit"), particulièrement nette lorsque ces activités donnent lieu à un absentéisme important des salariés du secteur formel, et des fonctionnaires notamment 8 . C’est la société contre le néo-libéralisme. Cela représente plus de la moitié de la population urbaine, dans les métroples des PED secouées par les crises financières à répétition. Nous sommes ici dans des formes de dissidence sociale par rapport à l’Etat et au contrat de citoyenneté, proche de la marginalisation délinquante. Ou bien encore, en Amérique latine par exemple, certaines couches aisées, en créant des quartiers privés, se sont mises en situation de quasi-dissidence par rapport à la ville.
La configuration d’une métropole comme Dakar est fortement marquée par cette évolution : les associations de commerçants mourides ont su porter leurs activités économiques sur la scène internationale, en profitant de l’abandon par le gouvernement, en 1986, de sa politique de protection des produits manufacturés sénégalais. Le marché Sandaga du centre ville est devenu un pôle économique, peut être le plus important du Sénégal, car il est la tête de pont d’une diaspora puissante, bien contrôlée par la ville sacrée de la confrérie mouride, Touba. Forte de quelques 300 000 habitants, cette ville, devenue la deuxième du Sénégal, se développe comme une sorte de métropole, puissante économiquement, lieu de contrôle des activités des réseaux commerciaux, et de commandement des communautés mourides à l’étranger, capitale spirituelle des membres de la confrérie. Ville-métrople privée, qui se développe en dehors du contrôle des autorités nationales 9.
Même si ces phénomènes ne recouvrent pas toute la réalité sénégalaise, ils contribuent de manière notable à l’affaiblissement de l’Etat, qui ne constitue plus qu’un pouvoir parmi d’autres, alors qu’il y avait, dans les années soixante, des promesses de modernité auto-construite, mais insérée dans une modernité universelle.
La politique urbaine de la Banque mondiale
Dans cette nouvelle donne, on peut faire un troisième constat :
Dans ces mécanismes de mondialisation / métropolisation, les règles du jeu sont définies très largement au niveau multilatéral.
Il existe bien une gestion néo-libérale de la ville, qui est d’origine externe.
Plus que jamais, le développement urbain est vu comme un aspect sectoriel du développement économique, et les organismes d’aide au développement, au premier rang desquels on trouve la Banque mondiale, ont progressivement mis au point des stratégies d’intervention sur la ville, dans la recherche renouvelée d’efficacité maximum. La recherche de cohérence avec les objectifs économiques a ainsi conduit la Banque à élaborer un modèle de développement urbain à vocation universelle, proposé - ou plutôt imposé en vertu de la conditionnalité de l’aide - comme le seul possible, fondé sur la définition de priorités répondant aux critères d’efficacité économique. Ces choix requièrent notamment un renforcement de la métropolisation de certaines villes, vues comme pôles privilégiés d’échanges et de production de richesses, donc comme supports nécessaires de la croissance.
Cependant, en vertu du principe selon lequel les règles du marché s’appliquent, et tout de suite, à tous, et rend nécessaires des réformes en profondeur - l’ajustement structurel -, ce mouvement s’inscrit dans le court terme de projets élaborés selon un "format" identique qui nie par force le temps long de formation et de transformation des sociétés urbaines, et l’opacité de leurs structures singulières. La Banque en est réduite à construire une réalité idéale et abstraite à partir d’un imaginaire social... et politique. Sa spécificité est de contribuer largement à la construction d’une utopie, celle du capitalisme néolibéral, dans laquelle la ville et ses habitants sont complètement instrumentalisés. La modernité est construite a priori en fonction des exigences du marché.
Active dans l’élaboration doctrinale, la Banque apporte ainsi sa contribution à l’idée d’une connexion entre mondialisation et métropolisation. Cette conception s’est encore renforcée dans les années 90, à l’époque où, manifestement, les thèses de l’économie institutionnelle l’ont semble-t’il emporté. L’accent a de plus en plus été mis sur les réformes institutionnelles dans l’ajustement structurel ; en particulier le concept de "governance"- urbaine notamment - a fait l’objet d’importantes analyses, largement diffusées à partir de 1990 .
Au niveau de la mise en oeuvre de la doctrine, la Banque mondiale a également élaboré un modèle d’intervention adapté à la nouvelle donne économique et urbaine. A la base de ce nouveau modèle opérationnel est fait le constat qu’il n’y a pas de marché sans Etat, et donc sans des instruments solides de gestion des villes. Le rôle de l’Etat continue en effet d’être essentiel dans la production des "publics goods", ce que nous appelons les services publics, urbains en l’occurence. Mais l’Etat, à tous ses échelons territoriaux, doit être modernisé, profondément réformé, donc ajusté. Les programmes d’ajustement structurel mobiliseront jusqu’à 30% des prêts et crédits de la Banque mondiale dans les années 80. Dès lors on voit se mettre en place, autant que faire se peut, des instruments d’une "governance" à l’échelle nationale, et, selon un système de hiérachies administrées, à l’échelle locale, tout particulièrement pour une gestion efficace de la ville. La décentralisation devient une des expressions opérationnelles majeures de ce mouvement. Elle va jusqu’à la privatisation des services urbains, la mise en place ou le renforcement d’un cadre institutionnel de gestion urbaine - budgétaire notamment -, en privilégiant les grandes métropoles économiques susceptibles d’attirer les investisseurs.
Cette vision du développement urbain, qui transpose à la ville le modèle de la "corporate governance" (le gouvernement d’entreprise), s’est encore affinée récemment, pour systématiser encore un peu plus la démarche proposée par la Banque, à laquelle elle souhaite associer l’ensemble des bailleurs de fonds 10 . Dans ce document de référence, il est souligné que le but de cette stratégie renouvelée est "de promouvoir des villes durables qui remplissent la promesse du développement pour leurs habitants - en particulier en améliorant la vie des pauvres et en promouvant l’équité - tout en contribuant au progrès du pays pris comme un tout". Plus que jamais, le développement urbain devra être vu dans un cadre de développement global à l’échelle nationale 11 : "Ce qui arrive dans les grandes villes du monde en développement a d’importantes implications pour concevoir les objectifs de la Banque mondiale de promotion de l’économie de marché, de construction d’institutions durables, et de protection de l’environnement". La stratégie d’appui au développement se déclinera en quatre volets :
la recherche d’une ville vivable ("livabilty") ;
la recherche de compétitivité de la ville ("competitiveness") ;
l’amélioration de la gouvernance et de la gestion urbaines ("good governance and management ;
l’objectif de "bankability", i.e. l’amélioration du système des finances locales.
En réalité ces quatre éléments ne se situent pas au même niveau dans cette démarche stratégique : le premier est un objectif de développement durable, de caractère néo-libéral bien entendu, alors que les trois autres sont en fait des pré-requis pour l’atteindre, avec toutes les contraintes que cela implique12. Mais on ne peut manquer de souligner que, dans cette démarche imposée de l’extérieur, seule un petit nombre de villes, même parmi les métropoles, peuvent présenter de tels critères d’éligibilité à l’aide au développement urbain.
Plus largement on a oublié une chose dans cette belle épure, c’est qu’il ne peut pas y avoir de marché sans citoyens, et donc sans citadins. On l’a si bien oublié, à la Banque mondiale et ailleurs - à la Commission européenne et dans les agences de coopération bilatérale -, qu’on s’est satisfait d’une technicisation totale du champ politique, au nom de l’ajustement structurel et des réformes institutionnelles qui sont au coeur du dispositif. Même les instances qui ont en charge la discussion à l’échelle mondiale des grands choix politiques, le G7 au premier chef, semblent avoir démissionné de leurs responsabilités primordiales. Or la prise de décision au nom de la seule et prétendue expertise économique, et au nom d’un modèle utopique né d’une économie a-politique, compromet grandement les chances d’une gestion urbaine qui prenne en compte les réalités historiques et anthropologiques, qui ont fait et défait la cité. On a favorisé le mouvement du haut vers le bas, et on a pensé que le peuple suivrait. Parce qu’on a parlé de transparence, de responsabilité, d’équité et de lutte contre la pauvreté, on a pensé que l’on créait le cadre de la démocratie universelle, à l’image d’une économie performante parce que libérée des contraintes. Nombreux sont ceux, à la Banque mondiale et ailleurs, qui font ce rêve, qui bâtissent cette utopie, d’une governance qui serait le modèle de gouvernement, transparent, efficace, économiquement et socialement, dans des ensembles - qu’ils soient territoriaux ou en réseau, continus ou en archipels - d’où sont absents les clivages et les conflits ; on a voulu produire des ensembles constitués d’agents économiques rationnels....Le politique sans la politique. C’est ce qu’on a appelé, au début des années 90, "le consensus de Washington"13 , remis en cause récemment par certains économistes au sein de la Banque mondiale, qui réclament une attention plus soutenue à l’égard des problèmes sociaux du développement, et un développement démocratique, tout en continuant à soumettre les actions entreprises à ces deux titres à la logique d’ensemble du marché, qui, elle, n’a pas changé d’un iota. Mais même dans ces étroites limites, cet épisode a conduit J. STIGLITZ, Vice-président et senior économiste à démissionner fin 99.
Conclusion
On comprend que si le mouvement de métropolisation lié à la mondialisation n’est pas récent, il revêt des caractéristiques nouvelles dans le cas des pays en développement et émergents ; en effet à travers l’instrumentalisation de la ville, canibalisée par le marché, la métropolisation contemporaine est un des outils opérationnels considéré comme le plus efficace par les forces du marché, relayées par les institutions d’aide au développement, pour renforcer et accélérer le processus de la mondialisation néolibérale. La géostratégie a largement quitté le terrain de l’économie politique pour celui de l’économie a-politique de l’ère néo-libérale. La "démocratie de marché", selon une terminologie actuellement en vogue, substitue aux citoyens et à leurs représentants des actionnaires soucieux de la défense de leurs seuls intérêts privés.
La ville, elle-même objet d’ajustement, est insérée dans les dispositifs de l’ajustement structurel global, et la maîtrise du développement urbain par la maîtrise institutionnelle du fonctionnement des villes devient un enjeu majeur. On tente d’appliquer à la gestion urbaine le modèle de la "corporate governance", une des expressions de cette "démocratie de marché". Les politiques urbaines s’installent elles aussi dans la sphère de l’économie a-politique, et la bonne gestion urbaine est la bonne gouvernance locale (y compris dans le traitement social de l’ajustement) qui donne les instruments d’une bonne compétitivité et de bonnes perspectives financières.
Une question centrale se pose alors : est-il inéluctable de ne penser la mondialisation que comme un processus lié au déploiement du néo-libéralisme ? faut-il absolument lier cette forme de la mondialisation et la métropolisation, celle-ci étant réduite à une fonction de la mondialisation ainsi conçue ? Le choix fait de la dictature du marché le requiert. Mais les douloureuses expériences récentes montrent qu’on ne peut miser à long terme sur un tel mode de développement qui ne retient en fait dans la durée qu’un petit nombre de métropoles toutes situées dans les pays les plus développés, et qui ne concerne dans leur périmètre qu’un fragment restreint de l’espace métropolitain. On a vu récemment la fragilité d’un tel système pour le développement urbain.
Le développement de mouvements identitaires, sectaires, qui revendiquent des modèles communautaires comme voies d’une modernité dissidente, peuvent de manière salutaire, obliger à une renouvellement de la réflexion sur ce que doit être la "cité". Dès lors l’utopie, si elle est nécessaire, ne peut être qu’une utopie refondatrice de contrat social, construite politiquement, donc démocratiquement, et moins soucieuse d’efficacité économique que de ne pas laisser le long du chemin des pans entiers de la société urbaine. Les villes ne peuvent pas exister sans citadins, c’est la base du contrat d’urbanité et, plus largement, de celui de citoyenneté.