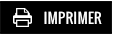Analyse des économies de marché. Bilan et nouvelles perspectives - Hervé Defalvard
Publié par , le 13 mars 2007.
Nos travaux sur l’histoire des théories du marché (1) nous ont amené jusqu’à Walras et son marché généralisé, auquel il faudra plus d’un relais pour connaître son point d’achèvement, constitué par le modèle Arrow-Debreu du marché. Ce dernier composa la référence initiale à partir de laquelle nos recherches sur l’analyse des économies de marché se sont développées. Dans une première section, nous exposerons nos études qui ont à la fois dressé un bilan et interprété les débats contemporains sur le marché puis, dans une deuxième section, nous présenterons nos recherches qui, avec d’autres et le plus souvent à leur suite, poursuivent le but de renouveler l’analyse des économies de marché en développant une micro-économie hétérodoxe des marchés.
LES DEBATS CONTEMPORAINS
Notre analyse des débats contemporains sur le marché accepte deux points de départ et, ce faisant, se dédouble selon celui qui est adopté. Elle dresse une typologie des travaux sur le marché lorsqu’elle les profile par rapport au modèle Arrow-Debreu du marché (3), (7) et (12). Différemment, elle les interprète comme autant de tentatives visant à reconnaître et reconsidérer un objet exclu du champ d’analyse par le modèle Arrow-Debreu du marché, à savoir le collectif et sa dimension propre de partage, lorsque son point de départ est constitué par les leçons tirées de nos travaux sur l’histoire des théories du marché (2), (11), (13).
Typologie des recherches récentes
Nous avons classé les recherches qui, depuis trente ans, pensent le marché, en trois catégories selon le rapport qu’elles nouent avec le modèle de base du marché, celui de Arrow-Debreu. Au dedans de ce modèle, nous avons enfermé les extensions puis, au delà de ce modèle, nous avons regroupé les révisions et, enfin, au dehors de ce dernier, nous avons réuni les contestations (12 : 213). Pour comprendre notre classement, il convient de rappeler en bref les caractéristiques du modèle Arrow-Debreu. Il s’agit d’un modèle d’équilibre général concurrentiel, (EGC), qui rend compte d’une économie de marché composée d’un grand nombre de biens auxquels correspondent autant de marchés. Sur ces marchés nous avons également un grand nombre d’offreurs et de demandeurs qui peuvent être soit des entreprises, soit des consommateurs dont les offres ou demandes résultent d’un calcul de maximisation, du profit sous contrainte technique pour les premières, d’utilité sous contrainte budgétaire pour les seconds. L’équilibre général correspond à tout ensemble de prix qui annulent, sur chacun des marchés, la demande nette. Il est concurrentiel car les prix sont des données anonymes pour les calculs individuels. Le programme de recherches du modèle Arrow-Debreu tient dans l’étude des propriétés de ces états particuliers que sont les équilibres, principalement leur existence, leur stabilité et leur efficacité. Dans sa version la plus sophistiquée, ce modèle contient un ensemble complet de marchés contingents, au comptant et à terme.
Les extensions vont conserver le cadre de l’EGC et, dans ce cadre, tenter notamment de lever le coté extrêmement centralisé du marché dans le modèle Arrow-Debreu. Les révisions vont abandonner l’analyse en termes d’équilibre général et l’hypothèse du comportement concurrentiel des agents, et ne conserver que celle de comportement rationnel au sens de la maximisation sous contrainte d’une fonction objectif. Enfin, les contestations rejettent aussi l’hypothèse de comportement rationnel au sens néoclassique, inadapté, selon elles, à l’étude des économies de marché. La présentation plus détaillée de cette typologie sera pour nous l’occasion privilégiée de mentionner les sources qui ont fécondé nos travaux sur les économies de marché.
Les extensions du modèle Arrow-Debreu
Chacun reconnaît que l’existence d’un EGC, tout au moins son interprétation, dans une économie de marché de type Arrow-Debreu est soutenue par un processus extrêmement centralisé, connu sous le nom de tâtonnement walrasien. De plus, à ce cette première limite, la nécessité d’admettre un système complet de marchés en environnement incertain, ajoute au modèle un manque total de réalisme. Il est alors possible de répertorier deux séries d’extensions visant à améliorer, sur l’un de ces points, le modèle de base (12).
La première série regroupe les travaux qui ont tenté de remédier au caractère centralisé du marché. Nous avons distingué, d’un côté, les modèles à prix fixes qui ont montré les conséquences , au sujet de l’équilibre général, des délais nécessaires à l’ajustement des prix (Bénassy 1982) et, de l’autre côté, les modèles à équilibres conjecturaux pour lesquels le crieur walrasien ne propose plus, à la place des agents, les prix (Hahn, 1978).
La seconde série réunit les travaux qui ont relâché l’hypothèse, lorsque le modèle est temporel, d’un système complet de marchés à terme. Dans cette ligne de recherches, pour la plupart des biens, à l’exception notable de la monnaie, il n’existe plus de marchés à terme. Les marchés au comptant de ces biens devront, dans les périodes futures, être réouverts. Le système de marchés devient incomplet. Les agents , pour arrêter leurs plans à une date donnée, font alors des anticipations sur les prix des marchés qui seront réouverts dans les périodes futures. L’EGC devient un équilibre temporaire dans l’hypothèse d’un horizon fini (Grandmont, 1982), et par le biais de générations d’agents qui se succèdent les unes aux autres sans fin, ces modèles aboutissent aux équilibres à générations imbriquées (Brock, 1990). A la croisée de ces modèles, nous trouvons la notion d’équilibre à anticipations rationnelles (Radner, 1982).
Les révisions
Elles dépassent le modèle Arrow-Debreu par l’introduction d’un élément qui lui est étranger, dont il se protège pour sauvegarder son univers concurrentiel, à savoir la dimension stratégique des comportements individuels sur les marchés. En raison de la spécificité des stratégies selon les marchés, l’analyse ici porte sur des marchés particuliers et abandonne la démarche de l’équilibre général. Le dépassement proposé s’accompagne cependant de continuités. D’une part, l’intégration des stratégies des acteurs ne modifie pas le type de rationalité individuelle envisagée, au sens où elle demeure un calcul de maximisation sous contraintes. D’autre part, le modèle Arrow-Debreu du marché est conservé comme référence normative. Ainsi, les révisions du modèle Arrow-Debreu du marché se conçoivent comme son dépassement, au sein duquel ce dernier devient un cas très particulier.
Sans développer chacune exagérément, nous avons distingué deux types de révisions : celles apportées par l’économie des contrats et celles apportées par la nouvelle économie industrielle qui, en dépit de zones communes, se distinguent au niveau des stratégies qu’elles considèrent. L’économie des contrats intègre les stratégies qui se développent au sujet de l’information détenue par les agents, et étudie notamment les phénomènes de hasard moral, de sélection adverse et d’incomplétude des contrats (Holmstrom et Hart 1987). La nouvelle économie industrielle renouvelle pour sa part, en utilisant les concepts de la théorie des jeux non coopératifs, l’étude de la concurrence imparfaite (Tirole, 1988).
A cheval entre les extensions et les révisions, nous ne devons pas oublier de mentionner un ensemble de travaux sur l’équilibre général en concurrence imparfaite, dont les difficultés analytiques demeurent à ce jour importantes (Gary Bobo, 1988).
Les contestations
Notre travail jusqu’ici n’a pas consisté à rendre compte de manière exhaustive des approches du marché qui s’offrent comme des alternatives à la démarche néoclassique qui, commune à la fois aux extensions et aux révisions du modèle Arrow-Debreu, prête aux agents une rationalité maximisatrise et approche les marchés dans les termes de l’équilibre. Plus modestement, et suivant un fil analytique, nous avons recensé les travaux qui ont volontairement quitté le paradigme néoclassique sur la question de la rationalité. Deux modalités ont été envisagées pour échapper aux fers de la rationalité néoclassique : celle de la rationalité limitée et celle de la rationalité contextuelle.
En ce qui concerne le vaste terrain de la rationalité limitée, nous avons séparé deux filières d’investigations aux résultats si différents. La filière ouverte par Hayek (1945) et celle ouverte par Simon (1947). Selon Hayek, la rationalité néoclassique tend à dénaturer le marché en le réduisant au rôle d’un mécanisme allocatif de ressources rares, alors qu’il constitue plus essentiellement un processus de découverte de l’information. L’économie positive de l’agence (Jensen et Smith, 1985), ainsi que la théorie des marchés contestables (Baumol et alii, 1982), s’inscrivent aujourd’hui dans cette filière hayékienne. De son côté, Simon substitue à la rationalité néoclassique, une rationalité à la fois limitée, satisfaisante et procédurale. Cette nouvelle voie rénove d’ailleurs moins le marché qu’elle oblige à considérer, à côté du marché, l’organisation comme un nouvel espace comportemental. Elle a ouvert aujourd’hui sur l’économie des coûts de transactions (Williamson, 1975 et 1985) et sur l’économie des conventions (Dupuy et alii, 1989).
La seconde modalité consiste à ne plus s’en tenir à une rationalité universelle, dont la même forme s’impose partout, mais à poser la rationalité des acteurs comme contingente au contexte social dans lequel ils sont situés et qu’ils contribuent aussi à construire. C’est là, réduit en quelques mots, le programme de recherches de la socio-économie qui se présente comme une nouvelle discipline dans laquelle le marché est vu comme un fait social total. Elle réunit des économistes tel Akerlof (1982) et des sociologues tels Granovetter (1985), White (1988), Etzioni (1985).
Ainsi délimité, entre révisions, extensions et contestations, le domaine des recherches contemporaines sur le marché parait tout à la fois immense, au relief différent selon ses régions et vivant. Depuis le modèle Arrow-Debreu du marché, l’évolution qui le porte à l’intérieur de chacune de ses trois grandes régions, a pour fil conducteur la prise en compte de l’organisation. Qu’il s’agisse de l’organisation des marchés ou de l’organisation entendue comme un nouvel espace comportemental, qui se substitue alors au marché. Nous allons maintenant interpréter cette mise en scène de l’organisation à la lumière de notre parcours en histoire de la pensée économique et de ses enseignements.
Le retour problématique du collectif
Au sein d’une économie de marché de type Arrow-Debreu, il n’y a de place ni pour le collectif, ni pour le partage, définitivement évacués par le célèbre théorème d’impossibilité de Arrow (7). Une ancienne et fort importante source d’amendements, apportés durant tout le vingtième siècle au modèle d’EGC, consista justement dans la considération des biens collectifs pour lesquels la consommation est, par définition, partagée par un ensemble d’individus au sens de « partager une même table ». Avec les révisions comme avec les contestations du modèle Arrow-Debreu du marché, la place accordée au collectif n’est plus celle d’un appendice d’une théorie générale comme c’était le cas de l’économie du bien-être, dans la mesure où le collectif participe de la définition même de l’objet étudié.
Instruits par notre contribution à l’histoire intellectuelle du marché qui a mis en évidence le refoulement, opéré primitivement par Walras, de la dimension collective des biens dans une économie capitaliste de marché, nous avons pu interpréter la redécouverte de l’organisation comme le retour plus ou moins inconscient du collectif (2). Au sein de l’économie des contrats et de l’économie des conventions, la dimension collective apparaît, dès lors que les relations inter-individuelles sont rapportées à un objet commun. Nous avons depuis approfondi cette ligne interprétative en nous centrant sur la nouvelle économie néoclassique de la coopération et des salaires (11), (13) et (14). Le renouvellement de la théorie néoclassique du marché du travail opère ainsi un glissement, resté sourd, du marché vers la firme, qui fait apparaître la dimension collective des relations de travail, prise en charge par l’échange collectif de la théorie des négociations collectives, ou le recours à des notions sociologiques telle celle du don contre don. Ce glissement théorique du marché vers la firme, a entraîné un changement de la question à résoudre. Au sein de la firme, de même que sur les marchés entre organisations, ce qui se trouve posé est moins un problème de coordination qu’un problème de coopération. En utilisant la théorie des jeux non coopératifs, la théorie néoclassique réalise alors l’exploit théorique d’expliquer la coopération par de la non coopération. L’économie des contrats, dans ses développements les plus récents (Itoh 1992), distingue pour sa part plusieurs types de coopérations. La coopération verticale entre le Principal et l’Agent d’une part, la coopération horizontale entre les agents d’autre part et, parmi celle-ci, la coopération induite par le Principal à travers le grand contrat et la coopération déléguée ou auto-émergente entre les agents (14).
Le problème central qui se pose au sujet de la redécouverte par la théorie néoclassique, de l’organisation, est qu’elle continue de réfléchir celle-ci avec ses anciens outils d’analyse, notamment à partir de son hypothèse de rationalité, forgée pour rendre compte des comportements d’individus libres et égaux en droit dans un univers de marchés anonymes. Afin de rendre compte des économies capitalistes de marché, dont l’unité première est l’organisation, ne doit-on pas procéder à une réforme de ces outils ? Nos travaux sur l’analyse des économies contemporaines de marché, ont pour but d’apporter à cette question une réponse positive, un début de réponse tout au moins.
VERS UNE MICRO-ECONOMIE HETERODOXE DES MARCHES
La tension qui existe entre l’organisation et la conception néoclassique de la rationalité, l’économie des conventions tente de la dépasser en demeurant, selon nous, en retrait en raison de son attachement revendiqué à l’individualisme méthodologique (IM) qui sied mal a l’étude des économies d’organisations. A l’opposé, ces dernières invitent à renouveler la démarche holiste. L’hypothèse, qui oriente toutes nos analyses des économies de marché, est que les unités actives des économies de marché, quel que soit le type de ces dernières, sont des groupes. La micro-économie qui convient, doit alors considérer les comportements individuels au sein d’une logique de groupe, largement à construire en économie.
Un nouvel holisme
La considération de l’organisation, qu’il s’agisse de l’organisation des marchés ou de l’organisation des firmes, notamment de sa dimension collective et de la problématique de partage qui lui est attachée, conduit à renouveler tout d’abord la méthode d’analyse des économies de marché. Elle entraîne l’abandon de l’IM au profit d’un holisme renouvelé (9).
Notre intention n’est toutefois pas de rejouer une énième scène de ménage entre holisme et individualisme. Nous avons montré que, après des débats nourris et vifs, la querelle des méthodes à partir des années quatre vingt fut considérée comme dépassée au sein des sciences sociales, où seul, l’IM, certes dans une version adoucie (Agassi, 1973) reste en lice. Même l’économie des conventions dont le projet est de développer une approche alternative à l’approche néoclassique des marchés, se range sous la bannière de cet IM. Ce consensus en faveur de l’IM comme seule base scientifique, est aujourd’hui à revoir.
Premièrement, l’IM n’a aucune raison d’avoir le monopole de l’étude micro-économique des marchés, car il est possible de partir des comportements individuels dans une perspective holiste. C’est justement ce sens que recouvre la notion de micro-économie hétérodoxe. Deuxièmement, la version vulgaire ou caricaturale selon laquelle le holisme suppose une détermination des comportements individuels par des entités supra individuelles, lesquelles agissent à la place des individus, ne résume pas tout le holisme. Troisièmement, la considération de relations interindividuelles dans des contextes sociaux dont la dimension est collective, et dont la logique s’énonce en termes de partage, invite à pratiquer un holisme rénové qui s’oppose à l’IM. Ce dernier étant limité aux contextes dans lesquels seul l’échange entre individus intervient, en dehors de toute dimension collective, comme dans le cas de l’économie artisanale de marché chez Adam Smith.
Ce faisant, le débat entre IM et HM s’est déplacé. Il n’est plus seulement une question de pure méthode, mais mêle à la fois l’ontologie et la méthodologie du savoir économique. Ainsi, la nature de l’objet économique conditionne, en partie, la méthode qui règle son approche. De plus, ce débat ne se pose plus comme auparavant, en termes de coordination des actions individuelles dans lesquelles l’IM recouvrait la proposition d’une coordination auto-émergente, d’un ordre spontané. La question de la validité de l’IM se trouve donc à nouveau posée , en raison du changement de nature de l’objet étudié, dont le substrat est désormais la coopération interindividuelle. Selon notre analyse, ce glissement de terrain s’opère en faveur du holisme.
Le holisme rénové que nous proposons, conserve aux individus le statut d’acteurs. Mais, il ne s’agit plus d’acteurs dont le comportement est attaché à un intérêt orphelin, ou privé de toute dimension collective, qui se construit en dehors de tout intérêt ou objectif collectif, commun. Les intérêts individuels renvoient à, ou se définissent par rapport à un intérêt collectif, dont la définition et la défense sont toujours prises par un ou plusieurs individus qui, dès lors, se trouvent au-dessus des autres, séparés d’eux par une hiérarchie qui est la première caractéristique des contextes sociaux collectifs. Ainsi, dans le cas de l’entreprise capitaliste, nous pouvons distinguer les points de vue des salariés et des actionnaires au niveau objet, du point de vue de l’entreprise elle-même qui correspond au méta-niveau. Ce point de vue est pris en charge, dans les grandes entreprises japonaises, par les dirigeants qui imposent, en partie, aux actionnaires et aux salariés le point de vue de l’entreprise. Nous avons montré dans (1) que ce point de vue global a, historiquement, dans des périodes de crises, pu être pris et défendu par l’Etat. Il faut ajouter que l’entreprise capitaliste est un objet social dont les caractéristiques ontologiques elles-mêmes varient. Ainsi aux Etats-Unis, les entreprises ne sont pas construites par leurs acteurs en référence à une dimension collective et se voient, en grande partie tout au moins, informées par une logique de marché.
Cependant, notre analyse qui s’appuie ici sur notre parcours en histoire de la pensée économique, montre que l’entreprise capitaliste pensée en termes de marché, compose un cas-limite ou dégénéré, à l’origine de nombreux dysfonctionnements. Une telle pensée de l’entreprise capitaliste manque, en effet, sa dimension propre d’action commune qui fait intervenir, de manière centrale, la notion de groupe, à partir de laquelle notre micro-économie hétérodoxe des marchés s’est développée.
Marchés et groupes
Le renouvellement de l’analyse néoclassique des marchés, passe principalement par la reconsidération des unités qui agissent sur les marchés. De manière traditionnelle, nous avons montré que les marchés sont analysés comme des marchés entre individus séparés, privés de toute dimension collective. Notre thèse, développée au sujet des économies capitalistes de marché, avance, au contraire, que les unités actives de ces économies sont des groupes dont la logique particulière informe la rationalité des individus. En vue d’approfondir cette voie de recherches, nous avons posé les linéaments d’une théorie de la coopération salariale. Mais l’économie de marché ne se réduit pas, historiquement, à sa forme capitaliste. Il existe des économies non capitalistes, traditionnelles , de marché, elles-mêmes très diverses. Nous avons, dans notre perspective d’une micro-économie hétérodoxe des marchés, repensé les économies sub-sahariennes de marché, avec l’objectif d’extraire les raisons de leur mal-développement.
L’entreprise capitaliste en tant que groupe
Notre hypothèse de travail qui considère, afin d’en renouveler 1’étude, la firme capitaliste en tant que groupe a été développée dans deux recherches (10) et (14), et présentée de manière systématique dans une recherche collective (11) menée au sein du GERS* à Nanterre. Elle s’inspire largement des travaux de Aoki (1991) sur la firme japonaise.
La firme capitaliste s’institue comme telle sur le marché à travers l’association du capital et du travail grâce à laquelle elle gagne ou élabore historiquement son autonomie (10). Cette dernière se manifeste, pour la firme, dans sa possibilité de reproduire sa valeur et de l’accroître en termes de profit, à travers le jeu marchand. Historiquement, cette possibilité s’est d’abord offerte dans les interstices des Etats, c’est-à-dire dans le « commerce au loin ».
Considérer analytiquement la firme capitaliste en tant que groupe, c’est l’articuler autour de relations internes qui délimitent son organisation, et de relations externes qui définissent son rapport aux marchés et à l’Etat. Les relations internes relient les membres de la firme que nous avons limités, dans un premier temps, aux actionnaires et aux salariés, en faisant donc l’hypothèse que les actionnaires -ou certains d’entre eux- en sont également les dirigeants. Nous avons, jusqu’à présent, centré notre analyse de l’organisation de la firme sur les relations salariales, qui lient les salariés à la firme en tant que groupe (11). Nous avons, dans ce cadre, montré que les règles, qui organisent les relations salariales, comportent trois niveaux emboîtés.
Le niveau organisationnel où la règle salariale définit à la fois la contribution des salariés à l’oeuvre commune, et leur rétribution qui s’entend ici comme la part de l’oeuvre commune qui leur revient. Le partage est bien le substrat sur lequel prennent sens les deux volets de la règle salariale, le volet contribution et le volet rétribution. La rupture se marque ici avec les approches de la relation salariale en termes d’échange entre offreurs et demandeurs de services productifs. Néanmoins, la clôture, dans le sens donné par Varela (1989) à cette notion, de la règle salariale au niveau de la firme, se fait à travers une ouverture de la firme sur son environnement, sur le marché du travail principalement. Notre analyse nous a conduit à distinguer deux cas limites de la règle salariale. Celui, d’une part, où la règle salariale se confond avec la règle du marché du travail, et prive alors la firme de toute autonomie. Celui, d’autre part, dans lequel la clôture devient fermeture, et coupe la firme de toutes relations au marché du travail. Le paternalisme a, à une certaine époque, constitué une organisation de la relation salariale qui tendait vers sa fermeture.
Par nature, l’organisation de la firme appelle une hiérarchie qui autorise son fonctionnement en instituant un méta-niveau que certains membres occupent afin de représenter la firme, ses buts et objectifs, dans sa globalité. Dans la firme capitaliste, par définition, un tel pouvoir de représenter la firme revient à ses actionnaires qui en sont les propriétaires. La règle salariale, de ce fait, est une « règle d’en-haut », énoncée depuis le méta-niveau. Comme règle d’en-haut, la règle salariale appelle alors une légitimation du pouvoir qui l’édicte qui, dans les économies démocratiques de marché, est assurée par l’Etat. Ce dernier englobe les règles salariales et, ce faisant, participe largement à leur dynamique. Le deuxième niveau de la règle salariale nous renvoie à un niveau politique.
Nous avons montré que les règles salariales s’élaborent au métaniveau de la firme et qu’elles définissent, à la fois , la contribution et la rétribution des salariés. Leur application nécessite, en raison de leur ancrage « en haut » de la firme, que les salariés se les réapproprient, les fassent leur pour guider leurs actions. La réappropriation des règles salariales par les salariés met en jeu un troisième niveau, celui de l’identification des salariés à travers le jeu de normes identitaires. Nous avons relevé deux cas polaires à ce niveau : celui où les règles sont renforcées par les normes des salariés, et celui où les règles salariales se trouvent contestées par les normes identitaires. Dans le premier cas, nous avons affaire à des règles salariales qui sont construites en tenant compte des salariés comme des membres de l’entreprise, alors que dans le second cas polaire, les règles salariales sont élaborées en considérant les salariés comme étrangers à la firme, dont l’identification est renvoyée à l’extérieur de la firme. Entre le premier et le second pôles, tous les cas intermédiaires sont envisageables.
Dans un récent travail de recherches, nous avons développé notre analyse des règles salariales au niveau organisationnel, en vue d’élaborer une théorie de la coopération salariale (14).
VERS UNE THEORIE DE LA COOPERATION SALARIALE
Dans le point (12) de la présente note, nous avons mentionné les approches non coopératives de la coopération qui s’appuient, pour expliquer celle-ci, sur l’hypothèse néoclassique de rationalité. En contre-point de ces approches, nous proposons de réfléchir la coopération salariale sur une autre base qui admet, de la part des agents, une rationalité coopérative. Nous allons indiquer ici les éléments théoriques que nous assemblons à cette fin en vue de les appliquer au cas concret de la participation (14).
Les éléments théoriques sont repris de la théorie des jeux coopératifs tels que Aoki et Ponssard (1989 et 1993) les mobilisent, ainsi que de l’approche développée récemment par Sugden
(1993).
L’idée, au sujet de la participation, est de soutenir que l’on peut avoir deux approches de celle-ci : une approche non coopérative et une approche coopérative. Nous découpons les expériences en matière de participation selon cette dichotomie, afin d’exposer les différences de résultats selon la voie suivie pour implanter, dans les entreprises, la participation des salariés.
Essai de micro-économie hétérodoxe du développement
Dans une recherche initialement présentée aux journées des économistes de l’ORSTOM, notre hypothèse de travail sur l’entreprise capitaliste a trouvé l’occasion d’une première extension. Celle-ci a eu pour cadre la question du développement et de son lien au marché. Son fil conducteur étaitla reconnaissance de la pluralité des économies de marché et, notamment, la distinction nette entre, d’un côté, l’économie capitaliste de marché et, de l’autre, l’économie traditionnelle de marché. Cette dernière recouvre, selon les lieux et les époques, des visages multiples.
Si les économies capitalistes de marché connaissent, sur une longue période, une croissance de leur revenu par tête, ainsi qu’une amélioration générale des conditions de vie de leur population, elles le doivent à la dynamique de groupe, qui anime les firmes sur leur territoire. La reproduction des firmes dans l’environnement marchand qu’elles construisent autant qu’il les contraint, repose sur leur croissance en perpétuel renouvellement, et qui se termine parfois par leur remplacement par d’autres firmes, à la dynamique plus prospère. Le développement des économies capitalistes de marché, est d’abord celui des firmes qu’elles abritent même si l’Etat tient, dans le processus du développement, un rôle essentiel qui est de canaliser et de favoriser la dynamique des firmes. Mais en tant que tel, l’Etat n’ouvre pas de lui-même, sur le développement économique. Autrement dit, l’Etat sans le développement, existe et se rencontre. L’effort des recherches, qui visent aujourd’hui à expliciter les ressorts du développement, va ainsi dans le sens d’une plus grande considération des organisations micro-économiques. Nous avons, pour notre part, mis en évidence le rôle déterminant accordé par Lucas (1988) aux groupes, dans le processus de croissance . Mais, parce que ses différents modèles continuent tous de reposer sur l’hypothèse néoclassique de rationalité, cet auteur est conduit à n’explorer qu’en surface le phénomène du développement économique. Pour aller plus loin, nous avons suivi la voie ouverte par notre micro-économie hétérodoxe des marchés.
Notre recherche s’est également penchée sur les économies traditionnelles de marché en glissant nos pas dans ceux de Braudel (1979), en reprenant sa distinction entre marchés traditionnels et marchés capitalistes. Les marchés traditionnels mettent en scène des groupes dont la clôture ne s’opère pas à travers les jeux du marché, comme c’est le cas des groupes sur les marchés capitalistes. Les groupes n’y sont d’ailleurs pas présents directement, et agissent à travers des règles qu’ils imposent aux acteurs depuis l’extérieur. Les marchés traditionnels, à travers les opérations entre leurs acteurs, ont pour enjeu la reproduction économique des groupes externes au marché, dont la logique ne se décline pas en termes marchands, mais en termes politiques ou/et religieux. Sur ces marchés traditionnels, ce sont donc davantage des individus que des groupes, qui interviennent, à l’inverse de ce qui se passe sur les marchés capitalistes. Les groupes, ici, restent en retrait du marché, en surveillent simplement le jeu afin de s’assurer que nul pouvoir issu du marché, ne vienne remettre en cause leur propre pouvoir. Les économies sub-sahariennes de marché sont demeurées très largement des économies traditionnelles de marché, dans lesquelles les marchés ne font pas défaut. Le pouvoir, qui englobe les marchés, les encastre dans une logique politique, est celui de l’Etat africain (Bayart, 1989), dont la reproduction est assise sur l’économie de la rente, en ne laissant aucune place à d’autres pouvoirs, ceux des firmes, porteurs de développement. Notre étude du mal-développement sub-saharien nous a conduit à un diagnostic formulé en termes de pouvoir, en accord avec notre hypothèse première selon laquelle les marchés ont pour unités des groupes, soit externes (marchés traditionnels), soit internes (marchés capitalistes). Les solutions proposées doivent alors, comme condition de validité, être également formulées en termes de pouvoir (10).
Hervé Defalvard