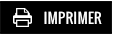Chercheurs, militants et entrepreneurs dans la coopération internationale pour le développement
Publié par , le 28 août 2007.
Ce texte constitue une réponse dans l’urgence à une sollicitation adressée à l’AITEC par le GEMDEV. Il s’agit d’apporter une contribution aux journées de l’Association Tiers-Monde des 2,3 et 4 juin 2003 sur le thème « Quels acteurs pour quel développement ? »
Outre les auteurs cités, j’ai puisé dans le rapport Némo, le séminaire du HCCI sur la recherche au service du développement (mai 2000) et la revue CFDT Aujourd ‘hui (juillet-août 1980) « Quand des militants font appel aux experts ». Je me suis également inspiré du colloque « Les sciences hors de l’Occident au XX° siècle, science transférée, science partagée », ORSTOM-UNESCO, septembre 1994.
Chercher pour le développement
Dans le champ de la coopération au développement, comme dans beaucoup d’autres, le chercheur professionnel a un devoir de critique du savoir et des instruments de la domination et de proposition de nouveaux outils utiles aux luttes. La mondialisation n’est pas un phénomène naturel, une sorte d’ordre des choses. Ce à quoi on est confronté, c’est une « politique de mondialisation ». La recherche est au premier chef nécessaire pour débusquer cette politique qui ne dit pas son nom. Elle a aussi une fonction prédictive relativement aux effets de cette politique, le chercheur ayant en l’occurrence le devoir de s’affranchir de la réserve qu’il s’impose généralement. P. Bourdieu, Le Monde Diplomatique, février 2002).
Le chercheur français travaillant « pour le développement » se heurte à un premier obstacle : Les domaines de recherche intéressant les pays du Sud et l’offre de coopération correspondante restent, depuis une décennie, en marge de la dynamique de la politique scientifique nationale. Agit-il dans une logique de solidarité ? Il lui est immédiatement rappelé que la science est devenue une activité internationale où la concurrence est rude et que la compétition économique joue, à bien des égards, contre les transferts scientifiques.
Cette compétition passe depuis plusieurs décennies par la maîtrise de technosciences adossées à des systèmes de plus en plus autonomes prétendant façonner la société. Voué depuis la période coloniale à la « science d’utilité » (inventaires, recherches pointues pour une meilleure exploitation des ressources, recherche de service), le chercheur éprouve les plus grandes difficultés à imposer la production de connaissances scientifiques inédites, indépendamment de l’utilité immédiate. Il ne s’en trouve pas moins confronté aux limites à la fois éthique et politique de sa pratique et se heurte à deux questions lancinantes : l’activité scientifique a-t-elle vraiment un rôle important à jouer dans le développement ? L’association des milieux économiques du Nord à la définition des priorités de la coopération scientifique est-elle opportune, en particulier là où les « retours sur investissement » apparaissent lointains ou aléatoires ?
On est enfermé dans un cercle vicieux : Les pouvoirs publics au Sud (mais aussi les différentes composantes des sociétés civiles) privilégiant la « science d’utilité », ils compromettent l’émergence ou le renforcement de systèmes nationaux de recherche, seuls à même d’ouvrir la voie à des partenariats efficaces. L’enjeu est donc de faciliter au Sud l’appropriation de la science, qu’elle soit ou non directement mise au service de la problématique du développement. Il convient néanmoins de remarquer que tous les acteurs de la recherche du Nord sont amenés, à des degrés divers, à conduire des actions de coopération, en accompagnement de leur démarche première (cf. grands programmes mondiaux ou régionaux du type « climat », « développement durable », « lutte contre la pauvreté », « grandes endémies »). Le caractère contingent de ces démarches de coopération conduit à un foisonnement inévitable des comportements et des pratiques.
La conférence de Rio a marqué un tournant comme le souligne Martine Barrère : Les scientifiques doivent assumer leurs responsabilités dans la société. Il ne leur appartient pas de décider mais d’éclairer les politiques, comme les individus, sur les risques liés aux activités humaines. Ils doivent rendre largement publics les résultats de la recherche, même lorsqu’ils soulèvent un certain nombre d’inquiétudes, ainsi que des controverses (...) Enfin, ils doivent apprendre à travailler non seulement avec les décideurs politiques et les industriels, mais aussi avec la société civile. (M. Barrère, Vivre Autrement, ENDA, septembre 1992)
Le chercheur et le militant
Les relations entre ces acteurs sont empreintes de méfiance réciproque. On assiste même, depuis plusieurs années, à la contestation, par certains milieux associatifs, du monopole des chercheurs professionnels dans la production des connaissances scientifiques !
Les cas de figure sont multiples. Prenons d’abord l’exemple de chercheurs extérieurs aux organisations, bénévoles ou rémunérés, sollicités pour apporter ponctuellement une expertise dans les domaines les plus variés. La démarche révèle vite ses limites dès lors que le droit de contrôle doit être exercé régulièrement et de manière systématique (OGM, dette, etc.). Il est alors indispensable que le monde associatif formule une demande relativement précise sur la base d’une réflexion collective préalable. C’est à cette seule condition que peut s’instaurer une relation d’égalité et une reconnaissance de la réciprocité des échanges entre le chercheur et le militant, le premier ne devant être ni un « guide », ni un « mercenaire », ni même un « compagnon de route » provisoire, moins encore un « observateur neutre ». Le chercheur doit, de son côté, manifester un souci pédagogique pour rendre accessible des matières souvent complexes mais, sans pour autant développer des analyses dont les militants ne percevraient pas clairement les fondements idéologiques.
Plaçons-nous maintenant dans le cas du « chercheur engagé ». Plusieurs questions se posent :
– Le chercheur peut-il appuyer une délégation associative ou autre dans une négociation ?
– Dispose-t-il du droit de critiquer et d’interpeller les militants et leurs organisations ?
– A-t-il son mot à dire dans l’utilisation qui est faite de son travail par les militants ?
– Les organisations peuvent-elles intervenir dans les méthodes de travail du chercheur et contester d’une manière ou d’une autre l’autonomie de réflexion théorique et technique de ce dernier ? Si le chercheur revendique légitimement cette autonomie, il n’a pas pour autant à se poser en donneur de leçons. Bourdieu dénonce justement ces intellectuels qui, incapables d’imposer leur marchandise sur le marché scientifique, le vendent au béotien sur le mode du prophète ou du maître à penser (P. Bourdieu, op cité).