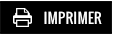Compter sur soi - Anne Querrien
Publié par , le 27 septembre 2005.
Partout, les exclus et les minorités urbaines essaient de trouver leurs propres formules de logements et de services, sans passer par les pouvoirs publics. Quand la politique et le droit n’offrent plus d’espoir, seule l’action directe semble efficace.
L ’expression de "mouvements sociaux urbains" est apparue en France dans les années 1960 avec la dernière phase d’industrialisation et d’urbanisation. L’aménagement des villes est devenu la condition d’une meilleure mobilisation de la main-d’œuvre et d’une plus grande productivité. L’alliance entre les classes moyennes attachées à un développement urbain traditionnel et une classe ouvrière désireuse d’obtenir des formes d’encadrement de la vie quotidienne plus conformes à la norme commune a donné pendant quelques années à ces mouvements un impact politique certain. Ces mouvements se sont développés d’abord aux Etats-Unis, puis dans la plupart des pays industrialisés. L’arrivée au pouvoir des classes moyennes urbaines s’est accompagnée d’une restructuration importante du capital, faisant passer l’activité financière au premier plan et reléguant l’activité industrielle dans la périphérie du système économique. Ceci s’est traduit par une surreprésentation des travailleurs immigrés dans ce secteur et l’apparition d’une nouvelle manière de concevoir les luttes urbaines, comme des luttes en faveur de minorités discriminées. Mais ces minorités qui veulent jouir d’un accès aux aménités urbaines égal à celui de la majorité ne veulent pas pour autant disparaître. Les luttes se développent alors moins pour l’affirmation d’un droit commun à la ville, que pour l’obtention de droits spécifiques à telle ou telle minorité, à telle ou telle localité. Les mouvements sociaux urbains dans les pays anciennement industrialisés se sont donc fortement transformés et segmentés en fonction de problèmes et de publics différents.
La situation dans les pays d’industrialisation plus récente reste davantage du type connu dans les pays industrialisés dans les années 1960. De plus, avec l’ajustement structurel exigé par les institutions internationales, les revenus des classes moyennes se sont tassés, et elles se retrouvent dans une relative proximité avec les classes populaires pour affronter le problème de la crise du logement. Elles ont alors le rôle de leaders objectifs des mouvements urbains pour avoir accès à la terre, à l’eau, à l’éducation, à la santé, et pour construire éventuellement ce droit concrètement par des invasions de terrains et le développement d’autres formes d’habitat informel. De nombreux mouvements d’éducation populaire développent ce type d’action en Amérique latine, en Afrique et en Asie et produisent un habitat social alternatif, ainsi que des services de quartier tels que les garderies d’enfants ou les cantines.
Malgré cette diversité d’approche et de positionnement, tous ces mouvements se rencontrent maintenant plusieurs fois par an au niveau mondial à diverses occasions créées, par l’Organisation des nations unies (ONU), des fondations, ou encore par des villes comme Porto Alegre, et essaient de formuler des revendications en matière d’habitat valables pour toute la planète. C’est avant tout la pression de ces mouvements qui a permis d’inscrire parmi les droits fondamentaux de l’homme aujourd’hui "le droit à un logement décent", lors du sommet de l’ONU à Istanbul en 1996. Les mouvements s’attachent surtout à la nécessité pour chaque être humain, ou chaque famille, de disposer d’un toit, quitte à l’améliorer lui-même ensuite. Le mot "décent" sert aux gouvernements à poser des normes minimales d’habitabilité et à justifier le fait qu’ils en construisent trop peu par incapacité budgétaire ! La lutte, victorieuse sur le papier à Istanbul, doit être poursuivie en permanence sur le terrain. En France, l’association Droit au logement (DAL)1 s’en charge par des réquisitions de logements vacants et un harcèlement médiatique des pouvoirs publics.
Le piège de l’universel
Ce décalage permanent entre droit et réalisations conduit les mouvements à préférer l’action directe, concrète, comme l’occupation des espaces publics, de logements, de bâtiments. Ils espèrent obtenir ainsi des régularisations qui fassent sens. Cette méthode semble plus sûre que les longues campagnes d’opinion pour changer une loi, dont la nouvelle version ne sera pas appliquée. Les mouvements se situent en effet dans le contexte de la nouvelle forme de gouvernementalité qu’on appelle gouvernance territoriale. Il ne s’agit plus pour le pouvoir d’Etat de soumettre tout le territoire national à une même norme définie centralement, mais d’indiquer aux territoires la norme en référence à laquelle ils devraient s’organiser et s’efforcer de construire un ordre public local consensuel. Cette nouvelle forme de gouvernementalité est particulièrement propice à la non-reconnaissance des droits des minorités, et à la prolifération des exclusions. En Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, la minorité sans voix réelle au chapitre gouvernemental est en fait la majorité, près de 80 % de la population. Dans les pays industrialisés, il s’agit réellement d’une minorité, d’environ 20 % de la population qui cumule faiblesse du revenu, bas niveau d’éducation, chômage, habitat dégradé, etc. La réunion des mouvements représentatifs de ces différents types de situations dans les mêmes enceintes de réflexion, si elle a l’avantage de l’interconnaissance, a l’inconvénient de développer un modèle d’intervention "humanitaire", dans lequel des leaders et professionnels éclairés se spécialisent pour proposer des solutions universelles accessibles en droit, au niveau international, alors que les mouvements se construisent à la base à partir d’actions concrètes et directes, réalisées par les personnes concernées elles-mêmes. Cette distorsion était très sensible lors de l’Assemblée mondiale des habitants qui s’est tenue à Mexico en octobre 2000 à l’initiative de la Fondation Charles Leopold Meyer pour le progrès de l’homme et du Mouvement des Assemblées de quartiers.
Les nouveaux mouvements sociaux urbains exaltent la valorisation de l’initiative privée, ou très locale, qui caractérise les politiques urbaines depuis leur reformulation en 1975. Il s’agit de faire reconnaître, consolider, les résultats des initiatives des habitants – occupation de terrains ou de logements – et de les régulariser, plus que de construire un habitat nouveau, même avec la participation des habitants, car l’histoire a montré que les expériences innovantes ne réussissaient pas nécessairement. Aujourd’hui, on ne veut plus faire autant confiance à l’avenir et au progrès, mais s’organiser pour durer dans le présent, avec ce qu’on a et qu’on peut conquérir ; on veut défendre ses acquis. Les mouvements de lutte pour le droit à la ville, pour l’accès aux services urbains sont moins valorisés par les administrations que les mouvements de défense de l’environnement. Le paradoxe, c’est qu’au nom de cette défense et de cette crainte de l’avenir, la partie environnementaliste de ces nouveaux mouvements sociaux peut aller jusqu’à refuser localement la construction de logements sociaux, et réserver aux classes sociales supérieures le soin de se débrouiller de l’innovation technique ! (lire encadré).
Etats-Unis : un environnement de classes
La désindustrialisation a permis de constater que la pollution de l’environnement était d’autant plus forte qu’on se rapprochait des habitats les plus populaires, et en particulier des quartiers plus ou moins réservés de fait aux minorités ethniques. Au nom de l’équité environnementale, des militants ont commencé à revendiquer que les nouvelles pollutions ne nuisent pas plus aux minorités qu’aux autres. Cette revendication a été reprise par l’administration Clinton à ses débuts, donnant lieu à l’édiction de normes pour les établissements industriels nouveaux. Pour les établissements existants, le respect de la réglementation anti-pollution exigerait souvent la fermeture ; pour garder l’emploi, on préfère alors avoir recours à l’assurance contre les risques d’accidents. L’inégalité et le blocage des initiatives restent donc de mise. La résignation et le désintérêt des citoyens pour les affaires publiques en découlent, car le dispositif socio-technique renvoie clairement la responsabilité de l’action à l’Etat. Le travail des leaders du Mouvement de la justice environnementale reste attaché à la résolution législative des problèmes au niveau national, voire international. Leur réflexion guide notamment le travail de fonctionnaires, mis en place dans l’ensemble des régions concernées par le traité de l’Alena, chargés d’unifier progressivement l’espace économique de l’Amérique du Nord.
Trouver le cap
Tous les mouvements psalmodient en cœur qu’il s’agit de participer à un développement durable, soit, comme l’a dit le Rapport Brundtland en 1987, de transmettre à la génération suivante une Terre qui aura au moins encore autant de possibilités de développement que celle que nous avons reçue. Cette définition a subi de nombreuses distorsions ; la transmission à l’échelle de l’individu et de la famille étant celle du patrimoine, elle a été traduite dans la vieille culture rurale de petits propriétaires des pays du Nord comme la nécessité de transmettre un patrimoine supérieur à celui qu’on avait reçu. Même si pour tous les animateurs des mouvements ces choses s’évaluent en nature plus qu’en valeur, dans un contexte mondial marqué par l’échange généralisé, la valorisation n’est jamais que relative, et impossible pour tous en même temps. Le développement durable apparaît alors paradoxalement comme une idéologie propice au développement des égoïsmes locaux et à la promotion de la maison individuelle comme territoire de base à partir duquel les flux énergétiques et économiques sont contrôlables. De ce point de vue, les documents diffusés sur l’Internet par le mouvement Reclaim the street2 sont particulièrement édifiants. De manière semblable à ce qu’ont souligné Luc Boltanski et Eve Chiapello sur la continuité entre critique artiste des années 1970-1980 et management post-fordiste, il y a continuité entre la posture humanitaire des mouvements sociaux urbains des années 1990 et les politiques de privatisation menées sous l’égide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, même si les leaders de ces mouvements se confrontent théâtralement, et violemment, de façon périodique avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les autres institutions de la mondialisation. Mais s’ils font partie de la pièce, en obligeant le pouvoir à se mettre en scène, à se médiatiser, ils le dépouillent de son rôle de pure gestion et de son imagerie consensuelle ; ils font apparaître ses choix. Leur vertu pédagogique est là plus évidente que dans la construction de micro-alternatives locales.
Les mouvements sociaux urbains sont à un tournant. D’un côté, les effets socialement destructifs des privatisations commencent à se faire sentir, comme en Argentine, et la dimension publique d’une lutte efficace reste à retrouver. D’un autre côté, la communauté locale ou ethnique d’origine s’est disqualifiée en tant que référence par les violences qu’elle a accepté. De ce point de vue également, la dimension commune et transversale à un ensemble de luttes est à établir. Mais la méconnaissance affichée par les mouvements sociaux urbains pour les problèmes économiques, systématiquement renvoyés à l’Etat, les confine dans une pratique du court terme, d’actions coups de poing. Les perspectives de long terme sont évoquées de façon "politique", ou plutôt "poétique", sous forme de déclarations à signer par les acteurs qui le veulent bien, sans grand engagement de leur part. C’est un mode d’action qui ressemble fortement à la manière dont les Etats proclament maintenant la loi. Les mouvements sociaux urbains s’inscrivent dans la gouvernance, comme des acteurs parmi d’autres, plus vulnérables que d’autres, parce que représentant les groupes vulnérables ? Comment fonder l’antagonisme, que pratiquait Antigone ou la classe ouvrière, et qui est la condition de la liberté de penser et d’agir ?
1. Le Droit au logement : www.globenet.org/DAL
2. Mouvement "La rue est à nous" qui a essaimé tout autour du globe
Anne Querrien