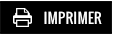Espace du marché et espace de la démocratie - Gérard Larose
Publié par , le 13 mars 2007.
L’effondrement des appareils d’état de l’Est européen, associant planification centralisée de l’économie et autoritarisme politique, a relancé la réflexion sur l’existence de liens entre économie de marché et démocratie. Ainsi, un intéressant numéro spécial de la revue « World development », daté d’août 1993, s’intitulait « Economic liberalization and democratization : exploration of the linkages ».
De l’impossibité constatée de la survie de la démocratie, fut-elle proclamée ouvrière ou populaire, dans une économie planifiée, on a parfois conclu hâtivement à une relation nécessaire entre marché et démocratie. De plus, la coexistence entre marché et démocratie constitue une référence pour la plupart des dirigeants du tiers monde et de l’Est européen, car elle caractérise les pays aujourd’hui considérés comme modèles de développement.
Le marché n’a pas besoin de la démocratie
Le marché n’a pourtant pas besoin de démocratie pour fonctionner, mais seulement d’un certain degré d’autonomie des agents économiques, dans un contexte doté de règles du jeu suffisamment stables et connues, ce qui n’implique nullement le respect des droits de l’homme, ni aucune forme de citoyenneté.
Quelques théoriciens ont soutenu que la démocratie était nuisible au bon fonctionnement du marché, en créant de multiples occasions de distorsions, par l’intermédiaires d’impôts ou de transferts, ou de réglementations diverses. Les possibilités d’organisation des salariés, de mise en place de législations du travail et de systèmes de garantie sociaux sont évidemment identifiées comme quelques-uns des principaux effets négatifs de la démocratie sur le marché. Les coûts salariaux nuisent à l’accumulation du capital (à la capacité d’investir), disait-on autrefois ; ils nuisent à la compétitivité, dit-on plus volontiers aujourd’hui, dans un marché ouvert. Les salariés, généralement considérés comme des agents économiques peu dignes des faveurs du libéralisme, sont cependant des électeurs nombreux, ce qui rend la démocratie dangereuse.
Les illustrations de contradictions entre économie de marché et démocratie abondent dans l’histoire comme dans l’expérience contemporaine : l’Allemagne nazie et le Japon impérial, quelques « dragons asiatiques » et diverses dictatures sud-américaines. L’illustration présente la plus frappante étant sans doute aujourd’hui la Chine de Deng Xiao Ping, qui connaît un développement impétueux de l’économie de marché, après Tien An Men. Les experts du libéralisme mettent aujourd’hui ses dirigeants en garde contre la « surchauffe de l’économie », et le risque d’une inflation excessive, mais de démocratie nul souci !
Sans doute faut-il des lois, un Etat garant de leur application, protecteur contre les dangers extérieurs et réalisateur d’infrastructures publiques (luttant contre les monopoles, aurait ajouté Adam Smith). Un despotisme éclairé suffira à garantir l’ordre nécessaire à la bonne marche des affaires. Les règles du jeu, le cadre des échanges ne sauraient être définis par le marché lui-même et donnent d’ailleurs lieu à des débats politiques entre les libéraux eux-mêmes : libre-échange ou protectionnisme, stabilité des changes ou détermination des taux par le marché ? Ces règles sont édictées par l’Etat, mais nulle nécessité que cet Etat soit démocratique. Les physiocrates, créateurs de la fameuse formule « laissez-faire, laissez-passer ! », ne professaient-ils pas le plus profond respect pour « le despotisme de la Chine », cependant que l’abbé Baudeau décernait à Quesnay le titre de « Confucius de l’Europe ».
L’assimilation du marché et de la démocratie, la revendication simultanée de la liberté d’entreprendre et des libertés politiques, ont certes joué un rôle important pour la remise en cause, par des bourgeoisies montantes, de certaines entraves de l’ordre ancien à l’investissement et à la circulation des marchandises, dans l’Angleterre ou la France du dix-huitième siècle. Un peu plus tard, le grand capitalisme industriel s’étant formé, le libéralisme se dégradera, admettant volontiers protectionnisme et monopole, que rejetaient les pères fondateurs et deviendra une idéologie économique de défense de la propriété et une idéologie politique de domination d’une classe restreinte, sous couvert de démocratie. Le lien entre marché et démocratie, entre libéralisme économique et libéralisme politique, perdra l’évidence que lui avait donné, un court instant, la Révolution française.
La liaison stable entre marché et démocratie n’a été constatée sur une longue période qu’en quelques pays occidentaux, typiquement les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, mais dont il convient manifestement d’exclure le Japon et l’Allemagne, pays notoirement affligés d’un passé politique autoritaire, voire totalitaire.
Si le nombre des démocraties parlementaires s’est sensiblement accru durant ces dernières années, parallèlement au passage de l’Est européen à l’économie de marché et à la libéralisation accrue de diverses économies du tiers monde, la démocratisation de l’Amérique latine comme celle de l’Est européen est récente et incomplète. Celle de nombreux pays d’Afrique et d’Asie reste à effectuer. Dans nombre d’Etats du Tiers-Monde où les formes extérieures de la démocratie sont respectées, les droits civiques de larges catégories de la population sont ignorés, et de vastes zones de clientélisme quasi-féodal subsistent. Alors que l’existence même de certains Etats, en Afrique, en Asie centrale et en Europe de l’Est, reste instable, que dire de leur régime politique ? Le triomphe actuel du marché est loin de s’être accompagné de l’établissement universel de la démocratie.
L’extension du marché et le dépérissement de la démocratie
Selon la thèse développée par Rosanvallon dans son ouvrage sur « le libéralisme économique », Adam Smith, père fondateur de l’économie politique classique, a d’abord été un philosophe politique, voyant dans le marché la possibilité utopique d’une société où le bien commun résulterait de la confrontation spontanément harmonieuse des intérêts particuliers sur le marché, réalisant ainsi l’extinction du politique. La thèse selon laquelle le marché, régulateur de l’ordre social, rendrait à terme la démocratie inutile, a été reprise par d’autres penseurs libéraux.
En dépit de certaines apparences quant aux progrès mondiaux de la démocratie, les simples citoyens et simples consommateurs que nous sommes sont en droit de se demander si l’utopie de l’abolition de la démocratie, au nom du marché n’est pas aujourd’hui en voie de réalisation rapide, sans cependant que se discerne l’harmonie promise.
L’on a rarement pris garde dans les débats sur la liaison entre marché et démocratie au fait que le marché dont l’on parle aujourd’hui, sous l’influence de l’idéologie anglo-saxonne dominante, véhiculée par les travaux du GATT et par les orientations du FMI et de la Banque mondiale, est le marché international, totalement ouvert pour l’ensemble des biens et services, alors que la démocratie ne se réfère évidemment pas au fonctionnement d’institutions internationales, mais au fonctionnement d’institutions démocratiques dans le cadre d’Etats nationaux.
La nation reste en effet le cadre naturel et principal de la démocratie. Le marché est, en revanche, international. Son internationalisation, apparue comme une évolution naturelle de l’économie depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, n’a cessé d’être renforcée par le consensus libre-échangiste du GATT et par quelques évolutions plus récentes.
Dans le tiers monde, l’étendue de la crise des balance des paiements a permis, depuis le début des années 1980, la diffusion généralisée des principes actuels des institutions de Bretton Woods : ouverture des économies et minimalisme des Etats, qui apparaît comme une demande généralisée que les Etats abandonnent leur souveraineté économique et se contentent d’administrer la stabilité d’un cadre juridique favorable aux exportations et aux investissements étrangers, ainsi qu’un taux de change réaliste.
Plus près de nous, l’Acte unique européen a créé le « grand marché » englobant les divers marchés nationaux dans les secteurs les plus divers. Le traité de Maastricht, d’inspiration ultra-libérale, a confirmé l’ouverture totale de ce « grand marché » sur l’extérieur. Le débat sur l’Europe, ravivé en France par la campagne du référendum sur le Traité de Maastricht, a mis en évidence aux yeux du grand public l’extension géographique et sectorielle du marché européen et de ses règles de fonctionnement, hors de tout contrôle national et sans le contrepoids d’une extension de la démocratie à l’échelle européenne.
On a déploré le discrédit jeté sur le système de représentation parlementaire, la croissance de l’abstention ou la signification purement négative des choix électoraux, comme sanction, expression de mécontentement ou de malaise, et non expression d’orientations souhaitables.
Les citoyens ne font cependant peut-être que constater que la plupart des questions essentielles de leur existence, les questions économiques, échappent au débat politique national.
A fortiori échappent-elles au débat local ou régional. Il est généralement admis que la démocratie s’exerce plus aisément et plus complétement à petite échelle. Or, les questions économiques, de moins en moins saisissables au niveau national, semblent inaccessibles au niveau local, dès lors que l’on est sorti d’une société idyllique d’artisans et de paysans : quels sont, aujourd’hui, les pouvoirs d’une région sur le prix des produits agricoles dont dépendent sa prospérité, quels sont les pouvoirs d’une commune sur la fermeture d’une usine ?
La démocratie, dans l’entreprise, n’est citée que pour mémoire : pouvoir des petits porteurs de « l’actionnariat populaire » dans les assemblées générales des grandes entreprises ou pouvoir des salariés dans les comités d’entreprise, pour lesquels retarder de quelques mois l’exécution d’un plan de restructuration est, aujourd’hui, une grande victoire. Les lois du marché sont invoquées pour imposer le dernier avatar de la démocratie dans l’entreprise : les référendums organisés par certains patrons pour donner aux salariés le choix entre réduction des salaires et licenciements.
L’impossibilité d’un réel dialogue des citoyens avec l’Etat ou les représentations parlementaires en matière économique, l’impossibilité d’une évaluation et d’un contrôle des politiques économiques, ne naissent pas principalement aujourd’hui des difficultés pratiques d’un fonctionnement démocratique des institutions, ni même de la technicité supposée des questions abordées, apanage de quelques technocrates, mais probablement de l’imposition des contraintes du marché international ouvert, portant éventuellement le masque de l’Europe, comme vérité ultime.
Ainsi donc, il n’y aurait « pas d’autre politique », et les citoyens, tenus en laisse par « la main invisible », ne pourraient qu’assister impuissants à la montée du chômage, cheminement nécessaire vers un optimum inconnu et qui n’est peut-être pas pour eux.
L’urgence d’une reconquête
Il existe aujourd’hui d’importants risques de réactions nationalistes et protectionnistes, qui peuvent conduire à la restauration de l’autoritarisme et à des conflits internationaux. Ces réactions ne peuvent cependant être simplement diabolisées, sur le ton des invectives qui accablèrent les opposants à Maastricht. Elles expriment en effet l’angoisse des citoyens face aux forces brutales et anonymes du marché international, présentées par les libéraux comme vecteurs du progrès, mais dont l’apport immédiat semble être la croissance du chômage et le démantélement des protections sociales. Elles expriment de manière plus positive une volonté de reconquête de la souveraineté nationale, et de l’exercice de la démocratie sur l’économie. Ne pas en tenir compte en rétablissant un minimum de régulation démocratique de l’économie dans un cadre national, pourrait ouvrir la voie à des dérives et à des aventures menaçantes pour la démocratie.
Une voie complémentaire, à première vue plus ardue, consisterait à tenter de construire des formes internationales de la démocratie, fondée sur les droits des individus et des peuples, et non plus sur la représentation des exécutifs nationaux, comme à Bruxelles, ou sur des parts du capital, comme à l’assemblée générale du FMI. Cette tâche apparemment impossible, si l’on réduit la démocratie à la représentation élective des individus et à la règle majoritaire, devient envisageable comme un processus de définition et de conquête de droits économiques minimaux, de liberté d’information, de pouvoir de contrôle et d’évaluation, de « transparency and accountability » que prêchent les institutions de Bretton Woods aux gouvernements nationaux, mais qu’il est temps d’exiger à leur égard.
Et si les économistes ne savent plus qu’invoquer les « forces du marché », qu’ils laissent la place aux citoyens !
Gérard Larose