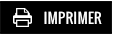Interventions d’urbanisme en Afrique atlantique - Jean-François Tribillon - 2002
Publié par , le 5 mars 2002.
1 - De l’urbanisme colonial aux projets de développement urbain
L’urbanisme colonial
Au commencement des villes africaines est l’urbanisme colonial ; il se pense comme doctrine dès les années 30, ce qui coïncide avec les débuts du mouvement moderne en architecture et en urbanisme.
Cet urbanisme reste pour beaucoup de nos contemporains une sorte de mythe. C’est lui qui a réalisé les parties historiques des villes actuelles. Ces quartiers anciens concentrent aujourd’hui la majeure partie des activités tertiaires et attirent les touristes. « On ne sait plus faire d’aussi beaux quartiers » entend-on souvent. Tout est là en effet pour faire oublier que l’urbanisme colonial a été colonial, c’est-à-dire discriminatoire et répressif... Tout est là aujourd’hui pour faire passer l’urbanisme colonial pour l’Urbanisme avec un U majuscule, l’urbanisme par excellence, la matrice de la production de la ville et non ce qu’il paraît être aujourd’hui, au grand regret des gens ordinaires : un savoir incertain sur l’art d’organiser l’espace. Dans ce temps-là, on ne perdait pas son temps dans d’interminables discussions sur la mixité sociale et l’intégration urbaine. On appliquait des modèles et des règlements. On construisait la ville !
Cet urbanisme a été il est vrai une sorte d’urbanisme total dont aucun urbaniste européen, même le plus moderniste, n’osait rêver : choisir le site de la future ville, en penser l’aménagement par application du zoning le plus strict, diviser le sol et l’affecter selon les usages prescrits, répartir les terrains entre les usagers...
L’urbanisme colonial était par exemple capable d’assigner aux commerçants des emplacements spécifiques en allant jusqu’à distinguer le grand commerce colonial du petit commerce indigène. Ce dernier ne pouvait s’installer que dans les quartiers "indigènes" alors que le grand commerce colonial devait s’installer dans certaines parties du quartier central, à proximité du marché central. Quel raffinement !
L’urbanisme colonial allait même jusqu’à créer des quartiers réservés spécialement à l’habitat des indigènes trop pauvres pour se porter acquéreurs des "concessions" foncières des quartiers résidentiels. Il leur était fait un régime de faveur : gratuité de l’occupation du sol, possibilité de construire des maisons tout à fait rudimentaires... On n’hésite pas à cette époque, pour des raisons d’ordre et d’hygiène, à installer le populaire dans la ville étant entendu qu’il s’agit d’abord de le contenir, de le surveiller... et qu’il s’agit de l’assigner à résidence dans des espaces sous-équipés et assez mal commodes. Mais le fait est là : l’urbanisme colonial "loge" ses pauvres, ce que ni l’urbanisme européen ni l’urbanisme américain ne pratiquaient à la même époque.
L’urbanisme d’anticipation
Nous situons cet urbanisme dit par nous d’anticipation entre 1950 et 1970. Cette période est celle de la fin de la colonisation et des accessions à l’indépendance. Ces événements politiques ne produisent que peu d’effets sur l’urbanisme qui se définit avant tout comme un essai de réponse à la première vague d’urbanisation. En quelques années, dès la fin de la seconde guerre mondiale, la ville coloniale est contrainte de faire face à des accroissements démographiques annuels moyens de l’ordre de 7% à 10%. Les villes doublent tous les sept ou dix ans. L’urbanisme colonial antérieur est efficace tant qu’il faut ajouter un nouveau quartier à la ville existante, mais il ne sait ni prévoir ni planifier. Tout le travail d’urbanisme va consister précisément à planifier et à anticiper. On n’a plus le temps d’assigner à chaque Urbain qui en fait poliment la demande une place dans la ville. Il faut canaliser le flot et traiter les grandes masses en attendant que la tempête se calme et qu’on ait le temps de s’organiser.
À cette époque, on pratique un urbanisme d’anticipation très intéressant fondé sur une croyance aveugle en la planification. Les quantités à traiter sont telles que les moyens disponibles paraissent, d’emblée, insuffisants. D’où cette idée, évidente à l’époque, que la planification est seule capable de dire : c’est ici, en cet endroit, qu’il faut concentrer les modestes moyens dont nous disposons. La planification apparaît comme la rationalisation des gestes, des investissements, des travaux...
Les auteurs du plan Lopez-Guton-Lambert de l’agglomération de Dakar au début des années 50 "inventent" de nouvelles structures d’accueil des masses populaires. Dans les quartiers formant le secteur dit du Grand Dakar, ils procèdent à l’installation d’un parcellaire assez approximatif destiné à accueillir de modestes baraques (en distribuant de simples autorisations d’occuper) mais en l’enserrant dans une trame de voirie et d’équipement assez bien fournie et déclarent que peu à peu lorsque toute cette population sera stabilisée et aura suffisamment épargné, on pourra passer à la construction de cités d’habitat social aux lieux et place des baraques.
En fin de période, Michel Ecochard développe, toujours à Dakar, un urbanisme encore plus radical. Il planifie et organise une ville de baraques, qui est, en quelque sorte, en attente de développement. La trame de la voirie et des équipements est définitivement implantée et largement dimensionnée. Les périmètres et formes des îlots ainsi définis sont intangibles, mais l’habitat et les installations qui sont implantés sont appelés à évoluer, durcir, grandir, se densifier... L’espace public fournit aux citadins les services collectifs auxquels ils ont droit et à la ville la structure de son développement, son ossature, ce que l’on dénommera plus tard : trame urbaine.
La fin de l’urbanisme. L’ère des opérations et de l’ingénierie urbaines
Les années 1970 sont marquées par d’importants changements. L’ère coloniale s’éloigne. La réalité des États et des sociétés apparaît plus nettement, la croissance urbaine se révèle comme une donnée structurelle (et non comme le déversement éphémère d’un surplus démographique rural). La Banque Mondiale développe des opérations de production de terrains à bâtir qui tiennent lieu de politique du logement et de politique urbaine.
Maîtriser la ville par une planification urbaine semble tout à coup un but impossible à atteindre faute sans doute d’une technobureaucratie suffisamment puissante ou faute d’un véritable pacte social faisant apparaître la ville comme une œuvre partagée.
Les ressources budgétaires nationales suffisent à peine à assurer le fonctionnent de l’appareil de l’État. Pour investir, on doit faire appel aux bailleurs de fonds qui raisonnent en banquiers et, s’ils ne sont pas banquiers, s’efforcent de penser comme eux.
L’heure est aux opérations partielles (enfermées dans des limites étroites quant à leurs objets et à leurs périmètres) à court terme (3 à 5 ans) affichant des objectifs précis pouvant donner lieu à des évaluations. C’est ce qu’exigent les financeurs. Le devenir de la ville est traité comme la question du devenir de l’élevage ou de la pisciculture. La ville n’est que le lieu d’opérations d’investissement. Le financeur se place délibérément en dehors de la société qu’il traite, comme une sorte d’ingénieur uniquement préoccupé du bon fonctionnement de la machine urbaine.
Cet ingénieur, assisté d’un économiste (s’assurant que l’opération d’investissement est économiquement viable) et d’un juriste (s’assurant que l’opération est correctement "montée"), est peut-être porteur d’un nouvel urbanisme. Mais un urbanisme qui ne porterait plus en son sein la matrice de la ville et de la société urbaine, qui ne présiderait plus à la naissance et au développent de la cité. Un urbanisme qui, au minimum, se contenterait de réparer, de corriger le cours de l’urbanisation ou qui, au maximum, serait capable d’en tirer une dynamique de développement.
D’une conception "une opération après l’autre" on passe assez vite vers une autre un peu plus large que l’on pourrait dénommer "un bouquet d’opérations par ville". Ce bouquet est un peu vite baptisé "projet de développement urbain". Cette présentation a surtout pour objectif de s’assurer d’une certaine cohérence, donc d’une certaine efficacité. Celles en tout cas qui conviennent aux bailleurs de fonds, qui font preuve, depuis la chute du mur de Berlin, d’une belle et inquiétante unanimité.
L’exception abidjanaise
Avouons-le, Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, dévie de notre cheminement généalogique. Elle continue - de 1970 à 2000 - à incarner une sorte d’urbanisme presque colonial exprimé par une classe dirigeante au pouvoir pendant plus de quarante ans. Ce qui ne l’empêche pas d’adhérer au libéralisme économique et à l’idéologie de la rentabilité à court terme, portés par les banques et fonds d’aide internationale. Il est vrai que ces institutions ont été assez modérées dans leurs propositions. Elles ont su faire la part du feu. On ne change pas un cheval qui gagne.
C’est la même structure et trame urbaine inventée en 1950 qui est perfectionnée et étendue à l’intérieur du même grand site urbain. Cet urbanisme crée une ville inégalitaire et dure à vivre pour les pauvres, rejetant en périphérie ses classes laborieuses et immigrées (de l’intérieur comme de l’extérieur), offrant en spectacle sa richesse et son modernisme, admirant son reflet dans les eaux de la lagune.
Cet urbanisme libéralo-colonial est le fait d’un personnel technique abondant et compétent animé durant ces trente dernières par quelques grandes pensées dont en particulier celle de Michel Arnaud. Continuité du pouvoir d’État (Houphouët Boigny) fondant la continuité du pouvoir d’urbanisme.
2 - Principales actions dites de développement urbain
La mécanique institutionnelle
L’ingénierie urbaine n’a pas négligé l’institutionnel, bien au contraire. Une bonne partie des projets a pour but de promouvoir de nouvelles institutions après les avoir expérimentées, après avoir eu soin d’en évaluer les capacités : à faire la ville (c’est-à-dire selon la nouvelle philosophie, programmer et réaliser des opérations d’aménagement et d’équipement) et surtout à la gérer (c’est-à-dire assurer son fonctionnement, dans sa forme actuelle, sans en changer la forme). L’âme politique de l’institution n’intéresse pas l’ingénieur urbain. Sa trousse à outils ne comporte aucun outil qui lui permette de l’ausculter. Au mieux il s’intéresse à l’animus de l’institution.
Et pendant ce temps là la ville continue à se faire d’elle même.
La plupart des nouveaux quartiers se "font d’eux-mêmes" et "à l’envers" :
– D’eux-mêmes, parce que sans intervention d’une autorité publique, qui aurait dû mettre en place des structures d’accueil de l’urbanisation : un réseau de voirie, une trame d’équipement... Les nouveaux quartiers prolifèrent un peu n’importe où, au gré des offres foncières des propriétaires coutumiers. Ce sont ces offres considérées comme illégales qui déterminent les nouveaux quartiers lesquels, en raison de leur origine même, échappent, évidemment, à tout contrôle.
– À l’envers, parce que ces quartiers prennent d’abord la forme de semis de maisons. Le désir de construire sa maison est le ressort de cette urbanisation. Et les premiers objets posés au beau milieu du site sont des maisons. La densification s’opère par l’ajout de maisons aux autres. Les équipements viennent ensuite. Le logement précède le l’équipement. C’est bien à l’envers que se fait la ville africaine lorsqu’elle se fait elle-même.
C’est dans le but d’améliorer leur situation et valoriser leur investissement que les habitants se liguent. Il leur faut consolider les pistes qui relient leurs maisons à la grande voie la plus proche, amener de l’eau par tuyaux "privés" ou par camions ou charrettes, construire une école à livrer aux services scolaires afin de les inciter à y installer un instituteur, faire pression sur les autorités locales pour qu’elles acceptent d’intégrer ce quartier à la ville, profiter d’une élection locale pour faire accepter par les candidats le principe d’une légalisation de leurs acquisitions foncières...
On pourrait imaginer que ces logiques sont facilement comprises et acceptées et que les bailleurs de fonds viennent massivement au secours des associations activistes, acceptent avec empressement de les aider, ne serait-ce qu’en raison de leur activisme.
Les programmes d’aménagement urbain consistant tout simplement à aider ces associations à émerger comme acteur urbain associatif, à côté de l’autorité publique, le plus souvent l’autorité municipale, sont assez rares. Lorsqu’ils sont entrepris ces programmes prennent la forme d’activités d’assistance aux associations de quartiers exercées par des Organisations Non Gouvernementales (ONG) dites aussi Organisations de Solidarité Internationale (OSI).
Les raisons d’une telle carence résident dans la piètre estime qu’ont les professionnels de l’urbanisme pour ces bricolages populaires, et surtout dans l’opposition des gouvernants qui ne veulent pas accepter qu’on aide ces voleurs de terres, ces rebelles, ces gens sans ni loi qui d’ailleurs sont tous des étrangers...et qui occupent souvent des sites intéressants. Les programmes les plus souvent proposés sont la plupart du temps des projets de restructuration urbaine qu’il faut comprendre comme des projets d’éradication des habitats populaires présentés comme des taudis et des foyers quasi-insurrectionnels.
Grands travaux d’infrastructure et d’équipement
En ajoutant sans précaution, sans ordre, une maison à l’autre puis un quartier à l’autre au gré des initiatives des habitants et des propriétaires coutumiers, on atteint vite un point de saturation : saturation du site (des parties les plus facilement urbanisables), de la circulation, des réseaux d’eau... Si on ne fait rien à l’échelle de la ville ou même de la région urbaine, c’est l’asphyxie. Il est temps alors de lancer un grand programme de viabilisation-drainage-adduction d’eau... On procède alors à une sorte de labourage de l’espace urbain sans trop se préoccuper de ce que l’on "casse". La casse est la rançon de l’incapacité des autorités à prévoir et à planifier. La rançon de l’incurie. L’abomination de la désolation !
Est-ce bien sûr ? Ce n’est pas l’opinion des fonds de coopération ou des entreprises de services (eau, électricité) qui font d’autres calculs. Ces labours fertilisent des espaces densément peuplés, dans lesquels la demande sociale - de circulation, d’eau, d’électricité... - est très forte. Les réseaux sont dès leur mise en service utilisés pleinement. Leur rentabilité est assurée, même si leur installation a coûté cher en raison des frais qu’il a fallu engager pour dégager les emprises publiques. Il est vrai que la plupart des maisons détruites sont des habitats populaires dont le montant d’indemnisation est faible, étant entendu que le coût social ou humain du déguerpissement n’est pas pris en compte.
Ces campagnes de grands travaux que déclenchent les franchissements de ces seuils de saturation urbaine sont aussi des campagnes de réhabilitation des anciennes infrastructures qu’un mauvais entretien a ruinées. D’une pierre on fait deux coups : on accepte que l’autorité publique néglige l’entretien des ouvrages dont elle a la charge, et l’on satisfait pleinement les intérêts des entreprises de services et de travaux exportatrices.
Le grand perdant dans cette histoire est évidemment l’environnement : si on laisse filer la ville au gré de sa fantaisie, on peut être sûr qu’elle ne fera aucun cas de ses ressources naturelles, qu’elle les gâchera allègrement. On ne compte plus les nappes phréatiques polluées par l’urbanisation dite spontanée ou sauvage. Mais en fait ce sont les esprits chagrins qui s’inquiètent : on trouvera bien un bailleur de fonds capable de financer un programme d’amenée d’eau sur 200 kilomètres... Les fabricants de tuyaux sont de fervents supporters de l’aide au développement et savent communiquer leur ferveur à leurs fonds de coopération !
Travaux d’aménagement
Pour l’urbanisme colonial et post-colonial faire la ville c’est avant tout aménager le sol : transformer les terres rurales en terrains urbains, soigneusement délimiter l’espace public, lotir l’espace privé, concéder ces lots etc. Il prend la forme d’un véritable service public foncier.
L’actuel urbanisme a considérablement restreint ses ambitions. Il n’a plus les moyens, dit-il, d’assurer cette production foncière. La seule production qu’il assure est celle que le pouvoir lui demande d’assurer pour affermir sa base sociopolitique. Au service public de l’aménagement foncier urbain d’autrefois succède le service privé foncier des dirigeants, de leurs "clients" et des cadres. Il faut leur servir "sur un plateau" des terrains à construire et des crédits pour construire.
L’abandon du service public foncier n’est pas seulement le résultat d’un repli du pouvoir sur lui-même. Il est aussi le résultat des prescriptions des bailleurs de fonds internationaux qui dès les années 1975 déclarent que toute opération de production de terrains à bâtir doit être : • premièrement, financièrement équilibrée ; • deuxièmement, "réplicable" ce qui signifie que l’argent dépensé doit être récupéré en fin d’opération pour en lancer d’autres ; • troisièmement, concédée à un opérateur privé ou fonctionnant comme un opérateur privé.
On ne sera pas étonné de ce repli vers la demande solvable ou solvabilisée par l’État qui n’hésite pas à bonifier les taux d’intérêt du marché sous prétexte de l’intérêt social de ce qu’on continue à dénommer en toute impunité l’habitat social.
Cette politique est celle de la Côte d’Ivoire (jusqu’en 2000). Elle n’est pas sans mérite car elle a eu une acception assez large de sa cible sociale et a mis (jusqu’à ces derniers mois) beaucoup de moyens dans l’entreprise. Ce qui a donné lieu à la construction d’immenses quartiers neufs garnis de villas souvent prétentieuses ou de "pavillons" plus modestes construits à la chaîne par d’irrésistibles promoteurs oligopolistiques tenus à bouts de bras par l’État.
Le service public foncier n’a été maintenu que par le Burkina Faso révolutionnaire du populiste et dynamique Sankara. Durant son règne (1983-1988), à Ouagadougou, près de 70 000 parcelles ont été produites et distribuées sans faire trop de cas du niveau de revenu, du rang social et du statut des attributaires. Cette politique dite "une famille un toit" s’affichait comme une politique de l’habitat pour tous. Sa principale vertu a été, de notre point de vue, de faire la démonstration que la rareté foncière n’était pas une fatalité ou une conséquence inéluctable de l’urbanisation. Elle démontre, au contraire que la rareté foncière est le résultat d’une gestion égoïste de la ville par des dirigeants dont le dernier des soucis est de satisfaire des besoins populaires.
Cette politique d’« abondance foncière » a été menée sans compétences urbanistiques satisfaisantes, dans l’improvisation et la précipitation qu’affectionnent les mouvements dits "populaires". Faut-il s’en étonner ? On doit parfois choisir : ou bien on "œuvre" la ville (on en fait une œuvre) ou bien on "produit" du terrain à bâtir pour tous, en prenant de vitesse les opposants de tous poils et en se dispensant de recourir aux bailleurs de fonds internationaux et à leurs experts. L’assassinat de Sankara a mis fin à l’expérience. Mais la démonstration a été faite : un autre ordre urbain est possible en Afrique.
3 - Conclusion : un urbanisme à inventer.
L’urbanisation file entre les doigts des urbanistes. Les uns serrent les doigts en tentant de limiter le flux et rêvent nostalgiquement d’un urbanisme colonial moins colonial. Les autres desserrent les doigts en se réjouissant du spectacle de l’urbanisation se répandant sur le sol en une sorte de pâte urbaine (de logements, de terrains, de services, de forces de travail...) qu’il s’agit de rationaliser comme marché et comme espace à équiper, à aménager... Les troisièmes - les moins nombreux - desserrent eux aussi les doigts en se réjouissant de la vitalité sociale de cette urbanisation, du mouvement brownien des associations... qu’il s’agit de raisonner techniquement sans nuire à leur vigueur. Les urbanistes du premier type ont perdu, les deuxièmes sont aux commandes, les troisièmes entrent en scène. Ces derniers ont à construire une nouvelle alliance avec la société civile (pour faire court) mais en prenant appui sur de véritables compétences techniques et politiques municipales. Il est fait le pari que les municipalités ne sont pas des États en miniature, qu’elles ont d’autres intérêts politiques, qu’elles peuvent être soumises à un contrôle démocratique et que par conséquence elles auront à inventer d’autres urbanismes. Le pari est raisonnable.
Jean François Tribillon
décembre 2002