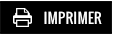L’idée de marché dans la pensée économique - Elsa Assidon
Publié par , le 13 mars 2007.
Cette contribution propose à la discussion quelques éléments de réflexion sur l’idée de marché. Non sur le marché en tant que concept, mais sur l’idée ou les idées que les théories économiques ont contribué à forger, et qui inspirent ou légitiment les politiques économiques.
Commençons par décomposer l’idée de marché que nous avons. Si on vous demande de définir le marché, vous pensez, comme moi, à l’échange, à des biens et des services, à des prix, à la monnaie, à un lieu localisable ou non dans l’espace, à des réglementations, etc. Voici donc un premier inventaire. On précisera d’emblée que les marchandises n’allant pas toutes seules au marché, il y a également des individus, des groupes sociaux, et aussi l’Etat comme expression des intérêts d’une communauté humaine : il édicte des règles, il émet la monnaie ; son existence délimite un espace au marché.
La première remarque que l’on peut faire c’est que l’Etat est dans le marché, comme composante du marché.
Si l’on poursuit cette mise à plat et que l’on se demande quelle idée est associée communément au marché, on trouve l’idée de concurrence, d’efficacité, auxquelles est généralement couplée la dimension nationale et internationale du marché.
Nous sommes censés vivre, nous, dans une économie de marché. Et les pays de l’Est, comme ceux du Sud sont aujourd’hui dits en transition vers l’économie de marché, après l’abandon des planifications centralisées. Et cette transition serait associée à l’apprentissage de la démocratie de type occidental.
Ici et ailleurs, avec les millions de chômeurs, on nous promet les lendemains qui chantent. Le choix du marché impliquerait donc des sacrifices transitoires. Le développement du marché a besoin d’un support idéologique. On nous invite à croire au marché, faute de mieux diront certains. Et on évoque l’incontournable « loi du marché ». Quelle loi ?
Chacune des propositions que je viens d’émettre nécessiterait une analyse approfondie.
Ce que je vais essayer de faire, dans cet exposé introductif, c’est d’abord de repérer dans la pensée économique comment s’est forgée l’idée que nous avons du marché. A ce titre, on peut relever quelques déplacements majeurs dans l’histoire de la pensée économique, et notamment le glissement qui s’est opéré entre le marché conçu dans une perspective d’accumulation du capital, et le marché conçu dans une optique d’équilibre, le glissement entre une perspective macro-économique où l’Etat avait naturellement sa place et une optique micro-économique où l’Etat n’a plus de place, où la relation entre Etat et marché est par définition antagonique et ne peut être traitée que par des contorsions analytiques. Chemin faisant, il est intéressant de pointer le sort réservé à la dimension internationale du marché, et à la monnaie.
Dans un deuxième temps, je vous propose d’examiner la projection de l’idée du marché dans la pensée économique du développement ou de la transition comme disent les économistes néo-classiques maintenant, assimilant l’Est et le Sud. Sur ce thème qui m’est plus familier, il existe une réflexion importante : celle-ci est ballottée entre, d’une part, la projection, dans des contextes particuliers, des concepts conçus pour des économies salarisées et industrialisées, en particulier celui du marché, et d’autre part la relativisation de ces concepts et, plus généralement, celle des outils de l’analyse économique.
L’IDEE DU MARCHE DANS L’ECONOMIE POLITIQUE CLASSIQUE
Les spécialistes de l’histoire de la pensée économique vous diront que, bien avant Adam Smith et David Ricardo, des questions fondamentales de l’économie politique avaient été soulevées et analysées. Sur la place du marché et de l’échange, les classiques ont toutefois fait franchir une étape décisive à la pensée économique, quitte à avoir repris à leur compte des éléments de réflexion de leurs prédécesseurs.
L’économie politique classique propose un schéma général de l’accumulation du capital et de ses enjeux dans lequel s’insère le marché.
Quel est ce schéma ? De façon simplifiée, on peut dire que l’accumulation (on dirait aujourd’hui la croissance mais, on verra justement pourquoi les deux termes ne sont pas synonymes), se déroule au cours de périodes chaînées entre elles. Le revenu atteint à la période 1 détermine le niveau de départ de la production de la période 2. La part du revenu qui revient aux capitalistes industriels est déterminante, car d’elle dépend l’avance de capital (fonds de salaire inclus) de la période 2. Et c’est le développement de la production industrielle qui est susceptible d’accroître le plus rapidement « la richesse des nations » car, dans ce secteur, le progrès technique permet la division du travail et la multiplication rapide des biens. Les butoirs de cette accumulation proviennent de la rareté des ressources du sol et du sous-sol dont dépend l’offre d’aliments et de matières premières. Si l’économie doit s’ouvrir, c’est d’abord pour faire reculer ces butoirs : pour l’Angleterre en pleine révolution industrielle, il est impératif d’aller chercher ses aliments et ses matières premières là où elles sont les moins chères et de cesser de protéger le blé national.
Quel est le statut du marché dans ce schéma ?
Le marché est le lieu de l’échange où se forment les valeurs d’échange des marchandises. La condition pour que le marché joue ce rôle, c’est une massification des marchandises, c’est la généralisation de l’échange.
Ce qui a surtout retenu l’attention, à ce titre, c’est non seulement la relation valeur-prix des biens, mais surtout l’idée que, sur le marché, va se lire une mesure de la valeur des biens. Le problème de la mesure n’obsède pas encore les économistes du temps des classiques. Cela viendra par la suite, avec l’économie walrassienne, et avec l’économie politique de la planification. Les classiques, eux, formulent des lois de formation de prix, liant ces derniers à la répartition du revenu, pour ce qui est des « prix naturels » autour desquels vont graviter des prix de marché, qui, eux, dépendent de l’offre et la demande.
– Le marché est le lieu de valorisation du capital. Cette idée a largement été reprise et étayée par Marx. Il est le maillon qui lie les périodes entre elles. Il représente le moment où se forme, avec les prix, le profit et celui où les marchandises se transforment en revenu monétaire.
Peut-on alors considérer que, dans ces conditions, la monnaie n’est qu’un voile ? Dans n’importe quel manuel sur la monnaie, vous pourrez lire que les économistes classiques traitent la monnaie comme un voile : le système des prix relatifs des marchandises est défini à partir de la théorie de la valeur-travail et la monnaie n’intervient que pour fixer le niveau général des prix. Par la suite, la théorie néo-classique affirmera la même chose tout en proposant une autre théorie de la valeur. N’a-t-on pas tendance à lire les classiques en termes néo-classiques, comme si leurobjet était de définir un système de prix d’équilibre ? Marx, en introduisant l’équivalent général dans la théorie de l’échange, et en soulignant que l’échange est monétaire par définition dans l’économie capitaliste, a plutôt consolidé l’approche des classiques.
– Fondamentalement, l’espace du marché est national, il est défini par l’espace de l’accumulation. L’exportation n’est pas un objectif en soi, elle permet de payer les importations qui soulageront la contrainte naturelle qui pèse sur les biens non reproductibles (ressources du sol et du sous-sol).
Sur ce point, il importe de dire un mot de la théorie des coûts comparatifs ; dans l’analyse de Ricardo, cette démonstration, fort astucieuse, est redondante si son objet est de démontrer la nécessité de l’ouverture pour l’économie anglaise ; la théorie de la rente foncière suffit. Ce qu’ajoute la théorie des coûts comparatifs, c’est l’argument que la spécialisation est avantageuse non seulement pour l’Angleterre mais également pour le Portugal, bien que ce dernier ait des coûts absolus pour le vin et de drap inférieurs aux coûts anglais. D’une certaine façon, Ricardo répond à ses prédécesseurs qui raisonnaient en termes de coûts absolus. L’idée de monnayer, dans l’échange international, un avantage relatif ou l’avantage d’une dotation initiale en ressources, servira par la suite de fondement à la notion de compétitivité.
Si l’on récapitule l’idée du marché chez les classiques en fonction de notre inventaire initial, le marché est bien le lieu de l’échange des marchandises (parmi celles-ci, Marx ajoute la force de travail), où se forment les prix en fonction des coûts de production ; de leur niveau dépend le taux de profit des capitalistes et le rythme de l’accumulation. L’idée du marché comme lieu de la concurrence existe, mais celle-ci est avant tout la condition de l’égalisation des taux de profit et donc de leur répartition entre les branches. Cela signifie-t-il que nous serions en présence d’un « marché des capitaux », au sens où l’on entend cette expression aujourd’hui ? Non, puisque toutes les marchandises deviennent du capital dès lors qu’elles sont sur le marché.
Sur ce marché, l’Etat a des tâches bien précises à accomplir : d’abord celle d’adapter la réglementation de telle sorte que la répartition des revenus se fasse en faveur du profit, ensuite celle de faire un espace monétaire homogène et viable (passage par la monnaie oblige). Sur ce point, le pouvoir régalien de battre monnaie n’est plus perçu comme une question de finances publiques, il est envisagé en fonction de la mise en place d’un système monétaire et bancaire « moderne », adapté à une économie, monétarisée.
La théorie néo-classique
Avec la théorie néo-classique, la vision du marché est profondément transformée. Ce n’est pas tant la substitution d’une théorie de la valeur à une autre qui est en elle-même le changement majeur. C’est la démarche qui devient toute autre. Le marché devient métaphorique, fait de rencontres perpétuellement recommencées, entre une offre et une demande ; le marché apparaît comme un lieu où se renégocieraient à chaque fois des contraintes, des avantages, et des préférences. Finalement, on ne sait pas si l’offre et la demande ont beaucoup d’enfants, car l’histoire s’arrête quand l’équilibre est atteint, quand il n’y a plus d’excès d’offre ou de demande, quand toutes les offres et les demandes sont casées. On nous présente un conte, y compris sous forme mathématique, qui part d’une multitude d’individus sans princesse endormie et sans vilaine sorcière, autant de courbes d’offre et de demandes qui finissent par n’en faire qu’une par type de biens et de services, jusqu’à ce que soit atteint l’équilibre général, ie un système de prix d’équilibre.
L ‘individualisme
Il n’y a plus de capitalistes, de travailleurs et de propriétaires fonciers. Il y a des individus, pris un à un, qui expriment sur un marché leurs contraintes et leurs préférences et qui cherchent à maximiser leurs avantages. Le marché émet des signaux que sont les prix, lesquels, au terme d’un processus de tâtonnement, vont rendre compatibles les offres et les demandes.
Les économistes vont faire ainsi du marché le lieu de socialisation de l’individu : ce qui relie cet individu au reste de la société, c’est le marché. Il y exprime ses préférences par la demande (les « habitudes », les « goûts » des consommateurs) ; il s’exprime seul comme il le fait avec son bulletin de vote dans l’isoloir. Il vient sur le marché avec sa contrainte budgétaire - son revenu représente ainsi non seulement sa capacité à acheter des biens et des services, mais la première façon d’être reconnu socialement .
L’équilibre
Dans la théorie néo-classique traditionnelle, l’existence de l’équilibre est postulée et non démontrée. Ce qui est démontré, c’est la stabilité de l’équilibre dans le cadre des hypothèses retenues .
Si le marché est parfait, cet équilibre est le meilleur possible ; d’équilibre en équilibre, on se place sur le sentier de croissance le plus élevé.
C’est à ce stade que l’idée de la concurrence prend tout son sens. Un marché parfait est un marché de concurrence, c’est-à-dire d’atomisation telle que chaque individu puisse exprimer totalement ses contraintes et ses préférences. Toute coalition, toute entente, provoquent un équilibre sub-optimal. La tâche de l’Etat est, dans cette optique, de les empêcher et de corriger les autres imperfections du marché.
On remarquera que la définition de la concurrence est particulièrement abstraite ; elle est d’abord atomisation, la différenciation n’est prise en compte que dans les dotations initiales respectives. Le marché sanction - que le meilleur gagne - n’est qu’un épisode accidentel, en attendant que la mobilité nivelle les rendements jusqu’à un point supposé d’équilibre naturel .
L’espace de ce marché-là est indéfini. Si les individus sont inégalement dotés au début de l’histoire, tout comme les pays, en ressources, en capacités, en préférences, plus large sera la confrontation des offres et des demandes, plus l’ensemble-monde y gagnera et donc tout un chacun, comme les sous-ensembles formés par les pays particuliers. Dès que l’on procède à un découpage spatial ou sectoriel, on peut introduire l’idée de compétitivité d’un sous-ensemble par rapport à un autre.
Que devient l’Etat dans ces conditions ? Le seul statut qui soit possible pour lui, c’est d’être un individu de plus et de se comporter comme tout un chacun. Il ne peut exister sans perturber la belle harmonie que l’on vient d’esquisser. Emettre de la monnaie, oui, cela fait partie de ses attributs comme la justice et la police. La monnaie facilite les transactions, et cette fonction est perçue comme, la plus importante. Mais que l’Etat prenne garde de ne pas perturber l’équilibre en en émettant trop ou pas assez (il ne perturbe d’ailleurs que le niveau général des prix, donc le taux de change, ce qui modifie les avantages - la compétitivité - par rapport aux autres espaces monétaires).
Les inflexions
Si les théories anciennes des structures de marché asymétriques (monopole, oligopole, monopsone) n’étaient conçues que comme des déviations par rapport au schéma précédent et ne représentaient pas une alternative théorique, l’idée de l’imperfection des marchés a pris racine depuis Keynes dans la théorie dominante.
La politique économique du laissez-faire, inspirée de la théorie néo-classique, ne permet pas la résorption du chômage et la reprise de l’investissement après la crise de 1929. Keynes avance l’idée que l’équilibre ne garantit pas le plein emploi car deux prix ne jouent pas le rôle qui leur est attribué par la théorie précédente : le salaire et le taux d’intérêt. L’Etat a pour charge de réaliser le plein-emploi et donc d’assurer un taux de croissance suffisant. Keynes revient en quelque sorte à l’économie politique.
Depuis une vingtaine d’années, on relève dans la théorie néo-classique , des contributions qui remettent en cause l’idée d’un équilibre général correspondant à l’optimum dans les hypothèses définies précédemment. La nouvelle micro-économie introduit des hypothèses pour l’étude des marchés et des comportements d’agents. Tel est le cas par exemple des théories bâties à partir d’une hypothèse d’information imparfaite. La nouvelle économie des contrats et des conventions, avance l’idée selon laquelle les agents agissent dans un monde qui est trop complexe pour être tout à fait transparent. Elle introduit l’idée du risque qui implique, pour les agents, le déploiement de stratégies complexes. La gestion du père de famille, avec sa contrainte budgétaire, est devenue ringarde. La nouvelle image du marché est celle du risque, elle est cynique et elle s’affiche ; c’est celle des golden boys, spécialistes des spéculations financières, entourés d’ordinateurs. Il y a maintenant des gagnants et des perdants. On a l’impression que la main invisible, qui finissait un jour par réaliser l’équilibre bienfaiteur de la fable, a disparu dans les tours de verre et d’acier. La loi du marché, celle qu’on dit être de la concurrence, est, elle, le pain quotidien de tout un chacun, comme une résignation, en attendant les lendemains qui chantent.
L’IDEE DE MARCHE DANS LA PENSEE ECONOMIQUE DU DEVELOPPEMENT
L’économie du développement apporte sur l’idée de marché, des éléments particulièrement intéressants. Les thèses de la dépendance ont exploré les phénomènes de domination par le marché. Et du côté des analyses néo-classiques, le dogme du libre-échange apparaît dans ce champ sous un éclairage particulier.
Spécialisation inégale et libre-échange
L’entrée sur le marché n’offre pas des avantages partagés par tous - les premiers entrés sont les gagnants. Donc, les premiers entrés ont intérêt à intégrer au marché les seconds, puis les troisièmes, etc.. car leurs avantages s’accroissent à chaque fois. Telle est la logique des analyses de la spécialisation inégale, à l’échelle mondiale. L’avantage est fondé sur l’antériorité (de l’industrialisation, de la démocratie qui permet d’obtenir des hausses de salaires, etc.).
En revanche, les thèses libérales ne se départissent pas de l’affirmation selon laquelle les avantages sont partagés dans l’échange international et, quelles que soient les nuances apportées dans l’analyse du protectionnisme, elles n’ont pas renoncé au dogme du libre-échange.
Pourquoi l’ouverture des économies représente-t-elle dans ces analyses un préalable si crucial ? Jusqu’à la fin des années 1970, l’ouverture des économies était conçue à travers un enjeu industriel, dans la logique des coûts comparatifs. La multiplication des crises financières, au tournant de la décennie 1980, l’idée que tous les pays n’accéderont pas à un processus d’industrialisation durable (cf. le rapport Berg - Banque mondiale, de 1981, sur l’Afrique sub-saharienne) déplacent en amont les questions de la transition : ce qui fait défaut dans ces économies, ce n’est pas tant l’industrie que le marché. L’absence de marché signifie l’absence de norme, de signaux en fonction desquels allouer les ressources. Quand, par exemple, la Banque mondiale traite des économies en transition ou en développement, tout se passe comme s’il y avait un ailleurs (le marché mondial, les pays industriels) où sont définis les prix d’équilibre. L’économie doit s’ajuster à cet ailleurs (y compris dans la politique économique), tout en créant le marché. Tels sont les fondements bien connus des politiques d’ajustement structurel.
La dimension internationale fournit donc une norme de référence ; l’idée n’est pas nouvelle (les « prix de référence » dans l’évaluation-projet par exemple). Ce qui est nouveau, c’est qu’en abandonnant l’enjeu de l’industrialisation dans le développement, on évacue la discussion sur les modalités concrètes de l’industrialisation comme support du développement. On évacue l’idée même d’accumulation, y compris celle de considérer qu’elle ne passe pas forcément par l’industrialisation, telle que la concevaient jusqu’ici les modèles de développement. Aucune discussion n’est possible concernant cette norme abstraite qui est placée au centre de l’argumentation. Son existence étant purement et simplement postulée, c’est un peu comme si on nous demandait de croire au « marché » comme on croit en Dieu. Et on n’aurait rien à y perdre puisqu’il n’y a plus d’alternative, etc. On est en face d’un dogme justifié par la faillite des économies socialistes.
Le marché de l’extraversion et les autres. Retour aux marchés concrets
Les approches de la dépendance extérieure, introduisent une dimension socio-historique. Elles soulignent que le marché existe, et qu’il est le produit d’une domination extérieure. Et qu’il continue à l’être. On peut difficilement contester cette évidence.
Cependant, le seul marché qui soit au centre de l’analyse de la dépendance, est celui de l’extraversion. Le surplus potentiel pour le développement se trouve dans le secteur d’exportation, seul susceptible de procurer des devises, c’est-à-dire une monnaie ayant un pouvoir libératoire plus grand que la monnaie nationale non convertible. Quel statut donner alors aux petits marchés ruraux, à l’informel, etc. Devra-t-on donc parler de « dualisme » ? Cette approche, quelles que soient ses insuffisances, a eu, dans le passé, le mérite de contester les hypothèses d’homogénéité des analyses dominantes. Elle a également sorti des oubliettes l’approche de l’accumulation des économistes classiques (cf. la thèse de Lewis, 1954, sur le surplus de main-d’oeuvre). Elle a surtout incité les économistes à s’interroger sur les caractéristiques des marchés concrets.
Une intéressante réflexion s’est développée à partir du contexte des pays en développement sur l’informel ; le rapport entre la loi et le marché, la question des activités illégales ou non déclarées, le rôle des coutumes, sont des aspects essentiels et spécifiques.
Si l’approche socio-anthropologique des marchés, dans les pays en développement, est aujourd’hui davantage retenue et a eu tendance à se substituer à l’approche historique, l’archéologie des marchés concrets, y compris ceux de l’extraversion, reste un vaste chantier de recherches potentielles. Dans un travail de recherche précédent, j’ai, pour ma part, essayé de mettre en évidence sur les marchés de la zone franc, des processus de monétarisation particuliers et j’ai proposé la dénomination de « marchés captifs » pour les désigner. On pourra revenir sur ce point au cours du débat.
Pour conclure, on peut dire que l’idée du marché que nous avons, et principalement celle de la compétitivité et du libre-échange qui lui est associée, est héritée de la théorie néo-classique. Mais les fondements théoriques que nous propose la pensée économique pour étayer l’idée de l’accès à un optimum ou à une croissance accrue par la voie d’une régulation par le marché, ou encore la fameuse loi de l’offre et de la demande (laquelle ? celle des marchés « parfaits » et de l’équilibre ?), sont relativement fragiles et aujourd’hui discutés à l’intérieur même du courant néo-classique. Cela peut s’interpréter de plusieurs manières, et je laisse à chacun le soin de le faire dans le débat.
Elsa Assidon