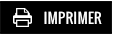La logique de guerre est-elle compatible avec la démocratie ? - Marc Mangenot
Publié par , le 13 mars 2007.
on veut bien faire abstraction des grandes phases de l’histoire récente pour résumer l’argument, le marché, tel qu’il s’est imposé et développé depuis deux siècles, se présente comme un lieu d’affrontements.
Même en période d’expansion, la concurrence entre les firmes est patente et suppose, pour le moins, le secret (des affaires, de fabrication) (1), et la recherche du moindre coût et du profit maximum. Cette concurrence s’accommode de logistiques étatiques, supra-étatiques (militaires ou civiles), mafieuses, d’ententes en tous genres, ou même, et plus souvent encore, les exige.
Les cadres juridiques nationaux ou internationaux, jouent en fait tout à la fois ou successivement le rôle de régulateur, d’incitateur, de protecteur, de vecteur du capital.
En conséquence, le théâtre des opérations a toujours été complexe, fait d’alliances conflictuelles et changeantes à tous les échelons géopolitiques. Il n’a pas été, ne pouvait pas être, ne peut pas être la rencontre d’une multitude d’échangistes, obéissant chacun à des règles communes, empreintes d’une déontologie respectueuse et sans faille majeure.
Fondamentalement, l’échange ne concerne pas des équivalents : d’un côté la force de travail, c’est-à-dire une valeur d’usage contre, d’un autre côté, une valeur d’échange résultant du procès de production capitaliste qui met en oeuvre la force de travail. L’illusion vient du fait que la force de travail n’a pas de valeur (elle la produit), mais un prix (comme le sol, le sous-sol, l’oeuvre d’art...). Ce prix, variable selon les rapports de force, s’exprime dans le salaire qui, sous la forme argent équivalent général, peut s’échanger contre des marchandises qui sont des valeurs d’échange. La force de travail, valeur d’usage, produit plus de valeur qu’il ne lui en est restitué. C’est sur le marché capitaliste généralisé que s’opère cet échange d’inéquivalents. Ce marché suppose que la force de travail est, non pas libre, mais libérée de ses attaches historiques (maître, tribu, terre et autres moyens de production...).
En termes plus triviaux, quelle est l’arme principale de cette guerre permanente ? la force de travail. Le marché du travail est dès lors au centre du dispositif. Quel est l’objectif de chaque protagoniste (bien qu’ici il faudrait préciser les différences de temporalité, distinguer entre chaque type de protagoniste et montrer les enchevêtrements et les contradictions) ? la richesse et la puissance. Quel est le truchement par lequel l’échange se tranforme en affrontement (outre les truchements institutionnels, militaires ou mafieux) ?
Tout cela est à la fois évident et, paradoxalement, sujet à controverses.
Rappelons-nous, après les débuts du capitalisme, la situation qui prévalait au premier tiers du 19e siècle et les débats, en France, autour du travail des enfants, qui visaient notamment l’industrie textile. L’industrie textile connaît alors une période de surproduction (au sens capitaliste). Les révoltes ouvrières gagnent en puissance (let es canuts lyonnais et bien d’autres ouvriers du textile dans nombre de régions). L’initiative d’une limitation du travail des enfants vient d’Alsace où, sur 61.000 salariés en 1840, dans le Haut Rhin, on compte quelque 13.000 enfants., relativement beaucoup plus qu’ailleurs. Une telle proportion était particulièrement inquiétante du point de vue du patronat alsacien qui craignait pour la reproduction (mortalité élevée) et la discipline (éducation non contrôlée) de la classe ouvrière.
La loi de 1841 sur la limitation du travail des enfants (interdiction aux moins de 8 ans, limitation pour les 8/12 et 12/16 ans, délivrance d’un livret comme pour les adultes) visait ainsi plusieurs objectifs :
• limiter la production
• réaliser des gains de productivité (qui recouvraient aussi un accroissement de l’intensité du travail)
• ne pas créer de déséquilibres (sur ce point) dans le jeu de la concurrence grâce à la généralisation de la mesure
• éviter un dépérissement trop accentué de la classe ouvrière, sans laquelle il n’y avait ni production, ni plus-value, ni -par ailleurs- de forces armées suffisantes
Aujourd’hui les débats portent aussi sur la réduction de la durée du travail mais encore sur le travail des enfants.
Nombre d’entreprises (cette fois, ce n’est pas réservé aux mines, au textile ou à la métallurgie) ajustent les effectifs (souvent en anticipant lourdement, au risque d’accroître la difficulté en croyant prendre de l’avance sur les autres) à la production jugée optimum, chacune pour elle-même. Ces décisions, de plus en plus nombreuses, répétées et accélérées, ont pour effet d’accentuer encore la rupture du lien qui a prévalu durant l’époque qualifiée de fordiste (restriction des pouvoirs d’achats, par conséquent de la demande...).
La réduction de la durée du travail pourrait compenser des pertes d’emploi, très partiellement toutefois, même avec un passage rapide aux 35 heures, ce qui pose un immense problème social que le marché ne saurait aider à résoudre.
Qu’on ne s’y trompe pas, cependant. La croissance colossale de l’inoccupation, et du chômage, sur l’ensemble de la planète, n’a pas pour origine directe l’introduction de nouvelles techniques ou de nouveaux matériaux. Mais, ce qu’on appelle le « progrès technique » contribue (avec la croissance démographique) au développement d’une forte surpopulation inoccupée, parce qu’il est d’abord recherché et mis en oeuvre pour des gains de productivité générateurs de profit dans l’entreprise, et non pour réduire les nécessités, et ouvrir de nouveaux horizons.
Cette course à la productivité (comme on a parlé de la course aux armements) est même devenue insuffisante dans les pays industrialisés du Nord capitaliste. Il a fallu revenir aussi (ce n’est jamais tout à fait abandonné, simplement mis au second ou au troisième rang, selon les périodes ou les régions) sur le terrain privilégié de la recherche du moindre coût, en augmentant les rythmes de travail, en réduisant au maximum les salaires, en se déployant là (2) où la main d’oeuvre est surabondante, soumise à des régimes autoritaires ou de franche dictature, contrainte à subir des conditions de travail très dures, y compris le travail des enfants.
Le résultat est la mondialisation du marché du travail (avec des strates, des particularités ...), et la concurrence exacerbée entre populations, éloignées ou non géographiquement, et luttant chacune, croit-elle, pour sa survie.
Cette mondialisation du marché du travail est concomitante à celle du marché des capitaux et des marchandises, elle lui est nécessaire, elle en est la condition (quel que soit le statut formel : salariat, quasi salariat...). Elle n’a rien d’accidentel, ni dans son extension, ni dans ses conséquences.
L’histoire alors bégaierait-elle ou bien montrerait-elle une certaine continuité ? Toujours est-il qu’en juin 1993 les grands patrons du textile européen (encore eux) ont proposé l’introduction d’une clause sociale dans les accords relatifs aux échanges internationaux. Ce manifeste a également été cosigné par des confédérations patronales nord américaines et japonaises et par la CSE (Confédération syndicale européenne).
Toujours en juin 1993, les fédérations patronales du textile européen (CEE) font publier dans la presse un texte dans lequel elles demandent les mêmes droits de douane partout, « la répression contre les atteintes à l’environnement » et « l’abolition des conditions de travail inhumaines et d’abord l’esclavage des enfants ». Elles ne prônent pas la réduction de la durée du travail dans les entreprises européennes, mais s’insurgent contre les conditions de travail inacceptables des ouvriers (et notamment de l’exploitation des enfants), et du non respect des droits de l’homme dans les pays dits à bas salaires, après avoir largement contribué au développement de l’industrie textile/habillement afin de tirer profit des basses rémunérations et des mauvaises conditions de travail (durant cette période des 20/30 dernières années, ni la démocratie, ni les droits de l’homme ne préoccupaient particulièrement le patronat européen du textile/habillement).
Ce bref propos s’insère dans le débat sur « marché et démocratie », où l’on s’aperçoit que la logique de guerre, celle du marché capitaliste généralisé, est incompatible avec la démocratie. Ou alors, dans le meilleurs des cas, ce qui n’est pas avéré, on aurait une démocratie à l’athénienne, dont se satisferaient ceux-là qui en jouissent, les autres étant voués au travail « productif » dans des conditions auxquelles ils devraient bon gré mal gré se soumettre, et confinés dans des jeux démocratiques, sujets à variation et restiction selon les contextes.
Par ailleurs, on a vu aussi les résultats du mimétisme industriel dans le tiers monde, et les effets d’une économie confisquée et administrée dans les pays qui se prétendaient socialistes. Cependant, on peut (peut-être) s’accorder sur l’idée (trop générale) qu’une société sans échanges est vouée à la disparition rapide et ne peut, en toute hypothèse, créer d’espaces de liberté. Or, nombre d’échanges ne peuvent se développer, dans notre période et probablement pour longtemps, hors du marché monétarisé.
En résumé, puisque d’une part, l’échange par le marché est une possibilité de créer des espaces de liberté et de diffusion de la connaissance, puisque d’autre part, le marché généralisé est fondé sur une logique de guerre incompatible avec la démocratie à quelque niveau que ce soit (sauf en quelques lieux et moments privilégiés ?), il convient :
• de desserer l’étreinte du marché, en libérant au maximum la force de travail, du marché, en donnant plus de temps à l‘individu, en ouvrant des espaces-temps pour la connaissance, pour la rencontre, pour les citoyens,
• conséquemment, de réduire la sphère de la production marchande, et de favoriser les activités et les échanges non marchands,
• de réguler le marché (ainsi limité), de le doter de règles et de moyens (adaptatés à chaque époque et à chaque région), tels qu’il soit efficient et régulateur, et non pas un système omniprésent et contraignant.
1- En période d’expansion, dans les régions du Nord industriel et capitaliste, la violence de la concurrence pouvait être plus ou moins masquée par l’équilibre dynamique productivité/production/consommation, tout une partie de la planète étant abandonnée au mimétisme développementiste dont on voit plus clairement, depuis une quinzaine d’années, les effets délétères, en Afrique plus qu’ailleurs. En période de crise, la compétitivité se joue aussi entre nations (ou groupes de nations) : c’est la recherche de la flexibilité et des bas salaires, en même temps que la tentative féroce d’user plus systématiquement des vecteurs étatiques ou supranationaux, les discours ultralibéraux se faisant plus discrets ou entrant en contradiction forte entre eux, et entre eux et la réalité.
2- Là, c’est-à-dire dans les pays de « délocalisation » ou dans dans les zones d’immigration.
Marc Mangenot
(26 septembre 1993)