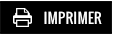Mener des opérations d’aménagement
Publié par , le 6 mars 2007.
1. Spécificité
Aménager c’est changer la ville comme cadre de vie, de travail, d’habitat... Le changement s’opère par toutes sortes de moyens et de procédés : en réalisant des équipements, en favorisant l’implantation de nouvelles activités économiques, en contrôlant l’occupation du sol... Ces changements ne constituent pas dans tous les cas des opérations.
Une opération d’aménagement implique que l’aménagement soit non seulement projeté (qu’il fasse l’objet d’un projet d’ensemble) mais aussi que sa mise en œuvre soit organisée par l’affectation de moyens et de ressources et par la désignation d’un opérateur qui fait son affaire de la bonne marche de l’opération dans les délais prescrits.
La question des moyens et celle de l’opérateur sont centrales. La collectivité publique se donne les moyens de transformer l’espace : en agissant sur l’appropriation du sol et en en modifiant la valeur ; en agissant sur l’équipement du périmètre à aménager... Elle ne se contente pas de planifier, de réglementer, d’encourager... Elle passe aux actes : exproprie et détruit ces vieux hangars qui bloquent l’extension du centre ville, construit des parkings, restructure l’ancienne place centrale...
On comprend que, dans ces conditions, la collectivité publique, notamment la commune, souhaite confier la gestion de ces opérations d’aménagement à un opérateur qui réponde de sa gestion devant elle en sa qualité d’autorité publique qui a lancé l’opération, qui en assure directement ou indirectement, totalement ou partiellement, le financement, qui court le risque d’une sanction électorale en cas d’échec...
Cette première approche de la notion d’aménagement et d’opération d’aménagement permet d’en souligner la spécificité et de les distinguer des activités de travaux et de service. L’aménagement est un ensemble complexe de tâches très diverses. L’aménageur fait des travaux parmi bien d’autres tâches. L’amé-nageur équipe, crée des ouvrages publics, favorise le développement des services publics, mais n’en gère aucun. Lui-même a une mission trop large (changer la ville) pour qu’il soit en tant que tel considéré comme prestataire de service public. Tout ceci invite à considérer l’opération d’aménagement comme une troisième catégorie d’activité publique s’ajoutant à celles qui font l’objet des deux parties précédentes.
2. Réaliser un petit aménagement communal
- Principe de réalité.
La municipalité de telle petite ville dispose d’un terrain de quelques hectares en prolongement direct d’un quartier existant qu’il s’agit d’étendre. L’opération n’est pas compliquée. La greffe du nouveau sous-quartier (une cinquantaine de parcelles) sur l’ancien quartier sera facile à réussir. Les équipements à renforcer sont déjà installés dans l’ancien. Seules quelques voies de desserte en prolongement des voies existantes sont à créer en même temps que le parcellaire. Les conditions d’attribution ont été définies depuis longtemps par le conseil municipal en liaison avec le conseil de quartier : les terrains seront cédés aux jeunes ménages du quartier existant qui cohabitent avec leurs parents. La liste des cinquante bénéficiaires consentants a été arrêtée très récemment.
Dans ces conditions, il sera difficile de faire comprendre à la collectivité publique qu’elle doit s’en remettre du soin d’aménager à un opérateur disposant d’une autonomie technique et financière suffisante. L’idéal du recours à un aménageur professionnel opérant pour le compte de la collectivité locale réduite à un rôle de maîtrise de l’aménagement organisée en opération d’aménagement aura ici beaucoup de difficultés à triompher. Il se peut fort bien d’ailleurs que l’aménageur professionnel en question ne soit pas intéressé par une opération si petite en taille et se déroulant dans une lointaine petite ville de province. Il faut se résoudre à accepter que l’aménagement en question et généralement tous les petits aménagements municipaux du même ordre soient réalisés en régie par la commune. Ce parti pris de réalisme ne doit pas conduire à l’acceptation de n’importe quelle pratique. Un effort de méthode et d’organisation institutionnelles s’impose.
- Distinction entre ceux qui dirigent et ceux qui opèrent.
La première précaution consiste à distinguer deux ensembles de tâches dans la fonction d’aménageur assurée par la municipalité :
– un premier ensemble incombant au conseil municipal et au maire qui engagent le processus, définissent les objectifs, acceptent le projet, dirigent...
– un deuxième ensemble incombant aux services techniques en charge de résoudre les problèmes fonciers, de mener les travaux... placés sous l’autorité d’un technicien (par exemple le chef des services techniques).
Cette distinction entre ceux qui dirigent et ceux qui opèrent pourrait contribuer à mieux définir les responsabilités et en particulier à donner aux « opérateurs » une certaine autonomie fonc-tionnelle faute de leur reconnaître l’indépen-dance professionnelle dont jouissent les maîtres d’œuvre et dans une certaine mesure l’aménageur professionnel. Il semble normal également, et même prudent, de prévoir l’attribution à ces opérateurs de fait d’une rémunération accessoire et supplémentaires pour services rendus.
- Collaboration avec l’Etat.
Nous avons admis implicitement jusqu’ici que l’opérateur (de fait et non de droit) est une équipe de techniciens municipaux. Or la réalité municipale africaine est tout autre. Rares sont les villes qui disposent de tels techniciens. Elles sont alors contraintes de recourir aux services d’Etat implantés localement. Cette collaboration n’est pas facile à organiser même si la plupart des lois de décentralisation, lorsqu’elles existent, déclarent que l’Etat apporte son concours aux collectivités locales, que cette collaboration est une sorte de devoir moral et politique. Si une collectivité locale veut que les fonctionnaires de l’Etat travaillent pour elle, il semble souhaitable :
– premièrement qu’elle obtienne l’autorisation expresse du préfet ou gouverneur ;
– deuxièmement, qu’elle signe une convention de collaboration avec les services d’Etat ;
– troisièmement, qu’elle rémunère sous une forme ou sous une autre le travail fourni.
Ces trois conditions rapprochent les prestations à fournir par l’administration d’Etat du droit commun, ce qui est finalement rassurant car cette administration est trop encline soit à ne rien faire soit à en faire trop. Ne rien faire sous prétexte que le lotissement est une affaire communale qui ne les regarde pas. En faire trop en s’emparant d’un projet que seule une administration d’Etat est, d’après elle, capable de conduire rationnellement et qu’il convient donc de ne pas laisser entre les mains d’élus locaux.
- La question du financement ou du pré-financement de l’opération.
Une autre difficulté (qui invite à prendre d’autres précautions) réside dans le dénuement financier de la plupart des communes africaines. Un lotissement, même modeste comme celui que nous avons évoqué, coûte. Comment faire quand on n’a pas de disponibilités financières et surtout pas de trésorerie. La réponse la plus classique est : faire participer financièrement les futurs bénéficiaires, qui dans notre exemple sont connus. On peut leur demander de déposer dans un compte bancaire spécial une somme correspondant à environ la moitié du prix de cession prévu pour faire les premiers travaux.
Ces pratiques sont fréquentes. Elle n’en sont pas moins juridiquement hasardeuses puisque le compte est un compte bancaire de droit privé alors que les sommes versées sont des deniers publics destinés à payer des travaux communaux. Quant au déposant il agit à ses risques et périls en dehors de tout lien contractuel avec la commune. En réalité le jeu est moins risqué qu’il ne paraît dans la mesure où les plupart du temps les déposants forment un groupement (pas toujours une association de plein exercice, dont les statuts sont publiés au Journal Officiel) et que le représentant du groupement doit co-signer avec le maire tout ordre de paiement de travaux. Et si par malheur on n’arrivait pas à servir tous les déposants (pour des raisons techniques, le nombre des parcelles créées effectivement se révélerait inférieur à celui indiqué dans le dossier technique), les « recalés » sont remboursés ou bénéficient d’autres attributions de terrains ailleurs.
La solution juridiquement optimale consisterait à organiser la participation des futurs bénéficiaires sous la forme d’un achat de terrain en état futur d’aménagement et d’équipement. Le bénéfi-ciaire passe contrat avec la commune qui fait des appels de fonds au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Encore faut-il que ce type de vente immobilière appliqué au sol en cours d’aménagement et d’équipement soit autorisé par la loi ou tout au moins ne soit pas interdit. Dans ce dernier cas, il appartiendrait aux juristes de la place, y compris les notaires, de s’entendre sur un contrat type aussi clair et transparent que possible.
- La connaissance du coût de l’opération.
Evoquons enfin la deuxième difficulté, la question de la connaissance des coûts de l’opération de lotissement. Aucune commune ne saurait dépenser sans compter. Il lui faut disposer non seulement d’une estimation sérieuse du coût futur de l’opération mais aussi d’une système de comptabilisation des dépenses faites.
Une première avancée dans cette direction prend la forme de la création d’un compte spécial ouvert dans les écritures communales. Ce compte, dénommé « Opération de lotissement de... (suit le nom de l’opération ou le lieu-dit dans lequel le lotissement est ouvert) », enregistre toutes les dépenses et toutes les recettes relatifs à son objet. Malheureusement cette procédure s’analyse dans beaucoup de pays comme une entorse aux principe d’unicité du budget et de non-affectation des recettes aux dépenses. Elle est alors considérée comme exceptionnelle et, à ce titre, elle doit être autorisée par le ministère de l’intérieur ou/et par le ministre des finances qui prend un arrêté créant ce compte spécifique. Si tel est le cas, cette procédure est beaucoup trop lourde pour être efficace.
Une autre solution pourrait être de créer un tel compte sur simple délibération décidant que le lotissement en question est un service public à gestion marchande ou industrielle et commerciale et qu’à ce titre il fait l’objet de plano d’un budget et d’un compte annexes dans lesquels les dépenses doivent équilibrer les recettes.
Il n’est pas sûr d’ailleurs que ces procédés soient, en eux-mêmes, totalement satisfaisants, car les dépenses portées à ces comptes restent des dépenses au sens de la comptabilité publique. On risque donc de n’enregistrer que les actes de dépenses expresses (telle avance consentie au service d’Etat pour engager les travaux de viabilisation du lotissement) au détriment des dépenses économiques réelles directes ou indirectes :
– renforcement des équipements du quartier existant devant servir à la desserte du nouveau ;
– coût du travail des agents et des engins municipaux effectivement consacré à l’opération ;
– coût d’équipement en matière informatique du service des domaines nécessité par cette opération mais qui servira évidemment à d’autres tâches ou services.
La question est non seulement celle de l’individualisation des dépenses mais aussi celle de leur réalité économique. La seule réponse est la tenue, en supplément de la comptabilité communale, d’une comptabilité dite analytique cernant la réalité de la dépense en relation avec l’exacte destination de ladite dépense. Cette comptabilité analytique n’a pas de vertus légales (en l’état actuel des règles budgétaires et comptables des collectivités publiques de l’immense majorité des pays du Sud et du Nord). Elle n’a de vertus qu’économiques et politiques. On pourra savoir combien a coûté réellement l’opération, et si, contre toute logique, le prix de cession était inférieur au coût, on serait à même de calculer le montant de la subvention consentie de facto par la collectivité à l’opération et à ceux qui en sont les bénéficiaires.
Cette comptabilité analytique peut être tenue par la commune même si la loi ne l’exige pas, et donc si elle ne peut figurer dans les documents légaux de comptabilité.
3. Mener à bien une opération d’aménagement d’une certaine importance
Dès que projet d’aménagement dépasse une certaine ampleur et une certaine complexité, une municipalité ne peut plus utiliser les mêmes procédés du « faire tout soi-même ».
- L’assistance à maîtrise d’aménagement.
Au stade de la conception comme à celui de la réalisation d’un « grand aménagement », la collectivité locale ordinaire, moyenne, a besoin, d’abord et pour le moins, d’un « assistant ». Un assistant est un professionnel qui aide la collectivité a exercer sa maîtrise d’aménagement tout au long du processus long et souvent plein d’embûches qui va de l’« idée » d’aménagement à l’« inauguration » du nouveau quartier. Cette assistance à maîtrise d’aménagement est désignée par des vocables divers et qui varient d’un pays à l’autre, mais la réalité de la fonction à assurer est identique et évidente : il faut aider la collectivité à exercer sa pleine maîtrise de l’aménagement projeté. On peut parler de « maîtrise d’aménagement » comme on a pu en matière de travaux parler de « maîtrise d’ouvrage ». Même si l’objet est différent (l’ouvrage est un objet et un ensemble de tâches à définir puis à donner à faire selon les procédés classiques du contrat d’entreprise), les talents à développer par le maître sont les mêmes : faire passer à travers l’aménagement une certaine idée de la ville dont on a la responsabilité et du changement que l’on veut promouvoir, même si au fur et à mesure de l’évolution du projet on est amené à faire des compromis économiques (coûts), commerciaux (préférences du marché), socio-politiques, y compris bien entendu électoraux.
L’assistant du maître d’aménagement a pour fonction de prêter main-forte au maître d’aménagement. Il peut avoir deux profils différents :
– ou bien il est une sorte de secrétaire qui conduit la procédure, qui fait les papiers...,
– ou bien il est une sorte de concepteur permanent qui oriente l’évolution du projet, qui participe aux négociations, qui s’efforce de maintenir le cap...
L’assistant-secrétaire comme l’assistant-concepteur ont les mêmes charges et obligations : piloter en second l’opération à côté du pilote en chef qui est la collectivité. L’un est plus procédurier et prétend rester en retrait des discussions et tractations. L’autre se présente plutôt comme le penseur du projet, le gardien d’une certaine qualité et rationalité de l’aménagement ; il a l’avantage en général d’avoir été l’auteur des études préalables : esquisses, études de faisabilité, approches qualitatives. Il a de fortes chances d’être en mesure de surveiller (ou même d’y participer) toutes les études qui vont s’échelonner tout au long du processus de décision et de réalisation.
- L’opérateur professionnel.
Le maître d’aménagement, même assisté de l’assistant qu’il a personnellement choisi, ne saurait assurer lui-même toutes les tâches de conception et de réalisation d’une opération d’une certaine importance. Il lui faut un opérateur professionnel qui puisse prendre en main toutes ces tâches, en rendre compte au maître de l’opération qui n’aura plus qu’à consacrer toute son énergie au pilotage de l’opération, à l’exercice de sa maîtrise.
L’opérateur doit avoir deux qualités essentielles :
– être un professionnel de l’aménagement,
– être un praticien des marchés fonciers et immobiliers.
Professionnel de l’aménagement ? C’est la moindre des choses ! Praticien des marchés fonciers et immobiliers ? Parce que l’opérateur va devoir introduire des terrains à bâtir sur le marché, démarcher des promoteurs-constructeurs immobiliers, convaincre des commerçants et des industriels de venir s’implanter... Il a donc un produit à écouler sur le marché. Pour que ce soit facile ou possible, il est nécessaire que l’opérateur informe le maître de l’opération des tendances de ce marché pour qu’il ne commette pas trop d’erreurs stratégiques commerciales. Il a ici une fonction de « conseiller commercial » (conseiller du maître de l’aménagement dès les premières études de faisabilité).
Tous les opérateurs liés par contrats (on peut parler de contrat, ou de convention d’aménagement à raison d’un contrat ou convention par opération) à des maîtres d’opération ne sont pas tous coulés dans le même moule. On doit distinguer deux grandes catégories d’opérateurs :
– les opérateurs-mandataires qui reçoivent des honoraires pour oeuvrer au lieu et à la place du maître d’opération ;
– les opérateurs-promoteurs qui engagent leurs propres fonds dans les opérations.
- L’opérateur-mandataire.
Il doit être considéré comme le bras armé du maître d’opération. Ce qu’il fait, il le fait au nom du maître d’opération. Le mandat dont il dispose est un mandat professionnel de bonne fin en ce sens qu’il doit utiliser toute sa compétence professionnelle pour mener à bien et à terme l’opération. S’il n’use pas de toute sa diligence-compétence-prudence pour accomplir sa mission, on peut mettre en cause sa responsabilité contractuelle même s’il a à peu près fait ce que le contrat l’obligeait à faire.
S’il n’arrive pas à équilibrer (boucler) l’opération et si donc la collectivité doit consentir une « rallonge » de crédit pour le boucler, ses honoraires peuvent être diminués, selon une formule de participation limitée au déficit de l’opération (quelques pourcentages de ses honoraires peuvent lui être retirés) et à la condition que cette éventualité et cette formule soient expressément inscrites au contrat. A l’inverse, si la bonne gestion de l’opération par l’opérateur a pour résultat une diminution de la participation financière de la collectivité locale, les honoraires de l’opérateur sont majorés en proportion.
Ces intéressements aux résultats ne doivent pas faire oublier le principal : l’opérateur présente des factures d’honoraires pour services rendus au maître d’opération qui les règle après s’être assuré que les services facturés ont bien été rendus en quantité et en qualité, conformément au contrat et aux règles de l’art (autre appellation des règles de diligence-compétence-prudence dont il vient d’être question).
L’immense avantage de la procédure de réalisation de l’opération par opérateur-mandataire est d’autonomiser le budget d’opération et de faire de l’opérateur le gestionnaire de ce budget. Si l’opérateur est soumis aux règles de gestion et de comptabilité de droit privé, il pourra administrer ce projet d’aménagement avec toute la souplesse indispensable (par exemple négocier toutes sortes d’accord avec les occupants coutumiers du sol à aménager, accords que ne pourrait passer une autorité administrative soumise au droit public), tout en restant comptable du moindre franc car il doit présenter à tout moment une comptabilité tout à fait sincère, précise et transparente.
Si l’on fait supporter la totalité des coûts d’acquisition foncière, d’aménagement et d’équipement par l’opérateur, on sait exactement ce que coûte l’opération. Il est facile de déterminer ensuite le prix minimum moyen de cession du mètre carré, seuil en dessous duquel l’opérateur est déficitaire et donc appelle une subvention publique d’équilibre.
- L’opérateur-promoteur.
Les opérations qui sont susceptibles d’être prises en main par des opérateurs-promoteurs obéissent à une autre logique. Ces opérations sont généralement rentables car elles s’adressent à une clientèle tout à fait solvable et toute prête à se porter acquéreur du type de produit foncier que l’on s’apprête à produire. La charge d’acquisition foncière, d’aménagement et d’équipement peut être facilement incorporée au prix de cession et prise en charge par l‘opérateur-promoteur.
La collectivité publique ici peut fort bien se contenter d’imposer quelques charges supplémentaires aux promoteurs : assurer le branchement de la voirie de l’opération sur la voie principale qui passe à quelques distances du lieu d’opération, construire en périphérie de la zone à aménager une école primaire qui servira aussi sinon d’abord au quartier voisin, rétrocéder à la commune un petit terrain pour y loger ses techniciens...
Dans ces conditions le contrat d’aménagement passé entre la commune et le promoteur est une simple convention scellant une « entente cordiale » entre un promoteur qui fait son affaire de l’opération qu’il prend en charge de A à Z et une collectivité locale qui en quelque sorte agrée l’opération en question aux conditions qu’il impose. Les seuls engagements de la collectivité portent sur l’officialisation du projet d’aménagement qui devient par ce fait un document d’urbanisme opposable à tous et aussi sur l’expropriation et le déguerpissement des occupants fonciers qui, par leur surenchère, pourraient bloquer totalement le projet (ce ne sont pas là évidemment les formules qui sont portées dans le contrat d’aménagement mais c’est à peu près le sens qu’elles ont).
4. L’amélioration des quartiers populaires
Il suffit que le taux d’accroissement démo-graphique d’une agglomération soit forte et que les moyens - ressources financières, compétences techniques - de la collectivité soient faibles pour que, tendanciellement, les quartiers se créent plus ou moins spontanément ou tout au moins sans bénéficier de véritables structures d’accueil (aménagement foncier sous forme de parcelles à construire par les habitants ; équipement de proximité au service des nouveaux habitants). Il se peut fort bien que l’on ne puisse pas, dans les villes africaines et dans les vingt prochaines années, pratiquer un urbanisme d’accueil de l’urbanisation. On doit sans doute se contenter d’accompagner cette urbanisation et d’améliorer les conditions de vie des populations qui ont dû s’installer tant bien que mal là où elles ont pu.
Cette politique d’amélioration conduit à mener des opérations spécifiques. Elles laissent une place très importantes à l’initiative des habitants. Ce sont souvent leurs associations qui ont demandé que l’opération soit lancée. Ce sont elles qui négocient avec l’autorité communale le programme à appliquer à leur quartier. De plus, dans presque tous les cas l’autorité communale trouve commode de s’appuyer sur les organisations de quartier pour faciliter l’application du programme d’opération.
Qu’ils soient initiateur-revendiquant, négocia-teur-revendiquant ou partenaire-coopérant, les groupements des habitants des quartiers ont leur(s) mot(s) à dire.
L’expérience montre que les qualités que l’on peut exiger d’un opérateur classique, habile à travailler vite et bien, sont parfois des défauts lorsqu’il s’agit d’intervenir dans un quartier populaire existant. Il faut savoir ici adapter un tracé de voie à l’occupation du sol, accepter que le parcellaire soit de forme quelque peu irrégulière...
On est conduit en fait à distinguer deux fonctions opératoires, l’une qui traite l’opération dans sa dimension socio-politique (l’amélioration d’un quartier populaire est une opération « pour le peuple et par le peuple », l’autre qui s’attache à résoudre les problèmes techniques. Et l’une et l’autre s’entendant pour tenir compte mutuellement des contraintes et difficultés qu’elles rencontrent dans leurs domaines propres.
Si l’on n’y prend garde on peut être conduit à organiser une opération d’amélioration de quartier populaire autour de quatre acteurs qui passeront plus de temps à se faire la guerre qu’à faire avancer l’opération :
– la commune, disputant son pouvoir au groupement des habitants du quartier en question sur la maîtrise effective de l’opération ;
– l’opérateur social, disputant à l’opérateur technique la direction effective des travaux (au sens large).
Pour qu’une opération fonctionne normalement, il convient que les acteurs en présence s’entendent politiquement avant de rédiger quoique ce soit. La commune ne saurait abandonner sa fonction de maître de l’opération. C’est elle qui arrête le projet et son budget. Ceci ne signifie pas qu’elle décide de tout. Elle peut accepter que l’association des habitants prenne certaines décisions. Le conseil municipal peut dire, par exemple, que le plan parcellaire résultant du plan d’aménagement sera arrêté par l’association après règlement avec les habitants des conflits et oppositions qu’il pourrait engendrer.
Il faut ici être très précis :
– ou bien le conseil municipal donne pouvoir à l’association d’adopter définitivement le nouveau plan parcellaire consacrant formellement les droits fonciers des occupants qui jusqu’ici n’étaient que des occupants de fait ;
– ou bien le conseil municipal donne pouvoir à l’association d’arrêter le projet du plan parcellaire qui ensuite sera soumis à l’approbation du conseil municipal.
Dans le premier cas, l’association reçoit du conseil le pouvoir de décider en son nom et à sa place. Dans le deuxième cas, l’association se voit confier une tâche de préparation d’une délibération du conseil, celui-ci se réservant le droit de refuser le projet et donc de le renvoyer à l’association pour réexamen. Dans le premier cas, la délégation est une délégation de pouvoir de décider, que l’on peut juger excessive car portant atteinte aux prérogatives essentielles de la maîtrise d’opération dont le maître d’opération ne saurait se démettre sans déchoir. Dans le deuxième cas, la délégation porte sur le pouvoir d’instruire et de présenter une proposition de délibération, le conseil auto-limitant son pouvoir puisqu’il peut dire oui ou non mais s’interdit lui-même de modifier le projet, lequel (c’est bien le sens politique de tout ceci) doit émaner des habitants pour être ensuite accepté par l’institution communale.
Cette collaboration politique entre l’organisation associative censée représenter les habitants du quartier et la collectivité publique censée représenter les habitants de la ville toute entière en même temps que censée incarner l’institution chargée de la gestion urbaine est essentielle. Elle retentit sur les conditions d’exercice par la commune de ses pouvoirs de maître de l’opération en question. On peut aller jusqu’à un partage de certaines responsabilités. On ne saurait aller trop loin jusqu’à la reconnaissance de deux maîtres d’opération. Il faut que dans tous les cas, quelqu’un puisse dire : nous avons assez disserter, maintenant il faut décider et c’est moi qui décide. Ce quelqu’un, à notre avis, ne peut être logiquement que la commune.
Le même raisonnement s’applique aux responsabilités d’opérateur. Il ne peut y avoir deux opérateurs ou tout au moins deux « opérateurs en chef ». L’un doit être subordonné à l’autre. Subordonné ne veut pas dire asservi. Il faut tout simplement que l’opérateur en chef soit, à l’issue d’une concertation mutuelle entre le porteur du projet social et le porteur du projet technique, habilité à dire : je décide de faire comme ceci et non comme cela sous réserve de l’approbation du maître d’opération. L’opérateur en chef est soit l’opérateur social soit l’opérateur technique. Tout dépend de la nature même du projet d’amélioration.
On aura tendance à ranger dans le « social » la restructuration-légalisation foncière.