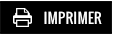Offrir des services urbains
Publié par , le 6 mars 2007.
1. Réglementer et soutenir les prestateurs de services privés.
Les services urbains sont des services rendus aux ménages et aux entreprises installés en ville. L’immense majorité de ces services est le fait de prestateurs privés. La collectivité publique n’a souvent pas à intervenir. Il ne faudrait pas en conclure que tout service privé échappe par nature à l’intervention publique, laquelle doit se cantonner aux seuls services publics.
La pratique est toute différente. Un service purement privé comme la garde d’enfants en bas âge par une voisine complaisante peut devenir un service d’intérêt collectif lorsque la demande est formulée par un quartier habité par des mères de famille, vivant seules ou en famille, employées à des travaux à l’extérieur de leur quartier, et qu’il est répondu à cette demande par la création de véritables « jardins d’enfants » gérés par des associations ou même des professionnels.
Si les usagers ou l’opinion publique disent que le service n’est pas rendu comme il le devrait (exiguïté des locaux, alimentation inadaptée, prix trop élevés...), on peut souhaiter que la municipalité décide d’intervenir en réglementant ces activités, en aidant certaines associations à fournir un meilleur service à un moindre coût... L’aide peut consister en quelques subventions, en avantages en nature comme par exemple l’occupation gratuite de telle partie du domaine public (une municipalité peut accepter de construire une petite aire de jeux et la réserver à
l’unique usage des enfants de tel ou tel jardin d’enfants...).
Nous sommes ici en présence d’un mode d’intervention classique du gestionnaire municipal :
– il réglemente l’activité pour des raisons de santé, de sécurité, de tranquillité publiques, à la condition de ne pas empiéter sur les pouvoirs exercés par l’État et le législateur ;
– il aide et soutient certains prestateurs de services privés puisque comme gestionnaire local il a en charge la « gestion des affaires locales », selon l’expression souvent utilisée par les lois de décentralisation.
Réglementer et soutenir signifient explicitement que l’activité de prestation de service reste en dehors de la municipalité, que les prestataires ne sont pas des agents municipaux...
Il en est différemment lorsque la collectivité constatant l’échec de son intervention par réglementation et soutien décide de créer de véritables services publics municipaux. La municipalité devient le « patron » des services qu’elle organise même si pour plus de souplesse elle demande à des associations de prendre en charge l’exécution de certaines activités ou tâches. En ce cas, ces associations sont des « opérateurs » habilités par la collectivité publique qui reste « maître » du service, selon l’expression tout à fait judicieuse utilisée par les juristes.
Tant que le service n’accède pas à la qualité de « service public » placé sous la maîtrise de la collectivité locale, il reste une activité privée même si cette activité est réglementée et subventionnée ou aidée. Il est normal que cette aide aille aux organisations qui ont la préférence de la municipalité. Il est tout à fait acceptable qu’elle marque sa préférence, par exemple pour certaines associations, pour celles qui sont reconnues au niveau national tout en étant fortement implantées localement, pour celles qui emploient beaucoup de femmes du quartier, pour celles qui pratiquent la plus forte péréquation de leur prix au bénéfice des moins nantis, pour celles qui travaillent dans les quartiers les plus démunis...
Cette politique municipale se traduit par des critères d’éligibilité à cette aide. Mais on ne peut de cette façon condamner d’autres jardins d’enfants à la faillite ou à la fermeture. Une certaine égalité de traitement est à respecter : l’aide doit apparaître au contraire comme le moyen de rétablir un équilibre (tel jardin d’enfants situé dans un quartier démuni aurait les plus grandes difficultés à équilibrer sa gestion) ; il faut aussi que chacun puisse solliciter une telle aide, que les critères prohibés par la loi ne soient utilisés (critères ethniques, régionaux, religieux...).
Autrement dit, les critères municipaux s’ajoutent aux critères légaux mais ne s’y substituent pas, ne les effacent pas.
Autre condition d’importance. Les subventions ou aides sont des deniers ou des ressources publics dont l’emploi doit être contrôlé par le conseil municipal et les citoyens. Il importe donc que les choses soient claires et transparentes. Chaque aide est à individualiser. Elle doit énumérer les conditions de son allocation : qu’est-ce qui est demandé en échange au bénéficiaire ? Il est admis que la délibération d’allocation soit assortie de conditions exprimées unilatéralement par ladite délibération de telle sorte que si le bénéficiaire accepte l’allocation, il accepte aussi, en même temps, les conditions.
On peut aller plus loin en demandant à chaque bénéficiaire de signer un contrat avec la collectivité. La collectivité et le bénéficiaire déterminent exactement leurs engagements réciproques qui sont pourvus de signatures en bonne et due forme. La collectivité peut exiger du bénéficiaire qu’il rende compte de l’utilisation des subventions et autres avantages que lui a versés ou consentis la collectivité. Le contrat peut rappeler en même temps ce que prescrit la plupart des lois de la plupart des Etats (si la loi ne le prescrit pas, la commune volonté des parties exprimée dans le contrat tient lieu de loi) que les livres de compte du bénéficiaire doivent s’ouvrir pour contrôle à la réquisition de la collectivité.
Il faut bien reconnaître que la technique du contrat est beaucoup plus pertinente que la délibération unilatérale assortie de conditions mais qu’elle est aussi plus complexe et coûteuse. Dans tous les cas, il apparaît nécessaire :
– premièrement que la décision d’allocation soit le fait du conseil délibérant de la commune ;
– deuxièmement, que la même délibération (c’est préférable) ou une autre habilite le maire à mettre en œuvre la décision d’allocation et que par exemple à ce titre il se voit contraint par le conseil à passer contrat avec le bénéficiaire.
2. Demander à une entreprise d’assurer la totalité du cycle de production d’un service déclaré service public.
Prenons un exemple. Un nouveau maire vient d’être élu dans une ville satellite de la capitale. Cette ville a poussé comme un champignon. Elle compte aujourd’hui près de cent mille habitants et est distante de la capitale, de la ville-mère, d’une quinzaine de kilomètres. Le maire a été élu sur un programme électoral très simple : il faut combler le déficit d’équipement de cette ville champignon, et en particulier et en priorité l’alimenter en eau.
Le premier réflexe consiste à dire que l’alimentation en eau de la ville est un service public municipal mais que le plus simple est de demander à une entreprise spécialisée - par exemple, celle qui gère le réseau d’eau de la capitale - de « faire le nécessaire » étant entendu que la commune est pauvre.
Qu’est-ce que veut dire « faire le nécessaire » ? Comment installer l’entreprise dans sa fonction de producteur - transporteur - distributeur d’eau potable ? Comment organiser les rapports de la commune réputée maître du service public de l’eau et l’entreprise chargée de l’exécution du service ? Comment situer les usagers consommateurs d’eau par rapport, d’une part, à l’entreprise, d’autre part, à la commune ?
La contractualisation d’une entreprise comme opérateur du service public n’est pas une mince affaire. La municipalité peut s’attendre à devoir mener une négociation longue, difficile et technique. Si elle veut faire valoir son point de vue, elle ne peut arriver à la table de négociation les mains dans les poches. Il lui faut aiguiser son esprit critique et se pourvoir de solides arguments. La mise au point du contrat de concession et de ses pièces annexes exige un travail de préparation très important.
Confier le service de l’eau à une entreprise, ce n’est pas se débarrasser du service. La collectivité reste maître du service. Même si elle n’assure pas la responsabilité de la gestion directe du service, elle en assume la responsabilité juridique, sociale, politique... Si le service n’est pas correctement exécuté, les usagers mettront en cause non seulement l’entreprise concessionnaire mais aussi l’autorité concédante. D’où l’extrême importance de la négociation qui porte à la fois sur l’équilibre des relations concédant-concessionnaire mais aussi sur l’équilibre des relations concessionnaire-usagers ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du service.
- L’équilibre concédant-concessionnaire
La principale difficulté réside dans la sur-expérience des entreprises spécialisées dans ce type d’activité et dans l’inexpérience de la quasi totalité des collectivités locales. Ce déséquilibre est patent dès la négociation du contrat de concession et malheureusement plus tard encore pour toutes les tâches de contrôle. Pour être un négociateur et un contrôleur sérieux, il faut disposer de sa propre équipe d’experts ou d’assistants techniques disposant de solides connaissances en matière d’ingénierie, d’économie (fiscalité, financement, économie d’entreprise...) et de droit (les compétences plus spécifiques en matière d’analyse de la qualité de l’eau et de l’expertise comptable sont à mobiliser au fur et à mesure et en fonction des besoins). Cette équipe doit surtout être rémunérée par le maître public du service et ne pas avoir partie liée avec l’entreprise candidate à la concession puis concessionnaire soumise à contrôle. C’est là sans doute la condition la plus déterminante et la plus difficile à instaurer car ces entreprises sont très puissantes et influentes.
La rémunération de l’équipe de contrôle par le maître du service est assez facile à organiser. Il suffit de le prévoir dans le contrat de concession et prescrire qu’une certaine partie du prix payé par l’usager à l’entreprise concessionnaire est affectée directement et automatiquement à la couverture des frais de maîtrise publique du service dont les frais d’expertise et de contrôle. Ces derniers frais sont ceux que facturent les experts et assistants techniques engagés par le maître. Ces sommes peuvent aussi alimenter une autorité nationale de contrôle des services publics, autorité autonome créée par la loi et qui a vocation à assister les collectivités.
En revanche, la rémunération de l’équipe chargée de participer à la négociation du contrat de concession fait problème. Elle ne peut résulter d’un mécanisme inscrit dans le contrat puisqu’il n’est pas encore signé. Il y a là une difficulté majeure. Le maire aura peut-être intérêt à faire appel à la collaboration de jeunes techniciens des services centraux de l’Etat, à condition qu’il puisse les choisir lui-même. La dynamique - escomptée - de ces jeunes techniciens compensera leur inexpérience.
Là encore la clé réside dans la vigilance du maître public du service et son refus d’être « capturé » (ce sont les sociologues qui ont inventé cette formule) par son concessionnaire. La confiance personnelle du concédant en son concessionnaire (les juristes parlent de l’intuitus personnae) qui est une condition déterminante du choix du concessionnaire et de la bonne marche du service concédé n’exclut en aucune façon la rigueur de la négociation et du contrôle. La confiance n’exclut pas le contrôle.
La logique de la concession « parfaite » (voir plus loin) implique une large autonomie du concessionnaire, qui fait son affaire de l’investissement à réaliser et qui assume le risque commercial de l’exploitation. Le concédant ne peut donc pas, par des contrôles incessants, s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et par là entraver son autonomie de gestion. Le concédant doit afficher ses exigences avec le plus grand soin et contrôler a posteriori que ces exigences sont bien atteintes.
Dans la pratique, toutefois, il arrive de plus en plus souvent qu’une bonne partie du montant de l’investissement soit apporté par le concédant lorsqu’il a accès à des sources de financement international de moindre coût. Il arrive aussi que le concessionnaire demande au concédant une subvention d’équilibre pour atteindre le bas prix du mètre cube d’eau que le concédant lui impose. Dans ces conditions, la concession peut être qualifiée de concession « imparfaite ».
Sans entrer dans le détail de la rédaction d’un contrat de concession, nous indiquerons ici les points sur lesquels l’autorité concédante doit exercer tout particulièrement sa vigilance.
- Durée
Une des options essentielles à prendre relativement au contrat à passer entre le concessionnaire et la municipalité est sa durée : pendant combien de temps l’entreprise sera-t-elle en charge du service ? Autrement dit, quelle sera la durée de la concession ? Dans tous les cas elle ne peut pas être inférieure à la durée d’amortissement des investissements que le concessionnaire doit réaliser pour assurer le service convenu.
L’application de ce principe peut toutefois poser problème. Il est bien connu que toutes les entreprises concessionnaires ne gagnent de l’argent qu’à partir de la fin de ce premier cycle de production, dès que le gros des dépenses d’équipement est récupéré. On comprend qu’elles sont enclines à dire que ce premier cycle de production est beaucoup plus long qu’il ne paraît et à surestimer le coût réel des investissements.
Il appartient au maître du service concédé d’aborder la négociation sur ce point après avoir fait lui-même ses propres estimations des coûts et durée du programme d’investissement.
Par ailleurs, plus la durée de la concession est courte plus le concessionnaire est attentif et attentionné afin de mériter le renouvellement éventuel de son contrat sous la forme d’une concession ou plus probablement sous la forme d’un contrat de gestion, les installations ayant été réalisées, puis transférées à la commune au terme du contrat de concession. La détermination de sa durée est, on le voit, d’une grande importance.
- Travaux et maîtrise d’ouvrage
Toutes les concessions ne comportent pas la réalisation par le concessionnaire d’installations importantes. Si quelques travaux assez simples et techniquement évidents sont à faire par l’entreprise, il suffit que le contrat le rappelle en quelques mots. A l’inverse, si les travaux et les installations à réaliser par le concessionnaire sont importants, ce type de mention contractuelle est insuffisant. Par ailleurs, dans la plupart des cas, les études techniques qui sont à la charge du concessionnaire ne peuvent être menées à bien avant la signature du contrat de concession. Ce qui implique que, dans la pratique, le programme des travaux ne pourra être arrêté d’un commun accord entre le concédant et le concessionnaire que plusieurs mois après la signature du contrat. A défaut de programme préalable à la signature, il faudra que les parties s’entendent avant de signer sur une sorte d’esquisse et une enveloppe grossière de coût.
Faut-il, en outre, considérer que les travaux entrepris par l’entreprise concessionnaire sont des travaux publics donnant lieu à des marchés publics ? Faut-il aussi déclarer que la collectivité publique doit être réputée maître de l’ouvrage sous prétexte que l’ouvrage ainsi construit est un ouvrage public et qu’il est construit « pour le compte » (comme on dit habituellement) de la commune ? Dans ce cas, il est important de le stipuler dans la convention et d’en tirer toutes les conséquences sur le rôle de la collectivité dans ce processus.
Dans le cas contraire, il convient de déclarer explicitement que le concessionnaire travaillant avec ses propres deniers est un entrepreneur « privé » et que les ouvrages qu’il réalise ne sont incorporés au patrimoine de la collectivité qu’en fin de concession. Il va de soi alors que la collectivité n’apporte au concessionnaire aucune aide financière substantielle. La collectivité concédante joue alors un rôle de « superviseur » se contentant de :
– viser techniquement les projets d’ouvrages pour s’assurer de leurs qualités d’un double point de vue, d’une part comme concédant, et, d’autre part comme futur propriétaire et utilisateur des ouvrages qui lui reviendront en fin de concession ;
– participer aux côtés du concessionnaire avec droit de veto à la réception des ouvrages que les installateurs et autres entrepreneurs viennent de créer et qu’ils remettent au concessionnaire.
- Prix
Le prix de vente de l’eau, ou du service en général, est à fixer par le contrat de concession. Cette fixation est une opération complexe. On doit trouver un équilibre entre ce que les habitants peuvent payer et ce que l’entreprise doit gagner pour investir et fonctionner. Là encore, les études sur les coûts et les prix (ou tarifs) ne doivent pas émaner des seules entreprises candidates à la concession. Il importe ici de rappeler que le prix initial fixé par le contrat est actualisable chaque année pour tenir compte de la hausse ou de la baisse des prix et coûts des facteurs. Tous les trois ou cinq ans, ces prix ou tarifs sont généralement déclarés révisables ou renégociables. Le contrat doit le spécifier.
- Périmètre
La question du périmètre de concession est capitale en entendant par périmètre de concession la zone dans laquelle le branchement au réseau est dû au fur et à mesure de l’urbanisation et du développement du programme d’investissement. Il est risqué de se contenter de vagues promesses proférées par le futur concessionnaire, du genre : on desservira l’ensemble du territoire communal ! Le « quand » (quel temps de réponse du concessionnaire à l’urbanisation de tel ou tel site pour lui assurer une desserte convenable ?) et le « comment » (quel niveau de qualité de desserte : branchement immédiatement assuré sur conduite longeant tous les fronts de parcelle ?) sont des questions aussi importantes que celle relative à l’étendue du périmètre. Il peut être plus prudent de limiter ce périmètre mais d’exiger que le concessionnaire y intervienne vite et bien, même si l’on doit gérer autrement le service de l’eau en dehors du périmètre de concession (voir plus loin).
3. La troisième voie : le service public assuré par la collectivité locale elle-même.
La gestion du service public par la collectivité publique semble être une sorte d’évidence, procéder d’une sorte de logique simple : puisque la collectivité publique est maître du service public, qu’elle en assure au moins l’organisation, pourquoi ne prendrait-elle pas en charge la gestion de ce service ?
La gestion du service par la collectivité ne s’impose pas d’elle-même. Elle relève d’un choix politique de l’autorité locale qui aurait décidé de :
– utiliser ses propres moyens ;
– employer son propre personnel ;
– contrôler de l’intérieur et en détail la bonne marche du service.
La gestion du service par la collectivité est sans conteste la marque d’une avancée d’une logique politique, aux sens les plus négatifs (bureaucratie, népotisme, clientélisme...) mais aussi les plus positifs (recherche d’adéquation entre la façon de gérer le service et le projet politique ou le projet de cité affiché par la municipalité) de l’expression de « logique politique ».
Il nous semble qu’une telle gestion n’est praticable que si elle ne présente pas trop de difficultés techniques, encore que, comme nous allons le voir, rien n’interdit au gestionnaire public de recourir à des prestateurs, fournisseurs et professionnels extérieurs.
Examinons d’un peu plus près ce que gérer soi-même veut dire pour une collectivité, à quelle difficulté ce choix peut l’exposer.
La première difficulté est celle de la confusion : le service se confond avec l’administration au point que :
– on ne sait plus qui est concrètement et personnellement responsable des prestations, même si le maire a pris soin de désigner le directeur des services techniques en raison d’une certaine technicité de la prestation ;
– on ne sait plus combien coûte cette prestation.
La question du coût est la plus inquiétante. Elle se pose dans tous les cas, même lorsque le service fonctionne à perte ou gratuitement, selon la décision prise par la collectivité publique. La connaissance de la « dépense » est indépendante de la question de la « recette ». Il est indispensable de savoir combien coûte le service afin d’être en mesure d’en évaluer le rendement, la productivité et de calculer la subvention indirecte qui va aux bénéficiaires du service mais qui ne paient pas ou qui le paient partiellement.
Si par exemple, pour reprendre l’exemple de l’adduction d’eau concédée, la collectivité décide de desservir elle-même par camion-citerne la population installée en dehors du périmètre de concession, il lui faudra calculer avec précision le coût de ces livraisons pour savoir comment elle doit ou elle peut répartir le montant de la dépense entre, par exemple :
– le consommateur en le faisant payer un certain prix par seau ou bidon ;
– le concessionnaire à titre de contribution au service de l’eau gérée par la municipalité qui ainsi le dispense d’avoir en charge la desserte du péri-urbain ;
– le budget de la collectivité au titre d’une subvention à l’alimentation en eau de certains quartiers populaires de la périphérie.
Ces critiques militent en faveur d’une « autonomisation » de l’appareil de gestion publique. Il paraît indispensable que la gestion du service soit isolée de l’administration ordinaire. Cet isolement est d’abord budgétaire. Il faut que le service dispose de son propre budget annexé au budget général de la collectivité et de son propre compte récapitulant en fin d’exercice les dépenses et recettes effectives.
Il n’est pas sûr qu’il faille formaliser outre mesure ce dispositif au point de créer un établissement public communal par service, dont le formalisme est décourageant, souvent disproportionné aux enjeux réels. Pour concevoir ce dispositif, il importe avant tout de négocier avec les services des Finances et du Trésor pour qu’ils acceptent l’idée de cet ensemble « budget-compte » annexe. Dès que les personnes chargées d’engager les dépenses, de les régler et de percevoir les recettes sont désignées, il suffit de leur adjoindre un comité de gestion du service présidé par le maire ou son représentant pour qu’une sorte d’autonomie minimale soit assurée.
Dans tous les cas, la décision de gérer elle-même le service ne peut être prise par la collectivité avant d’avoir fait l’inventaire de ses moyens, tracé les limites extérieures de ses pouvoirs, savoir-faire et moyens. Au-delà de ces limites, la collectivité ne peut que collaborer avec des entreprises, des associations, des usagers capables de se comporter en :
– fournisseurs du gestionnaire de service ;
– sous-gestionnaires du service, de certaines parties du service ;
– partenaires.
4. Autres voies, autres difficultés.
Le procédé de l’entreprise assurant la totalité du cycle de production, de l’investissement initial jusqu’à la prestation de service, n’est pas le seul possible. Les tâches imparties à l’entreprise peuvent être plus réduites : exploiter le service et entretenir les installations. Le droit d’inspiration française ne parle plus ici de concession mais de location ou d’affermage. Le fermier exploite le service, entretien les installations et verse parfois à la collectivité une redevance pour l’utilisation des installations.
Il arrive que l’entreprise n’assure qu’une partie des fonctions de production, par exemple : le traitement de l’eau et sa distribution. Les autres fonctions (investissement, organisation du service) peuvent être confiées à une autre entreprise, éventuellement nationale. Toutefois, la division société maîtresse/producteur d’eau n’est pas toujours d’une parfaite clarté. Il arrive souvent que le producteur soit une société étrangères tout à fait rentable et que la société maîtresse ait à supporter quantités de lourdes charges au nom de l’intérêt général et national.
On voit qu’ici les possibilités offertes aux communes sont impressionnantes. Il leur appartient de se méfier des solutions toutes faites que leur proposent les entreprises. Elles doivent opérer leur choix en reprenant à la base un raisonnement en forme de questions :
– qui fait (doit et peut faire) quoi pour assurer le service ?
– quels sont les avantages et inconvénients techniques, économiques et socio-politiques de telle ou telle formule ?
– quels risques la commune court-elle si elle opte pour telle ou telle solution ?
La question des rapports entre les sociétés nationales de services et les communes.
Il nous semble qu’une difficulté particulière doit être signalée. C’est une situation très habituelle en Afrique : la concession de la production et de la distribution (de l’eau, de l’électricité,...) est confiée par l’Etat lui-même à un concessionnaire disposant d’un monopole national et qui donc, en quelque sorte, s’impose à toutes les communes. Les instances communales sont alors privées de tout pouvoir de décision en cette matière. Il ne leur reste qu’à subir le concessionnaire que l’Etat a choisi sans eux et pour eux.
L’autorité communale ne peut nier l’intérêt technologique et économique d’une concentration de la production et de la distribution, en particulier de l’électricité, en quelques mains. Mais ce qui paraît inacceptable c’est de ne pas associer la commune à l’élaboration des programmes d’investissement qui concernent sa propre ville, de ne pas l’interroger sur les conditions d’occupation par la compagnie d’électricité du domaine public ou sur l’organisation des chantiers de travaux, de la considérer, pour ses installations d’éclairage public, comme un simple particulier... Même en dehors de toute disposition juridique, il convient sans doute d’inviter au contraire la compagnie concessionnaire à venir discuter avec la commune d’accueil.
La meilleure solution semble être de reconnaître aux grandes communes urbaines la qualité d’organisateur de la distribution, même si pour ce faire elles sont obligées de confier la distribution à la compagnie nationale. L’avantage d’une telle formule est de contraindre la commune et la compagnie à discuter d’un programme commun et à signer une sorte de sous-concession de distribution. Cette formule pourrait être inscrite dans la convention passée entre l’Etat et la compagnie concessionnaire.
Il paraît en revanche dangereux en l’état de développement de la plupart des réseaux électriques des pays africains, de limiter l’intervention de la compagnie nationale à la production et au transport de l’électricité en laissant à chaque commune, quelque soit sa taille, toute liberté pour organiser le service de la distribution.
Services publics « allégés »
Le gestionnaire public du service peut avoir besoin :
– de travaux, d’études, de conseils ;
– de services informatiques pour les besoins de sa gestion ;
– des services d’un comptable expert pour la tenue de sa comptabilité ;
– de petites entreprises de collecte et de transport pour l’enlèvement des ordures ;
– d’associations de citoyens pour organiser la garde et la surveillance d’installations...
Ces services, travaux... peuvent faire l’objet de marchés publics tout à fait classiques : le fournisseur passe avec le gestionnaire public du service un marché - soumis ou non à appel d’offres selon les cas et selon les pays - qui donne lieu à paiement du service rendu. Le fournisseur ne prend pas part directement à la gestion du service public. Il n’est chargé que de faire des apports au gestionnaire du service qui reste seul responsable de la bonne utilisation de ses apports extérieurs et de la bonne gestion du service.
Il se peut que le gestionnaire du service puisse devoir recourir à des fournisseurs publics : utilisation de l’informatique de la direction locale du Trésor pour tenir la comptabilité du service et émettre les factures ; utilisation des capacités topographiques de la direction locale du Cadastre pour dresser une carte du réseau des canalisations d’eau... Une collectivité publique locale ne peut en général passer un marché avec un service déconcentré de l’État. Un simple arrangement oral et interpersonnel ne suffit pas car il est trop fragile. Il est difficile alors de faire l’économie d’un accord formel passé entre le maire et le préfet. La réglementation peut prévoir le paiement par la collectivité locale d’honoraires pour services rendus par l’Etat aux collectivités locales (c’est assez habituel pour le Trésor et les Ponts-et-Chaussées).
A la limite, on peut imaginer qu’un gestionnaire municipal ne dispose en propre que de très peu de moyens et de personnel, qu’il ait recours systématiquement à des apports extérieurs... Il n’en resterait pas moins le gestionnaire du service. On ne peut dire de manière absolue ou sentencieuse que la doctrine du service « allégé » ou « maigre » (peu de moyens et de personnels propres) est préférable ou non à celle du service « gras ». Tout dépend des options politiques et sociales de la municipalité qui peut préférer une distribution systématique du travail aux acteurs de la société civile à une concentration d’employés et de moyens sous les toits de l’hôtel de ville.
Services à plusieurs étages
Rien n’interdit, bien au contraire, à la municipalité qui gère elle-même un service public de limiter ses ambitions à une partie du service et de confier l’autre partie (ou les autres parties) à d’autres gestionnaires. Evoquons quelques cas assez classiques.
Le service des ordures ménagères est géré par la municipalité qui confie le ramassage des ordures et leur concentration dans des lieux de dépôt dit de quartier à des entreprises ou des associations qui se font directement payer par les habitants. Le service géré directement par la municipalité consiste alors à transporter les ordures à partir des dépôts des quartiers jusqu’au lieu de traitement et évidemment à traiter lesdites ordures.
Le service de l’eau dessert certains quartiers à la fois excentrés et populaires par des bornes-fontaines qui sont données à gérer à des fontainiers ou des associations qui ont à les entretenir, à aménager leurs abords et à faire payer les consommateurs. Les fontainiers peuvent être de simples personnes physiques. Le service de la fontaine est régi par un petit contrat passé entre la municipalité et le fontainier et par un règlement d’utilisation opposable aux usagers. Le tarif est fixé chaque année par le conseil municipal. Une partie du prix est conservé par le fontainier pour son travail et ses dépenses d’entretien et d’aménagement.
Le service des ordures ménagères et de l’eau est souvent un service à deux étages : à l’étage du haut, le service est géré directement par la collectivité, à l’étage du bas, le service est confié à des petites entreprises, des individus ou des associations.
Partenariat
Un service géré directement par une municipalité est assez habituellement enclin à travailler en partenariat avec des associations chargées d’expliquer aux gens comment se servir de telle installation publique ou de tel service public, d’organiser des groupements d’usagers autour de points d’eau, de les faire payer, de représenter les usagers au sein des instances directrices ou consultatives du service municipal, d’aider à la constitution et à la consolidation de petites entreprises, fournis-seurs ou concessionnaires de certaines parties des services...
Ces associations ne sont elles-mêmes ni fournisseur ni concessionnaire des services municipaux mais leurs partenaires et interlocuteurs.
Cette souplesse n’est pas toujours aisée à obtenir dans le cas d’un service concédé à une entreprise qui peut avoir tendance à s’emparer de l’ensemble du processus et à obéir à sa logique d’entreprise. Néanmoins l’expérience montre que, dans le cas d’un service concédé, une répartition des tâches entre le concessionnaire et des associations, des individus et des petites entreprises est possible et avantageuse. L’autorité municipale aura alors intérêt à faire pression, si cela est nécessaire, sur le concessionnaire pour qu’il accepte de développer des partenariats.