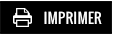Réaliser des ouvrages publics
Publié par , le 6 mars 2007.
Introduction
C’est un des gestes les plus ordinaires d’une municipalité. Il s’agit en effet soit de construire soit d’entretenir soit de réparer (réhabiliter) une voie, un marché, une école, une maison de quartier... Dans l’hypothèse où ces travaux sont relatifs à un ouvrage public communal, ils sont des travaux publics dont la municipalité est le maître de l’ouvrage.
La question qui nous intéresse ici est celle du choix du mode opératoire par le maître d’ouvrage communal. Le processus de production de l’ouvrage public résulte, dans tous les cas, des interventions conjuguées :
– du « maître » : le maître de l’ouvrage décide, commande, paie et met en service l’ouvrage ;
– du « concepteur » : il conçoit l’ouvrage commandé et (le même ou un autre) en surveille la réalisation ;
– du « réalisateur » : il construit l’ouvrage commandé tel que conçu par le concepteur.
Ces dénominations désignent des fonctions à assurer par des individus, des associations, des professionnels, des entreprises, des institutions publiques ou privées... qui s’engagent à accomplir des tâches ; qui disposent de savoir et de savoir-faire techniques, sociaux, économiques, financiers ; qui sont capables de mobiliser les moyens nécessaires pour l’exécution des tâches qu’ils ont à accomplir ; qui répondent de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de la commande, telle que constatée à la livraison de l’ouvrage et, éventuellement, après la livraison de l’ouvrage pendant la période de garantie légale qui suit la livraison.
Notre propos ici n’est ni technique ni juridique. Nous n’avons pas à préconiser l’utilisation de tel professionnel plutôt que tel autre ni de telle clause contractuelle plutôt que de telle autre. Notre propos est d’esquisser les diverses possibilités de montage de l’opération entre lesquelles la commune choisit en fonction :
– de sa propre capacité à exercer son « métier » de maître d’ouvrage ;
– des exigences des bailleurs de fonds et autres financeurs ;
– de la technicité de l’ouvrage ;
– du développement économique et entrepreneurial qu’elle veut promouvoir ;
– des alliances politiques et sociales qu’elle souhaite nouer pour affermir sa base électorale et construire son projet de cité ;
– du rôle qu’elle veut faire jouer aux associations, aux organisations de solidarité (ONG) et aux usagers.
Il ne nous appartient pas de dire : « voici la solution » mais plutôt « voilà les possibilités, à vous de choisir ».
1. Premier mode opératoire : la commune autoconstructeur
Ce premier mode se caractérise par une concentration des différents métiers ou fonctions entre les mêmes mains : la commune est à la fois maître d’ouvrage, concepteur et entreprise. Elle commande, paie, conçoit, réalise elle-même.
Ce processus d’autoproduction ou d’auto-construction a notamment les faveurs des jeunes techniciens des services communaux. Ils ont hâte de faire la démonstration de leurs connaissances techniques... Les dirigeants de la municipalité peuvent aussi se montrer favorables à ce système de l’autoconstruction aux motifs que « ça sera moins cher » et que « nul n’est mieux servi que par soi-même ».
Cependant rien n’est moins sûr.
Le coût est en général difficile à apprécier, car les services municipaux autoconstructeurs ont l’habitude de ne comptabiliser au titre des coûts que le prix des fournitures supplémentaires qu’il a fallu se procurer spécialement pour les besoins de l’opération : le calque, le carburant, le ciment...
Le problème de la qualité se pose car l’autoconstruction rend difficile le contrôle.
L’expérience montre que l’autoproduction communale est souvent pleine d’embûches :
a. Le maître d’ouvrage exerce une autorité hiérarchique sur le concepteur (les services techniques) et sur le réalisateur (tel ou tel atelier municipal, telle ou telle brigade de travaux) de l’ouvrage. Cette autorité hiérarchique peut être néfaste. Ce qui est demandé à un professionnel de la conception ou de la réalisation c’est non seulement d’être un bon professionnel mais c’est aussi d’être capable de conseiller son maître d’ouvrage et même de s’opposer à tout dérapage technique (« ce que vous nous demandez d’ajouter ici à l’ouvrage principal est infaisable ») ou économique (« ...et entraîne un surcoût ou un coût supplémentaire extravagant »). Ces droits et devoirs de conseil et même de remontrance sont dans une large mesure, en contradiction avec le devoir d’obéissance de l’employé à l’égard de son employeur.
b. Le travail à réaliser pour la production de l’ouvrage se confond avec les autres tâches incombant aux services chargés de la conception et aux services chargés de la réalisation. Le mélange du travail à réaliser pour la production de l’ouvrage avec les autres tâches ordinaires a beaucoup d’inconvénients. Les urgences changent sans cesse en fonction des ordres, des pressions et des circonstances. La multiplicité des tâches exige une gestion rigoureuse des compétences et du temps qui est difficilement praticable. On peut essayer de pallier ces défauts en instituant un système de primes au rendement et au respect des échéances. Ce n’est pas simple. Retenons que l’autoproduction implique une autodiscipline difficile à exercer.
On peut conclure que l’autoconstruction communale est un mode de réalisation d’ouvrage peu pratique et qui comporte bien des embûches. Il est sans doute souhaitable d’en limiter l’utilisation aux :
– travaux de faible envergure difficiles à définir a priori (gros entretien, réparation d’ouvrages existants) ;
– communes disposant de services bien structurés capables à la fois de tenir les délais et de repousser des demandes excessives des dirigeants municipaux.
2. Deuxième mode opératoire : le maître d’ouvrage et l’éventail
Il s’agit là d’une tout autre organisation du travail, dans laquelle la commune exerce la totalité de sa fonction de maître d’ouvrage et donne à faire à des contractants la totalité des tâches de conception et de réalisation.
La commune divise le travail à faire en tâches distinctes. Elle confie la réalisation de ces tâches aux professionnels et aux entreprises qu’elle sélectionne en raison de leurs compétences et de leurs spécialités. Cette division peut avoir pour objectif de tirer le plus grand profit de la spécialisation des professionnels et des entreprises : telle étude de climatisation doit être confiée au meilleur bureau d’étude de climatisation de la place ; tel lot « étanchéité » doit être confié à la meilleure entreprise spécialisée dans ce type de travaux...
Mais ce mode opératoire met le maître d’ouvrage à rude épreuve. Il doit être capable :
– de diviser le travail en tâches, en sous-ensembles homogènes de travaux ;
– de passer autant de marchés que de tâches ;
– d’organiser une coordination d’autant plus stricte que la division en tâches est plus poussée.
L’intensité du travail à fournir s’ajoute à celui qui pèse sur tout maître d’ouvrage : s’assurer de la faisabilité de l’opération, établir le programme, trouver le financement...
Les communes africaines en sont capables, mais elles n’ont pas toutes les moyens techniques suffisants. Elles peuvent se faire assister dans leur fonction de maître d’ouvrage.
Ces tâches d’assistance sont relatives :
– à la conception du projet ;
– à son montage technique, administratif et financier ;
– à sa mise en œuvre (appel à la concurrence, passation des marchés, contrôle de leur exécution...) ;
– à la coordination des intervenants ;
– éventuellement à l’expertise technique des solutions proposées ;
– à la réception de l’ouvrage ;
– à sa mise en service.
Il ne faut pas se méprendre sur la fonction et le statut de la ou des personnes qui assistent le maître d’ouvrage et dont les dénominations sont d’ailleurs variées et changeantes. L’assistant n’est pas le mandataire ou le délégué du maître d’ouvrage (voir plus loin). Il ne le représente pas et n’agit pas à sa place et pour son compte. L’assistant se contente d’aider le maître d’ouvrage :
– il soumet à son appréciation et à sa signature tout projet de décision ;
– il attire son attention sur toute dérive, rédige les projets de marché à lui faire signer...
Autrement dit l’assistant est prestataire de services de conseil, d’étude..., en rapport direct avec la maîtrise d’ouvrage et au bénéfice direct et quotidien du maître d’ouvrage.
3. Une variante du schéma de l’éventail
Le schéma en éventail vient d’être présenté comme le résultat d’une division en tâches correspondant à des spécialisations des concepteurs et réalisateurs. Il peut exprimer une tout autre réalité.
Une municipalité désire faire travailler les petites entreprises locales. Pour que ce soit possible, il faut leur proposer des travaux simples à réaliser et de faibles dimensions. D’où la nécessité de morceler les travaux en petits lots. Par exemple la voie urbaine à construire est divisée en tronçons. Chaque tronçon fait l’objet d’un marché distinct. Il faut que la taille du lot convienne à la taille des entreprises que l’on veut favoriser. Il faudra aussi s’assurer que la grande entreprise de la place ne « rafle » pas tous les lots et reconstitue ainsi un seul et unique marché à sa convenance. A priori une pression officielle sinon amicale sur cette entreprise est la meilleure solution. Il semble difficile en droit :
– d’une part de réserver certains appels d’offre à la catégorie des « petites entreprises », catégorie qu’ignore la plupart des codes des marchés publics ;
– d’autre part d’interdire à une seule entreprise de se porter candidate à toutes les offres.
Il arrive d’ailleurs que ces facilités d’accès à la commande publique ne soient pas suffisantes. Il faut aussi en même temps travailler avec les organisations dont se dotent éventuellement les petites entreprises nationales afin de les préparer techniquement et surtout gestion-nairement.
Le maître d’ouvrage doit enfin s’appliquer à une gestion rigoureuse du marché : paiements fréquents et rapides, présence quasi permanente sur le chantier, contrôles se transformant en actions à la fois préventives et didactiques...
Là encore le maître d’ouvrage est mis à rude épreuve.
4. Troisième mode opératoire : le maître d’ouvrage et l’arbre
La critique du mode opératoire dit de l’éventail est évidente : complexité des tâches incombant au maître d’ouvrage et coût élevé dû à la multiplication des intervenants et des actes.
On peut légitimement souhaiter simplifier ces procédures surtout lorsque l’ouvrage n’est pas d’une grande complexité.
L’avantage qui mérite d’être conservé consiste en la position centrale et stratégique du maître d’ouvrage.
Quelle simplification trouve-t-on habituellement dans la pratique ? Le nombre de branches est ramené à deux ou trois ce qui fait ressembler le schéma du mode opératoire à un arbre pourvu de quelques branches maîtresses.
Dans le cas le plus simple, le maître d’ouvrage contracte avec deux partenaires :
– le premier se charge de l’ensemble des tâches de conception, c’est le maître d’œuvre ;
– le deuxième, l’entreprise, se charge de mener à bien le processus de réalisation.
Ici, évidemment le travail du maître d’ouvrage est plus simple puisqu’il n’a que deux interlocuteurs. Il n’empêche qu’il doit s’occuper de la cohérence des deux démarches. L’entreprise doit exécuter les projets, dessins et calculs du bureau d’études architecturales et techniques, et donc s’abstenir de les modifier pour aller plus vite ou pour augmenter son bénéfice. En revanche, si l’entrepreneur conteste la validité technique d’une solution, il doit en faire part officiellement au maître d’ouvrage, avec lequel il a contracté. Symétriquement, si le concepteur s’aperçoit que l’entrepreneur ne respecte pas ses plans, il doit aussi en faire part au maître d’ouvrage.
Juridiquement, le concepteur et l’entrepreneur n’ont pas de relations : l’un ne commande pas à l’autre et ils ne sont pas non plus associés. Professionnellement, ils doivent communiquer et même bien s’entendre. Toutefois ils ne sont liés contractuellement qu’au maître d’ouvrage. Ceci vaut aussi pour le concepteur qui se verrait investi de la mission de « directeur de l’exécution ». Diriger l’exécution ne signifie pas disposer de tous pouvoirs sur l’exécutant au nom du maître d’ouvrage. Et ce pour au moins deux raisons :
– le concepteur chargé de diriger l’exécution veille et surveille mais ne parle ni ne décide au nom du maître d’ouvrage, qu’il ne représente pas faute d’un mandat l’y habilitant ;
– le maître d’ouvrage lui-même ne dispose pas de pouvoirs de commandement et d’injonction à l’égard de l’entrepreneur, qui possède un savoir-faire spécifique et qui reste un professionnel indépendant, auquel on ne peut pas faire faire ce qu’il réprouve techniquement.
D’ailleurs, en faisant appel à des professionnels, en passant avec eux des contrats par lesquels ils mettent leurs savoir-faire à disposition du maître d’ouvrage, ce dernier sait fort bien qu’il ne salarie pas un simple dessinateur ou un modeste maçon.
Il reste donc bien au maître d’ouvrage à piloter l’ensemble du travail et à veiller notamment à la parfaite coordination des tâches de conception et de réalisation.
5. Quatrième mode opératoire : le maître d’ouvrage délégué
La maîtrise d’ouvrage n’est pas un métier, plutôt une fonction. Mais il est vrai qu’elle est complexe :
– complexité financière : il faut trouver l’argent nécessaire, tirer sur les prix, amputer le projet de quelques perfectionnements trop coûteux...
– complexité technique : pour passer commande il vaut mieux avoir quelques connaissances techniques sur l’objet à construire et le processus de production...
– complexité sociale : il faut exproprier, négocier, composer avec les groupes de pression, faire alliance avec telle association d’usagers, marginaliser telle secte...
Le maître d’ouvrage communal peut donc faire le choix de s’en remettre à un professionnel qui exercera à sa place et pour son compte la fonction de maître d’ouvrage.
Il ne peut évidemment se décharger de toutes ses responsabilités. Le maître d’ouvrage reste celui qui conduit le processus de création et de réalisation de l’ouvrage. Mais rien ne l’empêche de demander à un professionnel d’assurer la conduite de l’opération à sa place, pour son compte et en son nom, c’est-à-dire de déléguer certains de ses pouvoirs à un maître d’ouvrage délégué.
Le délégué ou mandataire est un représentant. Les actes qu’il accomplit sont réputés avoir été accomplis par le déléguant ou mandant. On comprend que ce système du mandat puisse être dangereux. Beaucoup plus qu’un contrat de prestation de service.
Le mandataire prend en charge l’opération. Il peut ne pas en faire assez s’il est nonchalant, ou trop s’il est activiste ; il peut alors devenir le maître d’ouvrage de fait et éclipser presque totalement le maître d’ouvrage de droit.
Comment se prémunir contre ces risques ? En obligeant le mandataire à rendre compte à son mandant fréquemment et à lui expliquer les pourquoi et les comment de ses actes. La comparution physique du mandataire devant un comité de suivi municipal est primordial. Il faut en profiter pour débattre et discuter la facture présentée par le mandataire demandant :
– le remboursement des paiements qu’il a assurés lui-même au titre de l’opération (par exemple le paiement d’une partie des travaux) ;
– et le règlement de ses honoraires.
Ces précautions sont assez efficaces lorsque :
– le maître d’ouvrage a lui-même choisi le maître d’ouvrage délégué ;
– le maître d’ouvrage est effectivement le payeur.
Elles le sont moins lorsque :
– le délégué est imposé, en droit ou en fait, par l’Etat ou un financeur.
– le délégué reçoit, directement ou presque, les fonds du financeur, notamment d’un bailleur de fonds.
Est-il nécessaire d’ajouter que la situation est encore plus difficile lorsque les financeurs imposent leurs propres maîtres d’ouvrage prétendument délégués parce qu’ils n’ont pas confiance en cette collectivité locale ?
En dehors de ces cas limites totalement opposés au pari de cet ouvrage sur le rôle irremplaçable des collectivités locales en Afrique, on ajoutera qu’une bonne solution consiste à faire collaborer maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué à l’occasion des décisions les plus importantes (choix du maître d’œuvre, désignation des entreprises...). Ces rendez-vous obligés sont à déterminer dans le contrat de délégation de maître d’ouvrage. La procédure de décision est à organiser : le rôle de rapporteur serait tenu par le délégué, les contradicteurs seraient les membres du comité de suivi, etc.
Il ne faudrait pas aller trop loin dans cette voie, car si le maître d’ouvrage a choisi de déléguer, c’est pour se décharger de tâches qu’il juge trop lourdes ou trop techniques. Ce n’est pas pour être sollicité à tout moment par son représentant.
Il semble quelque peu superflu de faire contrôler le délégué par un bureau de contrôle. Si l’on veut que le délégué ne fasse pas n’importe quoi, il paraît plus normal que le maître d’ouvrage agisse lui-même, quitte à se faire aider par un assistant auquel pourrait être confiée une mission d’assistance assez étroite et précise. Encore faut-il que l’assistant ne soit pas de connivence avec le délégué !
Il convient d’attirer l’attention sur un point essentiel : le fait pour le maître d’ouvrage public de donner mandat à un délégué soumis au droit privé n’a pas pour effet de placer l’opération en question sous le régime du droit privé. Les contrats que le délégué peut être habilité à passer pour l’établissement du projet puis sa réalisation ne sont pas des contrats privés. Ils sont des marchés publics. La théorie juridique du mandat est formelle : le mandat ne peut modifier la nature juridique des actes qui auraient été passés par le maître d’ouvrage si celui-ci n’avait pas eu recours à un délégué. Ce dernier signe au lieu et place du maître d’ouvrage public des marchés qu’il (le maître d’ouvrage public) aurait pu signer lui-même.
Cette mise au point vaut d’être faite, car les agences de travaux à forme associative qui fonctionnent comme délégués des Etats et des communes sont, toujours à tort, présentées comme une forme de privatisation de la commande publique ; on fait croire que les agences sont capables de transformer la commande publique en commande privée comme un alchimiste transforme le plomb en or.
6. Une variété de délégation de maîtrise d’ouvrage pleine d’intérêt : le délégué spécialisé dans la mise au travail des petites entreprises et œuvrant à l’amélioration du cadre de vie urbain
Le recours à un maître d’ouvrage délégué se justifie sans conteste dès lors que l’on s’engage dans une politique de facilitation de l’accès des petites et moyennes entreprises nationales à la commande publique, en particulier municipale. Cette fonction de facilitation représente une véritable spécialisation.
Malheureusement, dans la pratique, ces opérateurs ne sont jamais des opérateurs municipaux. Ils sont étatiques ou en tout cas dominés par l’Etat. Ils fonctionnent par le moyen de crédits internationaux qui leur sont versés directement en exécution d’accords de crédits conclus par l’Etat et les bailleurs de fonds.
Ce type d’opérateur porté par les Etats et les bailleurs de fonds est particulièrement efficace en ce sens qu’il dispose finalement dans son secteur de tous les pouvoirs et de tous les moyens. Il se sent rarement responsable devant la commune et encore moins son mandataire. Les fonds dont il dispose ne passent pas par les mains de la collectivité locale. Ce sont des fonds prêtés à l’Etat et qui sont simplement « affectés à telle opération localisée dans telle ville ». Dans de nombreux cas, c’est à peine si l’opérateur demande à la collectivité de signer le mandat formel qui lui donne pouvoir d’agir en son nom et qui est une sorte de blanc seing très large et assez vague.
L’opérateur désigné la plupart du temps par le terme d’« agence de travaux » est présenté comme l’appareil technico-administratif d’une association - quelque fois même bénéficiant du statut d’ONG - formée de la réunion :
– de représentants de l’Etat,
– des maires de quelques villes,
– des représentants des organisations repré-sentant les petites entreprises nationales,
– de délégués des syndicats ouvriers,
– de personnalités indépendantes.
La formule de l’association est intéressante en ce qu’elle autorise une sorte de cogestion du processus bien que dans les faits le directeur général ait souvent tous les pouvoirs et se passe de l’avis du conseil d’administration formé des principaux partenaires. Ce même directeur est en revanche très attentif aux moindres des gestes et des paroles des bailleurs qui l’abreuvent de ses fonds.
Le principal mérite de ces agences est de lancer des travaux d’édilité de première nécessité et dont l’impact social est fort (en particulier de réfection ou de construction de voies urbaines de desserte des quartiers souvent populaires). Elles seraient prêtes à travailler directement à la demande (on devrait dire commande) des autorités de quartier, des élus mandatés par la municipalité, des associations diverses. Elles pourraient aussi (mais ce n’est pas encore une pratique : nous réfléchissons ici en termes de « possible ») confier des tâches d’entretien à des réseaux d’usagers agissant comme entrepreneurs de menus ouvrages.
Toutes ces possibilités sont du plus haut intérêt. En attendant que des agences municipales ou plutôt intermunicipales (une agence pour plusieurs municipalités) soient créées, il semble souhaitable que les représentants des collectivités locales siégeant dans les conseils d’administration de ces agences pèsent de tout leur poids pour les rapprocher des communes et de leurs préoccupations. Ils pourraient exiger d’elles qu’elles collaborent plus étroitement avec les services techniques municipaux qui ont besoin et envie d’apprendre. Et enfin, au lieu de contourner les difficultés (par exemple en refusant contre toute logique d’appliquer le droit des marchés publics) ne peut-on demander à ces agences qu’elles aident les dirigeants municipaux à les affronter : par exemple, en les aidant à créer un régime spécial de marchés publics efficace et honnête pour les petits travaux ; par exemple, en les aidant à fortifier les services techniques municipaux qui dans tous les cas de figure auront toujours des travaux à faire par eux-mêmes... et des responsabilités de maîtrise d’ouvrage à exercer.
7. Faut-il aller plus loin ?
La pratique en Afrique n’a pas été beaucoup plus loin. Il est cependant utile de dire que ces modes opératoires ne sont pas figés dans leurs formes actuelles et peuvent évoluer.
Les voies d’évolution possibles sont :
– la pratique du contrat global de conception de tradition anglo-saxonne (voie n° 1, voir plus loin) ;
– le rapprochement avec les procédés d’ingénierie industrielle (voie n° 2) ;
– l’introduction des méthodes de la promotion immobilière privée qui dans les pays pourvus de lois classiques sur la maîtrise d’ouvrage publique sont difficiles à appliquer car elles ont tendance à dessaisir le maître d’ouvrage public d’une partie de ses pouvoirs ou bien à lui proposer de déléguer ses pouvoirs à une personne entièrement privée et non contrôlée par la puissance publique, ce qu’interdisent les dites lois (voies n° 3, n° 4 et n° 5).
Première possibilité (voie n° 1). Le maître d’ouvrage fait du concepteur, du maître d’œuvre, le chef de file de l’opération en lui confiant les responsabilités de toutes les tâches non physiques de l’opération projetée :
– pour partie il fait le travail de l’assistant du maître d’ouvrage en participant à la détermination du programme, à la mise au point du plan de financement, aux opérations foncières préalables...
– pour partie il fait le travail du délégué du maître d’ouvrage en prenant en charge les tâches de suivi de la réalisation.
Nous obtenons un schéma opératoire très simple et très efficace :
– le maître d’ouvrage ne déléguant pas ses pouvoirs de maître d’ouvrage reste très actif et continue à intervenir souvent, mais toutes ses décisions sont préparées par son maître d’œuvre, qui donc joue également le rôle d’assistant du maître d’ouvrage ;
– le maître d’œuvre à mission étendue (qui doit être capable bien entendu de mobiliser toutes sortes de compétences techniques) est la cheville ouvrière du processus opératoire ;
– les prestataires de services particuliers et les entreprises travaillant sous la direction et le contrôle unifiés de l’homme de l’art qui est en même temps l’homme de confiance du maître d’ouvrage.
Ce schéma est à contre-courant des habitudes françaises et francophones qui mettent l’accent sur le délégué du maître d’ouvrage au détriment si l’on peut dire du maître d’œuvre et qui font le pari d’un certain effacement du maître d’ouvrage. Le présent schéma prend une position inverse. Il suppose une sorte de professionnalisation du maître d’ouvrage et une forte technicité du maître d’œuvre. Ce qui n’est pas toujours le cas.
Deuxième possibilité (voie n° 2). Le maître d’ouvrage confie à l’entreprise la mission de faire les études et de réaliser les travaux.
Il se peut fort bien qu’en raison de sa spécificité technique, le projet arrêté par le maître d’ouvrage ne puisse être exécuté qu’en recourant à un processus technique qui ne sont maîtrisés que par deux entreprises. Le véritable choix à faire est un choix entre les deux entreprises et non entre plusieurs projets d’architecture et d’ingénierie. C’est pourquoi il faut immédiatement organiser une mise en concurrence de ces deux entreprises et demander à chacune d’elles une proposition (soumission) intégrant conception et réalisation.
En ce cas l’entrepreneur absorbe, en quelque sorte, le concepteur. Le schéma opératoire s’en trouve simplifié d’autant. Le maître d’ouvrage ne passe qu’un contrat, il ne parle qu’à un interlocuteur... Dans ces conditions, le recours à un maître d’ouvrage délégué ne s’impose pas avec autant d’évidence. On peut penser en revanche que la fonction d’assistant au maître d’ouvrage reste importante et qu’elle doit être assurée par des techniciens indépendants.
Troisième possibilité ( voies n° 3, n° 4 et n° 5). Le recours à des formes de quasi promotion ou de promotion.
La réalisation d’un ouvrage engagée par le maître d’ouvrage public en recourant à des concepteurs, entreprises, mandataires... est toujours une sorte d’aventure. Entre le moment où l’« idée » même de l’ouvrage s’impose comme une sorte d’évidence à tous les décideurs locaux et la mise en service de l’ouvrage enfin construit... que de difficultés, d’incertitudes, de craintes de dépasser le prix prévu... Les maîtres d’ouvrage délégués et les assistants aux maîtres d’ouvrage sont en principe là pour aplanir ces difficultés, pour dissiper ces craintes... bref pour pallier les carences techniques des collectivités locales.
Rien n’interdit cependant de travailler à l’amélioration du processus, notamment à sa simplification, par exemple en proposant que le cocontractant de la collectivité soit unique et prenne l’entière responsabilité dudit processus, s’engageant à livrer le produit à l’heure convenue pour le prix convenu. Le maître d’ouvrage n’a plus la direction du processus. Il passe commande et paie le prix.
Plusieurs variantes sont pratiquées (dans le droit français ces pratiques sont prohibées car contraires à la loi définissant la maîtrise d’ouvrage publique qui, précisément, doit permettre à la collectivité de diriger l’ensemble du processus de production). Nous en présenterons quelques-unes.
Première variante.
Par contrat passé avec la collectivité le promoteur s’engage à exécuter le projet retenu et à le livrer à l’heure convenue et au prix global convenu, à charge de passer lui-même tous les contrats de conception et de réalisation qu’il croit devoir passer avec les firmes qu’il choisit. Le promoteur reste mandataire de la collectivité dont il mobilise les fonds au fur et à mesure de l’avancement du travail. Tout dépassement du prix est supporté par le promoteur (voie n° 3).
Deuxième variante.
Dans d’autres circonstances, le promoteur se présente comme vendeur d’un ouvrage qui est à faire (ou au moins à finir) acceptant sous certaines conditions qu’on le règle à la livraison, clés en main. Il peut aussi y avoir paiement du prix par fractions au fur et à mesure de l’exécution de l’ouvrage, par étapes successives (voie n° 4).
Troisième variante.
Le promoteur est vendeur mais « fait crédit » à la collectivité qui règle le prix par paiements successifs sur une période par exemple de dix ans, le constructeur assurant en outre la maintenance de l’ouvrage pendant la même période (voie n° 5).
L’intérêt de ces trois dernières formules est de déplacer le centre de gravité des risques de la collectivité publique vers le promoteur qui est un professionnel. L’inconvénient est le dessai-sissement de la collectivité comme « patron » du processus de production. C’est évidemment le but que poursuivent les tenants de cette ligne que l’on a pris la mauvaise habitude d’appeler libérale.
8. Des ouvrages non voulus
La pratique communale est riche d’exemples d’ouvrages appartenant à des communes qui ne les ont :
– ni commandés, par le moyen de marchés de ;
– ni acquis, par un acte délibéré.
Il s’agit par exemple de la voirie de lotissement que la commune se voit contrainte d’incorporer à son domaine public alors que l’autorisation de lotir ne le prévoyait pas. Cette voirie est parfois la voie intérieure tout à fait chaotique d’un quartier dit spontané que la commune désire légaliser et par là intégrer pleinement à la ville.
Ce peut être aussi le bâtiment scolaire quelque peu approximatif réalisé par une association de quartier et donné à la commune contre la promesse d’en faire une école.
Evidemment la commune peut toujours refuser d’incorporer à son patrimoine un ouvrage dont elle ne veut pas parce qu’il est mal construit ou tout simplement parce qu’il lui faudra en assurer la charge de fonctionnement et d’entretien. Mais ce droit de refuser est souvent formel. La pression sociale est trop forte... et les élections trop proches. Dans le cas de la légalisation du quartier spontané, cette incorporation est délibérée et le maire ne va pas dire aux habitants riverains : « réaménagez la voie avant de me la confier ».
Il n’y a pas de solutions simples à ce type de difficultés. Pour une commune, la seule attitude praticable consiste à prévenir, à anticiper et surtout chaque fois que c’est possible à enfermer le « don » dans une relation contractuelle.
Bien des autorisations de lotir sont prises par les autorités centrales sans que le maire ne soit invité à donner son avis. C’est particulièrement vrai en Afrique. La plupart des lotissements sont des lotissements domaniaux décidés par les services centraux eux-mêmes qui ne vont tout de même pas s’abaisser à demander l’avis d’instances locales. C’est pourtant au moment de l’instruction de la demande d’autorisation qu’il faut discuter de la viabilité du lotissement qui est à concevoir comme un morceau de ville. Le maire n’est pas en situation d’exiger que l’autorisation colorie en bleu les voies qu’il se propose de communaliser et en rouge celles qu’il ne prendra pas en charge. Il sait bien que malgré ses dire, il risque fort de devoir un jour ou l’autre incorporer toutes les voies au domaine communal. La seule bonne méthode semble consister à rationaliser le réseau viaire interne et à faire passer la raison communale avant les autres. Là le dialogue entre les services techniques municipaux et les concepteurs de la voirie joue un rôle fondamental. Il joue un rôle d’autant plus efficace qu’il est noué tôt, dès les premières esquisses.
Lorsque l’ouvrage est le produit d’une activité informelle ou populaire, on peut là aussi ne pas attendre le dernier moment, la veille de la remise du bien, pour critiquer sa malfaçon. Il faut là aussi prévenir. Un maire peut demander à l’association qui entreprend de réaliser le futur bâtiment scolaire (le maire en est toujours informé) d’accepter dès la conception du plan du futur bâtiment d’entendre l’architecte ou le technicien municipal. Ce n’est pas toujours possible. C’est parfois même complètement contradictoire. Un maire qui lutte contre la création de quartiers spontanés ne peut pas en même temps se présenter comme l’urbaniste conseil de ces quartiers en train de se faire.
Dans tous les cas de figure, il est de l’intérêt de la commune de situer la « remise » du bien dans un « échange de bons procédés » prenant la forme d’une sorte de contrat, qui d’ailleurs peut rester oral s’il est passé publiquement et cérémonieusement comme on en a l’heureuse habitude en Afrique sud-saharienne. L’idéal est de conclure ce contrat en négociant chaque engagement de chaque partie et en lui donnant la forme d’un contrat de concours (ou contrat d’offre de concours) dont la teneur pourrait être par exemple :
– l’association qui a construit le bâtiment scolaire en fait remise à la commune, s’engage à l’entretenir pendant cinq années et entreprend sans délai l’aménagement des abords selon le programme arrêté d’un commun accord entre l’association et la municipalité ;
– la municipalité accepte le bâtiment, procède à son aménagement intérieur et à son ameublement et s’engage à faire toutes les démarches nécessaires auprès des services d’Etat de l’enseignement primaire pour que l’école puisse fonctionner à la rentrée scolaire de...
Pour être parfaitement conforme à la tradition juridique, il convient d’organiser ces engage-ments sous la forme d’une seule offre de concours émanant de l’association assortie de tous les engagements de l’offrant ainsi que de toutes les conditions de l’offre (qui sont autant d’obligations pesant sur l’administration : incorporer le bâtiment au patrimoine communal, aménager et meubler le bâtiment...). Dès que la commune accepte l’offre par délibération du conseil municipal et donc reçoit l’ouvrage, elle met le processus en action. Si par extraordinaire la collectivité était dans l’impossibilité de satisfaire aux conditions posées par l’offre, elle serait dans l’obligation de rétrocéder le bien.
Ce procédé de l’offre de concours devrait être appelé à de larges développements. L’offre peut également consister en totalité ou en partie en une contribution foncière ou même monétaire. En ce dernier cas, dès acceptation de l’offre, les sommes en question sont versées à un « fonds de concours » annexé au budget communal. Ce fonds reste isolé du reste du budget et sera affecté à l’objet désigné : création d’un terre-plein le long d’une avenue commerçante pour que les commerçants riverains puissent déballer plus facilement leurs marchandises et les offrir à la vente ; extension d’un parking à la demande des habitants ; extension du réseau d’eau au bénéfice d’un sous-quartier nouveau...
9. Les travaux d’entretien
L’entretien des ouvrages publics est un des travaux municipaux les plus difficiles. Et, il faut bien le reconnaître, les municipalités sont ici souvent défaillantes. Quelle municipalité accepte d’accompagner la mise en service de tout ouvrage neuf d’une augmentation corrélative et suffisante des crédits d’entretien ? Quelle municipalité a une notion claire de ce qu’entretenir veut dire ? Trop de municipalités se disent qu’il suffit pour entretenir de quelques coups de balai à donner de temps à autre par le service municipal de nettoiement... et que le jour où l’ouvrage sera trop dégradé, il sera temps alors d’envisager de lancer des travaux de réhabilitation lourde.
Pour maintenir la capacité de service d’un ouvrage (ce qui est la définition la plus simple de l’entretien), une municipalité a d’ordinaire recours à ses propres services dits d’entretien qui sont presque toujours parmi les moins bien lotis et les moins bien « considérés ». Faut-il, dans ces circonstances, abandonner cet « auto-entretien » - comme on a pu parler d’autocons-truction - et donner le travail d’entretien à faire à une entreprise spécialisée par le moyen d’un marché de travaux d’entretien ?
La tâche n’est pas aisée car le travail à demander ne se prête pas à une spécification précise sauf s’il s’agit d’un ouvrage complexe livré avec un mode d’emploi énumérant les actes et travaux périodiques à exécuter. On peut se demander alors s’il ne vaut pas mieux confier l’entretien au constructeur ou à l’installateur, au moins pendant la période de garantie décennale. Cela va de soi dans le cadre du contrat évoqué à la fin du septième point de la présente partie (troisième possibilité, troisième variante).
Pour ce qui concerne les ouvrages ordinaires, les solutions ne sont pas évidentes. Les « exemples exemplaires » ne sont pas nombreux. Il semble toutefois que les moins mauvais résultats soient obtenus chaque fois que l’on « implique » les usagers dans le processus d’entretien.
« Impliquer » peut vouloir dire confier l’entretien aux usagers eux-mêmes par le moyen d’un marché de travaux à exécuter sur plusieurs années, qui serait conclu par la commune avec une organisation d’usagers (association de proximité, organisation non gouvernementale travaillant pour une association, entreprise associative ou assimilée « garantie » par des associations d’usagers...).
« Impliquer » peut vouloir dire aussi demander aux associations d’usagers qu’elles participent à la programmation des tâches d’entretien aux côtés du maître d’ouvrage et surtout participent à des réunions périodiques d’évaluation réunissant le maître d’ouvrage et l’entreprise ou le service chargé de l’entretien.
Chaque fois que les tâches sont assez simples et que les usagers sont facilement identifiables ou - encore mieux - constitués en associations, on pourrait expérimenter de telles formules.
10. Se passer des services techniques centraux ?
Le maître d’ouvrage communal est souvent confronté à la volonté de l’Etat de jouer les premiers rôles.
L’Etat, par son ministère en charge des travaux publics, peut vouloir assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de tous les travaux d’infrastructure et de bâtiment des collectivités locales.
Il peut aussi revendiquer au minimum une sorte de mission de contrôle technique des projets et des travaux d’infrastructure se traduisant par :
– un visa des plans et pièces écrites annexées aux plans ;
– une participation à la réception de l’ouvrage.
Entre ce maximum qu’est la maîtrise d’ouvrage déléguée et ce minimum qu’est le contrôle, toutes les situations peuvent se rencontrer.
Le passage des municipalités par les services techniques de l’Etat est en général présenté comme une protection des collectivités publiques contre elles-mêmes et une garantie de bonne qualité technique des ouvrages publics. Il n’est pas rare qu’il faille y voir aussi la volonté de puissance des ingénieurs ou des architectes d’Etat et leur souci tout à fait trivial de prélever au profit de leur administration quelques honoraires pour services rendus. Les collectivités locales ne s’aperçoivent pas toujours de l’existence de ces honoraires qui sont parfois versés directement par l’entreprise. Il est assez classique de voir en effet le « surveillé » et le « contrôlé » payer à son surveillant et son contrôleur les honoraires de surveillance et de contrôle.
L’obligation pour la commune de passer par les services techniques de l’Etat n’est pas toujours fondée juridiquement. Il n’est pas rare que cette obligation soit exprimée par un simple organigramme approuvé par arrêté du ministre chargé de l’équipement, donc sans effet à l’égard d’une collectivité locale dont l’autonomie est attestée par la Constitution ou une loi. Cette obligation est souvent le fait d’un décret ou d’une loi promulgué bien avant que le principe constitutionnel de l’autonomie de toutes les collectivités territoriales ne soit affirmé.
Quoiqu’il en soit la municipalité, si elle ne veut pas perdre trop de temps, devra l’accepter. Autant alors tirer parti de cette collaboration obligée en exigeant des services techniques centraux :
– qu’ils s’engagent contractuellement envers la commune à faire tel travail dans tel délai pour tel prix ;
– qu’ils livrent à la commune des avis, notes techniques et visas soigneusement argumentés et expressément signés par eux, ce qui les engage ;
– et surtout qu’ils collaborent avec les services techniques communaux afin de les entraîner et les aguerrir.
La situation est beaucoup plus embarrassante lorsqu’un organisme d’Etat se voit confier la responsabilité de gérer des programmes entiers d’investissements communaux sur financement extérieur.
Les bailleurs de fonds ont pris en effet l’habitude de confier « leurs » programmes d’inves-tissement à des établissements publics d’Etat spécialisés dans la conduite d’opération ou à des sociétés d’économie mixtes spécialement mandatées par l’Etat. Ces institutions ne se contentent pas seulement de piloter ces programmes, mais elles s’en reconnaissent les maîtres d’ouvrage - en titre et non délégué - et aussi les maîtres d’œuvre, chargés donc aussi des études de projet ainsi que de la direction et du contrôle de leur l’exécution. Les communes sont souvent impuissantes face à ces forteresses.
Heureusement, ce type de pratique s’estompe. Il est trop clairement contraire au principe d’autonomie de l’administration communale.