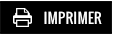Soulèvement populaire dans les banlieues et idéologie sécuritaire - Gustave Massiah - 2005
Publié par , le 6 mars 2005.
Ce qui s’est passé dans les banlieues françaises, en novembre et décembre 2005, est un événement au sens le plus fort du terme ; une rupture dans la continuité, porteuse d’incertitudes et ouvrant plusieurs avenirs possibles. Il n’était bien sûr pas imprévisible et il est possible, surtout à posteriori, d’en étudier les causes, ou du moins certains enchaînements qui permettent de l’expliquer. Il est nécessaire d’en proposer des leçons, mais il faut se garder de le considérer comme épuisé, de se hâter de le clore pour pouvoir le disséquer tout à loisir. Ne nous précipitons pas pour en tirer des conclusions définitives, les grands événements produisent des ébranlements qui ne sont perceptibles que dans le temps long. A la question : « quelles leçons tirez-vous de la révolution française de 1789 ? », Mao Tsé-Toung ne répondait-il pas « il est encore un peu tôt pour se prononcer complètement » ?
La difficulté d’explication et les divergences entre les représentations commencent déjà avec la manière de nommer ce qui s’est passé. Faut-il parler de banlieues populaires, au sens de la périphérie et de la relégation, le fameux lieu du ban médiéval, ou faut-il parler des quartiers populaires ? Faut-il parler d’émeutes urbaines, de révoltes des jeunes, etc. ? L’événement se laisse difficilement enfermer dans des catégories prédéterminées. Considérons qu’il s’agit d’un soulèvement populaire ce qui ne suffit pas à le caractériser mais constitue déjà une prise de position. Pour le limiter, on a voulu le résumer à une révolte de garçons de 12 à 16 ans, surtout enfants de migrants, brûlant sans raisons déclarées, sans représentants, les voitures de leurs voisins, les écoles et les gymnases.
En fait, ce soulèvement a pris son sens autant par ce qu’il n’a pas été que par ce qu’il a affirmé. Il a ainsi déjoué les préjugés les plus tenaces. Il n’était pas question d’immigrés puisqu’il s’agit essentiellement de jeunes français. Il n’était pas question des réseaux criminels et maffieux, ceux-ci ont été soucieux de ne pas provoquer la police et sont restés ostensiblement en dehors du coup. Il n’était pas question de terroristes islamistes ni même de musulmans fanatisés imperméables aux arguments des imams mobilisés par le gouvernement. Il n’était pas question de pillards profitant de l’incendie des supermarchés.
Certes, ceux qui se sont manifestés n’étaient qu’une partie des couches populaires de ces banlieues. Mais, ils ont bénéficié sans aucun doute de la compréhension de nombreux autres habitants ; des filles de leur génération, de leurs parents et d’une grande partie de leurs voisins. Il y a eu, certes, pour beaucoup une condamnation des violences, mais même parmi ceux qui l’ont fait, la plupart ont tenu à reconnaître l’importance des questions qui ne pouvaient plus être ignorées.
La situation sociale est évidemment la première raison mise en avant. La montée du chômage est directement liée aux politiques néo-libérales qui ont abandonné l’objectif de plein emploi des politiques keynésiennes pour mettre en avant la réhabilitation des profits à court terme, la libéralisation et l’ajustement structurel au marché mondial et la concurrence sans frein régulée par le marché mondial des capitaux. Mais, le chômage, quelle que soit la part qu’il prend dans cette situation n’est pas suffisant pour expliquer les formes de l’explosion. Ce qui prévaut dans les raisons immédiates, c’est le sentiment d’injustice. Celui-ci résulte d’abord de la prise de conscience que le chômage n’est pas une fatalité, qu’il est la conséquence des politiques dominantes. Comme le sont les inégalités sociales et la différence croissante entre la pauvreté à un pôle et l’accumulation sans vergogne des richesses à l’autre. Le détonateur, c’est le refus des discriminations et le fait que les discriminations sont intimement liées aux inégalités et aux politiques qui les accentuent. Point n’est besoin de grande démonstration pour comprendre qu’on n’est pas pauvre par hasard dans notre société, que les chances d’être pauvres ne sont pas tellement réparties, que les discriminations se traduisent dans les exclusions et les relégations.
Ce soulèvement populaire a atteint un premier objectif : plus personne ne peut prétendre que dans la société française il n’y a pas d’inégalités sociales et de discriminations.
Les jeunes se sont attaqués à ce qui était à leur proximité, à ce qu’ils connaissent le mieux de cette société qui les rejette. Ils connaissent les contrôles policiers incessants, c’est pour eux l’image même de la discrimination et du mépris. Il faut dire que la politique officielle y est pour beaucoup, elle prend comme modèle la répression ostensible, laissant libre cours aux policiers racistes et rend la vie impossible à ceux qui voudraient associer la sécurité à la justice et au respect. Ils connaissent aussi les écoles et les équipements publics, c’est pour eux l’image d’une promesse inaccessible. Là aussi la politique officielle y est pour beaucoup. Le système éducatif est devant une contradiction impossible, il n’est pas en mesure de répondre à lui seul à une situation sociale qui lui échappe, il ne peut pas garantir un travail alors que le chômage est une donnée structurelle résultante. La bonne volonté des enseignants, des travailleurs sociaux, des agents municipaux est confrontée à une impossibilité et au choix d’un élitisme construit comme antinomique de l’égalité renforce la ségrégation sociale et urbaine.
La question de la violence est celle qui s’impose dans les discussions et donne lieu à toutes les généralités. Rappelons d’une manière générale que la violence n’est pas illégitime quand elle est, sans autre alternative, la seule forme de lutte possible contre les oppressions. Ce qui laisse ouverte la discussion, en situation, de la nature des oppressions. Mais, les formes de la violence et les cibles de la violence doivent toujours être interrogées et certaines sont forcément condamnables. Il faut dire aussi que l’utilisation à tort et à travers de l’accusation de terrorisme finit par brouiller les limites et banaliser toutes les formes de violence. Il faut dire aussi que le monopole de la violence légitime à l’Etat, une des modalités de la démocratie, implique la justification des modalités de l’action publique et la proportionnalité de cette action aux dangers réels. De ce point de vue, l’état d’exception apparaît comme une action idéologique qui stigmatise une partie de la population et comporte des risques réels pour les libertés de tous.
Peut-on considérer ce soulèvement comme un mouvement coordonné, préparé et organisé ? Ce ne semble pas être le cas. Bien que nous rencontrions, là encore, la question des appellations, chaque terme renvoyant à des évènements qui se sont déroulés dans d’autres situations historiques et même à la représentation, souvent un peu mythifiée de ces évènements. Malgré cette absence d’organisation, on peut avancer que le soulèvement a su faire preuve d’une réelle autonomie et éviter les dérives les plus dangereuses. Le manque de leaders a réduit la lisibilité de la révolte. On peut y lire la leçon de l’échec des périodes précédentes dans les luttes des jeunes des banlieues. L’échec du mouvement d’intégration de 1982 récupéré et détourné, notamment par SOS racisme, a vacciné plusieurs générations contre les promesses des politiques, des associations bien-disantes et le rôle des médias. L’investissement dans des associations de proximité n’a pas permis une très grande intégration, elle s’est aussi heurtée à l’action des municipalités qui, parfois avec de bonnes intentions, ont coupé les dirigeants de ces associations de leur base et conduit à la méfiance par rapport aux représentations intermédiaires. La troisième tentative est le passage d’une partie des jeunes par la religion ; les révoltes de décembre en marque-t-elle les limites ou renforceront-elles ce recours ? Le manque de représentants mandatés ou de porte-paroles patentés n’a pas empêché le soulèvement de se faire entendre. Une des interrogations porte sur les formes d’organisation de la nouvelle génération et sur le rôle que joueront les porte-paroles qui se dégageront.
Pour autant, les considérations sociales sont largement partagées dans l’opinion. Il peut alors paraître paradoxal que les sondages plébiscitent le maintien de l’ordre. Ce paradoxe n’est qu’apparent. Il participe de la différence entre le court terme et le long terme dans les conséquences des grands événements. Comme le notait si justement Karl Marx, dans Le 18 Brumaire, après toute période de désordre, il y a une forte demande de retour à l’ordre qui prend, en France la forme d’un recours à un sauveur et du bonapartisme. Encore récemment, en 1968, les élections ont donné une Assemblée Nationale parmi les plus à droite de la République. Ce qui n’a pas empêché le mouvement social de se maintenir et d’imposer les accords de Grenelle. Aucune évolution n’est prédéterminée.
Comme tout événement, le soulèvement populaire a mis en lumière certaines des contradictions importantes de la société française d’aujourd’hui. Il ne donne pas de réponses ou de certitudes ; il donne de nouveaux éclairages, de nouvelles manières d’appréhender les questions. Il met en évidence la difficulté de faire la part entre les nouvelles pratiques et réflexions et les réactions de refus de ces évolutions. Prenons par exemple la manière dont la famille est interpellée. Alors même que l’individualisme d’un côté et la reconnaissance des droits de l’enfant de l’autre accentuent l’autonomisation des jeunes, la famille est convoquée en renfort de l’ordre moral et de la sécurité publique. La signification des allocations hésite entre le droit à un revenu et la redistribution d’une part et l’incitation à l’insertion, la sanction des écarts à la normalité. Les changements démographiques se traduisent par des évolutions des rapports de pouvoir entre les générations qui recoupent les changements sociaux. Les sociétés confrontées au vieillissement et à la précarisation n’ont pas de projet à proposer à leur jeunesse ; elles en ont souvent peur.
Le soulèvement des jeunes des banlieues a relancé les débats, abusivement confondus, sur les migrations et sur le racisme. Plusieurs questions méritent d’être retenues, la manière de les mettre en avant devenant elle-même un enjeu du débat. Les réactions contre l’immigration, de plus en plus dures, peuvent cacher une acceptation de plus en plus forte de l’ouverture de la société ; c’est l’hypothèse qui peut-être proposée. Il y a évidemment des Français qui sont racistes, mais il est sûr que tous les Français ne le sont pas, et il est loin d’être sûr qu’il y en ait plus qui le soit. D’autant que les comportements peuvent être contradictoires. On peut penser que l’exacerbation des attaques racistes est une réponse au renforcement de l’antiracisme en tant que valeur de référence. Rien n’est joué entre la banalisation de certaines des idées du Front National et le rejet renouvelé des références aux idées du Front National. La question du racisme n’est pas seulement idéologique. Ce qui est insupportable c’est la persistance d’un racisme institutionnel qui marque une part de l’appareil d’Etat en contradiction avec le principe admis de l’égalité des droits. Depuis deux décennies, le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme demande que le droit des étrangers soit fondé sur l’égalité des droits et non comme aujourd’hui sur le principe du maintien de l’ordre. Aujourd’hui, c’est l’inverse qui se produit dans l’évolution du droit dans de nombreux domaines ; les réductions des droits des plus fragiles, en l’occurrence les étrangers, prépare la remise en cause des droits de tous. Comme dans tous les pays et dans le monde, nous sommes confrontés au fait que la décolonisation n’est pas achevée. En France, le racisme est encore très marqué par la persistance d’une idéologie qui refuse de rompre avec l’idée coloniale et qui sert des intérêts économiques et électoraux. Le choc est d’autant plus violent que la lutte contre le colonialisme et les dominations joue aussi un rôle majeur dans la conscience politique de nombreux Français.
La discussion sur le modèle républicain a pris beaucoup d’ampleur en France. Il présente d’autant plus d’intérêt qu’il met en avant l’importance de l’égalité dans les valeurs de référence. Cette discussion soulève des questions d’une grande importance que nous n’avons pas la place d’aborder ici. Je voudrais simplement souligner une question qui a émergé dans les réactions aux révoltes urbaines. Contrairement à une idée injustement répandue, les luttes et les résistances des jeunes confrontés aux discriminations ne sont pas forcément et spontanément communautaristes, même quand elles concernent des communautés de différentes nature et qu’elles font référence aux solidarités traditionnelles. Ce qui ressort de ce coup de projecteur sur notre société réelle, c’est que c’est la gestion de la société qui est ethnique et qui combine la purification sociale et la ségrégation spatiale. Accepter de minimiser les discriminations et de sous-estimer les injustices pour défendre la République, c’est mettre en danger mortel l’idéal républicain.
Le soulèvement populaire dans les banlieues françaises remet sur le devant de la scène l’importance des luttes urbaines. Cette révolte retrouve quelques caractéristiques des révoltes récurrentes depuis celles de Los Angeles, dès les années 80, puis celles de Birmingham dans les années 90. Elles différent des émeutes urbaines de la fin des années 60, comme celle de Watts aux Etats-Unis qui concernaient plus le mouvement noir américain ; il s’agit de ce que l’on pourrait caractériser comme une nouvelle génération d’émeutes urbaines dans les villes-monde. Elles illustrent les conséquences des politiques néo-libérales en matière de chômage et de pauvreté, de l’interaction entre inégalités, discriminations et racisme. Elles renvoient aussi à l’explosion des contradictions Nord-Sud dans les villes européennes. Elles soulignent la montée en puissance des idéologies sécuritaires en réponse à l’insécurité sociale et écologique. Elles rappellent que les politiques de gestion des émeutes urbaines ont mis constamment en avant une double réponse : diviser les quartiers par une politique sélective de promotion sociale ; réprimer les porte-parole. Aux Etats-Unis, par exemple, le soutien à l’émergence d’une bourgeoisie noire et la liquidation, y compris physique, des leaders des mouvements radicaux ont été menés de front. En France, on peut parler des contradictions de l’intégration. On ne peut pas dire qu’il n’y a eu aucune intégration ; la discussion porte sur la nature de l’intégration, sur la rupture des solidarités, sur les conséquences des politiques qui donnent des chances à quelques rares élus et rejettent encore plus loin la majorité des exclus.
Puisque nous parlons de l’égalité et de la justice, il nous faut revenir sur les politiques qui les mettent en cause. Il faut ensuite insister sur le rôle de l’idéologie sécuritaire qui accompagne et prépare ces politiques en s’attaquant aux valeurs même de l’égalité et de la justice (1).
Comme nous l’avons abordé, les gouvernements ont mis en œuvre, avec entêtement et constance, un gigantesque transfert de richesses ; ils ont accéléré la redistribution des pauvres vers les riches. D’un côté, ils se sont attaqués à l’aide médicale aux plus démunis, à la réduction du temps de travail, à l’indemnisation du chômage. De l’autre ils ont allégé la fiscalité pour les familles les plus aisées et remis en cause l’impôt sur les fortunes. Ils ont facilité la fantastique propension des entreprises à licencier, “Vouloir les en empêcher, déclarait François Fillon, c’est comme vouloir empêcher la maladie.” Les gouvernements ont accentué la précarisation en minant les systèmes de protection sociale.
La mobilisation sociale conteste le cœur de cette politique. Elle a révélé un refus profond de cette orientation et l’apparition d’une nouvelle radicalité, c’est à dire de la prise de conscience qu’il faut prendre les choses à la racine. La criminalisation de toute contestation, de toute révolte, de tout refus est une des réponses à cette prise de conscience. Elle s’inscrit dans la montée de la pensée sécuritaire qui culmine dans l’idéologie policière spectaculaire qui accompagne la « tolérance zéro ». Cette conception policière de l’Histoire est largement partagée. Elle est assumée sans complexe et même avec une certaine délectation par la droite. La gauche institutionnelle ne paraît toujours pas se rendre compte de la profondeur du discrédit qu’elle a gagné en se ralliant au camp des forts et des réalistes, en succombant aux certitudes et aux délices de la pensée sécuritaire et en la légitimant.
Après s’être faufilée presque honteusement dans les discours politiques, la pensée sécuritaire a fini par en occuper tout l’espace. Elle a préparé puis accompagné la montée des nouvelles alliances populistes. Elle se traduit aujourd’hui sans complexes dans des politiques qui en dévoilent la nature. Les dernières mesures discutées en France sont significatives. Les ennemis ce sont les jeunes, les pauvres, les étrangers ; ils le sont par nature. Ils menacent les personnes et les biens, ils sont violents, envahissent l’espace public, occupent les propriétés. Et pourtant, les dangers ne sont pas tellement plus grands qu’avant, la violence n’est pas nouvelle, les « barbares » ne sont ni plus nombreux ni plus envahissants. C’est leur acceptabilité qui a changé et la crainte qui a grandi. De quoi nos sociétés ont-elles donc peur ?
L’évidence sécuritaire n’est pas tombée du ciel, elle a été construite. L’idée de la continuité entre les petites incivilités et la grande délinquance se revendique du bon sens, elle n’a pourtant aucun fondement scientifique ; elle permet surtout d’éviter toute interrogation sur la grande criminalité. Foin des faiblesses coupables, il suffirait de montrer sa force pour en finir avec l’insécurité. Inutile de s’interroger sur les causes et les responsabilités, sur la nature de cette insécurité, il suffit de constater qu’elle est là et de s’interroger sur la manière de la faire disparaître. Pour les partisans de la manière forte, il est clair que seuls des esprits faibles peuvent perdre leur temps à s’interroger sur le pourquoi ; les réalistes et les efficaces savent bien qu’il faut se concentrer sur le comment !
Pour pouvoir stigmatiser les réactions des pauvres, il faut bien d’abord convaincre qu’il n’y a pas de rapport entre violence et pauvreté. C’est là que la démarche a été habile ; elle a consisté à s’appuyer sur l’affirmation, peu contestée, qu’on ne pouvait pas tout expliquer par la pauvreté pour inverser la charge de la preuve. Aux pauvres et aux étrangers de faire la preuve de leur innocence ! D’autant que dans le fond, on est persuadé qu’ils auraient toutes les raisons de se révolter, ce qui suffit bien à les rendre suspects. Il a fallu ensuite disqualifier la prévention pour laisser place nette à la gestion de l’exclusion par la répression. Pour autant, au-delà de la bonne volonté de ceux qui s’y sont engagés, peut-on qualifier de préventives les politiques sociales, scolaires, urbaines qui ont été mises en œuvre ? Ont-elles fait reculer les inégalités, les discriminations, les rapports de domination, la précarisation, les humiliations ? Avec le cours dominant de la mondialisation qui s’est imposé aux sociétés, l’insécurité sociale est une réalité de plus en plus largement vécue. Les crises financières répétées, les risques environnementaux majeurs et le vacarme des guerres ont accru l’insécurité dans l’avenir.
On peut remettre en cause le discours dominant et montrer la nature des politiques à l’œuvre sans tomber dans l’angélisme. La violence existe, la comprendre n’est pas la justifier. Le recours à la répression est l’aveu d’un double échec. Celui de la non réponse aux questions qui ont conduit à la violence et celui de l’incapacité à maintenir le rapport de confiance nécessaire à la vie en commun. Sans oublier que les comportements violents s’inscrivent dans la stratégie de ceux qui en ont besoin pour se légitimer. Le péril pour toute la société est dans l’enfermement d’une culture de l’échec, de la paupérisation des moyens d’expression, de la perte de repères. L’exclusion d’une partie d’elle-même gangrène toute la société.
Si la gestion sociale ne suffit pas et qu’on refuse d’imaginer qu’une révision déchirante s’impose, il faut alors « bétonner » et la porte est ouverte à la répression. La diabolisation des jeunes et des lieux, banlieues et quartiers, renvoie à une stratégie de lutte contre l’ennemi de l’intérieur : la gestion du social trouve ses sources dans la gestion du handicap ; la référence aux valeurs renvoie au moralisme et met en avant la normalisation ; la violence est assimilée au terrorisme à quoi répond la pacification. Dans cette stratégie du fort au faible on perd vite la mesure, on perd de vue que la légitimité d’un ordre social dépend de la capacité de tenir compte de l’état de nécessité et de proportionner les réponses aux transgressions. Mais, la réponse en termes d’apartheid, de ghettos et de réserves se paye très cher ; en dressant des barrières de protection, on s’enferme soi-même, et l’inquiétude se nourrit d’elle-même ; refuser l’autre, c’est toujours se refuser soi-même. La société que l’on construit devient vite invivable. Peut-on donner une meilleure définition de l’intolérance totale que la tolérance zéro ?
(1) La suite de ce texte reprend un article de Gustave Massiah publié dans Libération en juin 2003 sous le titre « La tolérance zéro signifie mathématiquement l’intolérance totale »
Gustave Massiah
Décembre 2005