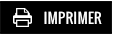Des associations dans des quartiers : éloge de la mobilité - Sonia Fayman - 1999
Publié par , le 6 mars 1999.
Texte paru dans la revue "Fondations", novembre 1999
L’observation du tissu associatif dans les quartiers en contrats de ville (1) suggère une réflexion à la fois sur la contribution des associations d’habitants au développement social local et sur l’effet en retour sur les individus membres de ces groupements.
Nous évoquerons quelques types d’associations que l’on rencontre dans ces quartiers, soit qu’elles se forment à partir d’une origine, d’une culture commune, soit qu’elles existent sur une base résidentielle (habitants d’un même quartier). Nous nous intéresserons surtout à des associations créées par des jeunes et par des femmes qui, au cours des quinze dernières années, ont fortement marqué à la fois la vie des quartiers, la politique de la ville et le débat sur la citoyenneté.
Les associations dites communautaires
On parle d’association communautaire lorsque celle-ci regroupe des individus en fonction de leur origine, sur des objectifs qui peuvent être culturels, cultuels ou de solidarité. Des sociétés des Auvergnats, des Bretons de Paris, aux groupes folkloriques portugais et aux associations des originaires de Sous-s, de Kovno ou des vallées des fleuves Sénégal ou Niger, le processus est le même et il est bien connu : le rassemblement est identitaire, source de réconfort par les souvenirs, les dates, les anecdotes et les mets partagés, par l’évocation du milieu d’origine ; il est aussi un moyen de pénétration dans la société dite d’accueil, par l’entraide, les "tuyaux" et parfois de véritables filières d’accès au logement et à l’emploi initiées par des migrants plus anciens ou particulièrement dynamiques.
Ce type d’association peut favoriser le passage d’un système social à un autre, sans faire nécessairement évoluer le système de représentations et de symbolisation de l’individu membre. On a pu en effet observer que les compatriotes regroupés, tendent à maintenir des comportements et des pratiques du pays tel qu’ils l’ont laissé, sans participer à l’évolution des moeurs que celui-ci traverse (quelle qu’en soit l’orientation). Ils sont donc dans la reproduction des habitus, et l’association d’originaires d’un même lieu est un puissant facteur de contrôle social qui valorise cette reproduction de même qu’une certaine statique des relations familiales et communautaires.
Dans ce cas, l’appartenance associative a une tonalité qui peut être plus ou moins tournée vers l’adaptation collective à un milieu nouveau, ou vers la constitution, collective aussi, d’une sorte de rempart contre l’aspiration par la société d’accueil.
D’autres associations sont considérées à tort comme communautaires. Ce sont notamment des associations créées par des jeunes gens nés de parents étrangers (ou immigrés d’anciennes colonies ou de la "France d’outre mer"), dans la mouvance d’une part de l’abrogation en 1981 du décret-loi vichyste de 1939 qui privait les étrangers du droit d’association, et des marches pour l’égalité organisées en 1983 et 1984, et d’autre part du développement social des quartiers appelé par la suite politique de la ville. Ce contexte se manifeste dans une revendication de citoyenneté de la part des "jeunes des quartiers" dont les regroupements sont animés par le ressenti de la discrimination et de la relégation (2).
La marque "Communautaire" est imprimée à tort sur ces regroupements par le Personnel municipal ou administratif, dont une Partie est peu au fait de la nuance entre les associations d’originaires et ce mode de regroupement, et qui dans l’ensemble sous estime complètement le phénomène d’assignation à résidence dans les quartiers (3).
La discussion sur l’emploi de ce terme n’est pas sans importance à un moment où des courants de pensée racistes et négationnistes véhiculés par les Le Pen, Garaudy et consorts poussent précisément à un repli communautaire qui se développe également en réaction à la mondialisation.
Les associations de quartier dans la politique de la ville
La grande innovation du DSQ (4) réside dans ce qu’on a appelé la territorialisation des Politiques sociales et urbaines. Celle-ci s’est d’ailleurs effectuée de façon inégale, au gré de la propension ou des résistances des appareils institutionnels verticaux (hiérarchiques) et sectoriels, à l’introduction de démarches transversales aux différents secteurs et induisant des relations horizontales.
Le type d’acteur qui s’est le plus facilement coulé dans la territorialisation à l’échelle du "quartier" est l’association. On a beaucoup dit et écrit que la politique de la ville (dès l’époque du DSQ) avait suscité la création d’associations, qu’elle les avait en quelque sorte téléguidées, ou qu’elle en avait fait les postes avancés de sa stratégie dans les zones à réhabiliter, redynamiser, requalifier... C’est un peu rapide, même si cette analyse recouvre une partie du phénomène et ne s’avère pas totalement erronée.
L’offre de subventions pour des projets d’habitants, pour des actions de consolidation de lien social, d’encadrement des enfants et des jeunes, de formalisation des solidarités de voisinage ou de tentatives de les créer... a certes encouragé la formation de groupements incités à se doter de statuts, conformément à la loi de 1901, et a induit, dans ces groupes et parmi les associations préexistantes, des pratiques correspondant aux axes du développement social prônés par les partenaires institutionnels.
Mais on peut mettre au crédit de la politique de la ville, du moins de ses animateurs locaux dans un certain nombre de sites, d’avoir proposé des financements sur des thèmes pertinents eu égard aux difficultés rencontrées par les populations concernées. Le fait d’avoir entraîné des organismes associatifs dans ce sillage n’est donc pas en soi contraire à l’objectif de développement social notamment appuyé sur l’action collective. Il s’agit seulement de savoir si les formes de sociabilité primaire que représentent les associations se maintiennent, voire se développent, ou si les associations, happées dans la spirale de l’action publique, se coupent peu à peu de leur base.
L’espoir d’une nouvelle citoyenneté
Le désarroi de la jeunesse dans les quartiers périphériques d’habitat social a donné lieu à des manifestations dont les formes ont évolué depuis le début des années quatre vingt. Si aujourd’hui, le phénomène de bandes, et de bandes rivales d’un quartier à l’autre, se développe et n’est plus contré que par des mouvements religieux (5), il n’en était pas ainsi quinze ans plus tôt. A ce moment là, aux flambées de violence spontanées s’opposaient des démarches politiques axées sur les droits, la reconnaissance sociale et la "nouvelle Citoyenneté" : au retour des marches pour l’égalité, des jeunes créaient dans leurs quartiers des associations principalement tournées vers la recherche collective de solutions aux problèmes rencontrés d’abord par eux, les jeunes de 20 ans, mais aussi par les enfants : scolarité, loisirs, formation, émancipation. Les motivations étaient très souvent épidermiques et peu théorisées : refoulement des boites de nuit et des bars, ennui dans l’espace public des quartiers, conflits avec l’encadrement des équipements sociaux et culturels, sentiment d’être incompris ...
De jeunes arabes ont été en pointe dans cette dynamique, dans le nord de la France, à Lyon, Toulouse, en Provence, en lie de France... d’où la tentation qu’a eu le sens commun d’affubler leurs associations de l’étiquette "communautaire". Or les associations, à quelques exceptions près, ont d’emblée évolué dans une ambivalence, qui ne supporte justement pas d’étiquette, entre un recrutement de fait issu de l’immigration et une volonté d’action et de discours dépassant la spécificité de la provenance, pour atteindre le coeur de l’oppression et de la misère matérielle et morale. Les cadres des associations ont à cet égard été au coeur d’une contradiction née du fait de revendiquer des origines particulières dans un travail se voulant universaliste - contradiction motrice parce qu’elle fait se confronter non seulement des méthodes de travail social, mais également des conceptions de l’évolution de la société française.
Ces associations sont nées dans des quartiers où sévissent non seulement le chômage et la pauvreté mais aussi la ségrégation. Dans ces conditions, elles se sont développées sur la base d’un déficit de citoyenneté et ont acquis d’emblée une dimension politique, au sens où elles s’inscrivent objectivement dans un processus de changement social, que celui-ci soit explicite ou non dans les buts affichés.
Si certaines de ces associations n’ont duré que quelques mois ou années, d’autres ont survécu au prix de mutations qui affectent les projets, le fonctionnement et le rapport à l’environnement. Et c’est ce qui, à la différence des associations plus strictement communautaires, fait évoluer les systèmes de représentation de leurs membres.
Des repères transactionnels
Au cours des années 80, les associations connaissent d’abord une phase de démarrage caractérisée par le militantisme et l’intensité de la vie associative. Vers le milieu de la décennie, et dans Sa seconde moitié, le recours au financement public se développe. Le FAS est le premier organisme à offrir des subventions aux associations qui s’en servent pour salarier un de leurs membres ou recruter quelqu’un pour assurer, à temps partiel, l’accueil et le secrétariat. Cette étape est le premier pas d’une évolution dans laquelle vont s’engager les associations de quartier, qui formalisera l’orientation prise en déposant des statuts de la loi de 1901 quelques années plus tôt mais non totalement assumée tant que les associations restaient dans un fonctionnement de bandes de jeunes.
Le fait de salarier en premier la fonction de secrétariat et d’accueil, n’est pas anodin. Il marque la volonté d’organiser la relation avec l’extérieur, donc de se projeter dans un rôle social, tant vis-à-vis de la population de la cité que vis-à-vis des bailleurs de fonds et autres partenaires. En même temps, c’est le début d’une structuration des associations autour d’activités ouvrant droit à subventions, qui attireront du public, et nécessiteront d’étoffer l’encadrement en nombre et en compétences.
Bon nombre des associations observées ont vu la vie associative diminuer au profit d’une certaine professionnalisation. Un élément d’explication réside dans le fait que dès le début, elles ont adopté une démarche de don, de prise en charge de problèmes concernant des catégories de population perçues comme étant dans le besoin de culture, d’ouverture, de loisirs, de citoyenneté..."aider les plus jeunes", "permettre aux femmes de sortir de chez elles et de se retrouver entre elles" sont des thèmes fondateurs. S’étant professionnalisées, les associations se sont trouvées dans une situation ambiguë : elles jouent le rôle de service public sans être officiellement missionnées pour cela, mais en étant tout de même des opérateurs de premier plan des politiques contractuelles telles que la politique de la ville.
Dans cette démarche elles ont été soutenues financièrement par des institutions telles que le FAS, les ministères et fondations en charge de la jeunesse, du sport, de la culture, de l’action sociale, ainsi que par les collectivités territoriales. La spécificité de chacune de ces administrations n’a pas facilité l’insertion des associations dans le régime des subventions publiques, devenues néanmoins indispensables à la réalisation de leurs objectifs. La politique de la ville a représenté la seule instance de concertation entre tous ces acteurs. Les associations en ont espéré un allègement des procédures, qui tarde à se concrétiser, et elles y ont parfois gagné de la légitimité. Confrontés à la dégradation des conditions de vie et de sociabilité dans les quartiers, les maîtres d’ouvrage de cette politique en viennent à reconnaître que les associations d’habitants, qui sont les intervenants le plus au coeur de la population, sont les derniers garants d’une paix sociale fragile. L’effet pervers de cette reconnaissance est visible dans le saupoudrage des crédits dicté par la crainte de troubles sociaux et par l’absence d’une réelle politique de développement social, culturel et urbain - on donne un peu à chacun pour éviter le pire.
Les associations sont alors placées devant le défi de la cooptation et du relais : ayant certes besoin de financements publics, elles n’entendent pas pour autant être de simples instruments au service de l’Etat ni des collectivités locales.
Une manière de résister à une pure et simple délégation de service public a été mise en oeuvre dans le domaine de la médiation sociale et culturelle pratiquée par des associations de femmes qui se sont développées dans les quartiers et dans les villes, notamment à l’initiative de femmes immigrées, en particulier africaines.
Naissance et essor de la médiation sociale et culturelle
L’impulsion donnée par les femmes africaines à ce type de médiation peut être expliquée par certaines caractéristiques de la migration africaine en France depuis la fin des années 70, tant par des aspects des cultures des peuples d’Afrique, que par la transformation des modes de vie et des pratiques sociales dans le changement de pays.
D’abord, l’importance de la famille. Les groupes familiaux ont un rôle économique (de production, en zone rurale, et de redistribution quelle que soit la localisation et la source des revenus), un râle de protection sociale (au sens d’assurance-maladie et d’assurance-vieillesse) à travers la solidarité constitutive et le dû des enfants envers les parents, et un rôle de régulation des conflits dans le cadre des conseils de famille où s’exerce de fait une médiation familiale. Dans le contexte migratoire, il peut y avoir une certaine déperdition de ces formes d’organisation sociale, mais elles restent néanmoins une référence de base pour la majorité des migrants et de leurs enfants, tandis que la médiation sort peu à peu du cadre familial.
Ensuite, le rôle des femmes. Au sein des groupes familiaux, les femmes ont une autonomie économique et financière, c’est-à-dire qu’elles peuvent posséder des biens en leur nom propre même si elles sont mariées, produire et commercialiser des biens, selon des modalités variables d’un endroit à l’autre en fonction des appartenances, du rang, du statut matrimonial, de l’âge... Dans les sociétés rurales, cette autonomie se manifeste par la possession et l’exploitation de terres cultivables et de têtes de bétail dans les régions d’élevage. En milieu urbain africain, s’agissant de ruraux récemment arrivés des villages, les femmes poursuivent éventuellement une activité agricole de type maraîchage urbain le plus souvent, et/ou ont des activités commerçantes au marché ou dans la rue : vente de produits alimentaires et de tissus... En milieu urbain français, la possibilité pour les femmes migrantes, de s’assurer un revenu par l’agriculture ou le commerce disparaît, tandis que l’absence de moyens financiers, de réseaux de relations et d’entraide, de maîtrise du français bien souvent, rend hypothétique l’accès à l’emploi autre que domestique. Il y a donc recul de l’autonomie dans le processus migratoire.
C’est à partir de la prise de conscience de la situation de ces femmes, faite à la fois de dépendance et d’isolement, que certaines de leurs compatriotes ont commencé à les accompagner dans les services sociaux, à l’école de leurs enfants... et à les initier aux codes culturels et administratifs en usage en France.
Avant d’être formalisée, cette pratique s’est développée parmi des femmes africaines qui ont créé des associations, notamment au Havre, à Cergy, à Evry, à Pantin, et dans d’autres quartiers d’habitat social, pour remédier à l’isolement et développer la solidarité de voisinage. Puis un réseau d’associations s’est formé : il regroupe des femmes d’origines très diverses et une formation à la médiation y a été inventée, expérimentée et affinée progressivement, tandis qu’un collectif national regroupant des médiatrices de plusieurs villes et régions a produit une Charte et un guide de la médiation sociale et culturelle.
Ce cadrage permet de distinguer la médiation sociale et culturelle de l’interprétariat et de la fonction de femme relais. L’interprétariat se borne à de la traduction d’une langue dans une autre, alors que les médiatrices tentent de faire se rapprocher des systèmes de pensée et de représentations, sans nécessairement posséder les deux langues des interlocuteurs en présence. Quant à l’appellation de femme relais, outre qu’elle enferme la femme dans une fonction à connotation subalterne (comme femme de ménage ou homme de peine), elle véhicule la notion de transmission d’un message, voire du droit, par des femmes qui sont le relais d’une institution à l’extérieur de cette institution ; elle inclut une dimension d’appartenance à un système, alors que les médiatrices en sont, ou souhaitent en être, partenaires (6).
L’intégration sociale par l’action solidaire
Les associations créées par des jeunes et celles créées par des femmes, le plus souvent d’origine étrangère, ont quatre caractéristiques communes.
Tout d’abord, elles se sont immergées dans l’action publique, avec la volonté d’en être des acteurs de plein exercice. Ensuite, étant confrontées aux institutions et aux services publics, elles ont su se mettre en position de traiter d’égal à égal avec leurs représentants. D’autre part, leur recrutement transcommunautaire et transnational les détache de toute revendication de type ethnique et les projette dans un champ social très ouvert. Enfin, leur orientation vers l’émancipation citoyenne précise leur mode d’occupation du champ social. Mais en même temps cette tension vers la citoyenneté trouve ses limites dans le droit (la qualité de citoyen est limitée aux nationaux) et dans une conception dominante de l’action publique à la fois centralisée, régalienne et se défaussant d’une partie de ses tâches sur les milieux associatifs, dans un système de délégation contrôlées sans véritable transfert de compétences.
Cette tendance, qui reflète l’émiettement de l’Etat providence, perturbe le schéma linéaire qui consacrerait l’avènement de l’individu au terme de la traversée de plusieurs sphères d’appartenance.
On peut en effet considérer, au sens anthropologique, que le mode associatif est transitoire entre un mode clanique et un mode sociétal. Le phénomène associatif fait un peu figure de rite de passage, ou pourrait-on dire de système véhiculaire entre des sociabilités héritées et des sociabilités aléatoires ou volontaristes. Dans ce schéma, on va d’un mode d’appartenance (familiale ou associative) à un autre mode de participation à la vie sociale, dans lequel l’identité se joue sur plusieurs registres et où l’engagement individuel, pour affirmer qu’il soit, n’est pas total - le "je" l’emporte sur le "nous", et la posture de militant fait place à celle de l’acteur. On passe ainsi, sous l’oeil bienveillant de l’Etat régulateur, d’un modèle communautaire à un modèle sociétaire dans lequel s’affirment simultanément la singularité de toute personne vivante et la commune humanité (préférable au terme d’universalité chargé de relents occidentalocentristes).
Lorsque l’Etat se démet de ses fonctions régulatrices pour les laisser au marché mondial, le puzzle qu’il tenait ensemble se défait. On assiste alors à des tentatives de faire revivre des solidarités à l’oeuvre avant le règne de l’Etat providence, dans des groupes d’obédience religieuse par exemple. Mais, dans une société cosmopolite, "babélisée", la religion n’échappe pas à la fragmentation et son expression renvoie à des affrontements de chapelles. Quels sont alors, les ressorts d’un raccommodage de la société ?
Sans répondre à la question (elle est trop complexe), les réflexions livrées dans ces quelques lignes conduisent à suggérer que les petites associations d’habitants dans les quartiers répondent, modestement, à ce défi. Ce sont des passeurs.
Se situant en effet en dehors de la défense d’un patrimoine, d’avantages acquis ou de statuts, elles sont plutôt dans l’accompagnement de processus de mobilité sociale, résidentielle culturelle (recherche d’emploi, de logement, soutien scolaire). Elles se placent sur des trajectoires de changement social, d’un état à un autre, d’un lieu à d’autres et elles introduisent ce mouvement dans des familles, dans des groupes, chez des personnes isolées, en leur donnant des éléments de compréhension du sens du passage. C’est de ce sens qu’elles sont porteuses, même s’il n’apparait pas constamment dans l’action quotidienne. Et elles le sont plus que tout groupe humanitaire ou professionnel, dans la mesure où c’est leur propre refus de la relégation ou du déni du droit qui les anime. Elles le sont surtout parce qu’elles ne sont pas enracinées, quel que soit leur attachement présent aux milieux, aux quartiers et aux villes dans lesquels elles agissent.
Sonia Fayman
1- Les contrats de ville font suite aux contrats de développement social des quartiers ; ils sont signés entre des communes ou des groupes de communes, l’Etat et des collectivités territoriales ; ils sont l’expression de ce qu’on appelle la politique de la ville.
2- Le terme a été employé par Jean Marie Delarue alors qu’il était délégué interministériel à la ville, dans son rapport sur la situation des quartiers : il décrivait ainsi l’état d’abandon physique des quartiers et le sentiment d’abandon de nombre de leurs habitants.
3- L’assignation à résidence désigne le processus par lequel des demandeurs de logement se retrouvent dans certains quartiers, voire certains immeubles au sein des quartiers, en fonction de leur origine (immigrée) ou de caractéristiques socio-démographiques particulières (familles monoparentales)
4- Développement social des quartiers, programme conduit à partir du début des années quatre vingt par la commission nationale pour le développement social des quartiers créée à l’instigation du Maire de Grenoble, Hubert Dubedout, après qu’il ait organisé les assises "Ensemble refaire la ville".
5- Les mouvements transcommunautaires du type « Stop la violence » ne sont pas en phase d’essor, c’est le moins qu’on puisse dire.
6- Cette différenciation est théorique, c’est à dire qu’elle renvoie à des concepts et, en l’occurrence à une signification qui échappe au sens commun ; certaines associations ont adopté le terme de femmes relais tout en se voulant aussi autonomes que les médiatrices ; cela n’empêche pas de réfléchir au sens profond des mots.