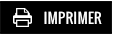La recherche urbaine française sur les pays en développement : rétrospective des années 90
Publié par Emile Le Bris , le 9 mars 2007.
La période faste correspondant en gros aux années 80 a autorisé une tentative de fédération d’un milieu de recherche riche mais disparate dans le champ urbain des pays en développement (PED). Une quantité considérable de résultats de recherches a été accumulée, dont l’exploitation à des fins proprement scientifiques ou opérationnelles est loin d’être achevée. Ces matériaux ont alimenté une remise en cause de l’hégémonie du modèle occidental, à la fois comme référent théorique et comme cadre opérationnel. Au plan structurel, force est cependant de reconnaître que le projet fédérateur a échoué. Non seulement le milieu français de recherche urbaine sur les PED est resté atomisé mais, de surcroît, il a vieilli et a été amputé de certaines composantes importantes. Un événement comme Habitat II en 1996 a-t-il autorisé la relance d’un projet collectif et favorisé le renouvellement des problématiques ?
Comment expliquer que la recherche urbaine sur les PED se trouve durablement rejetée, en France, aux marges de la politique scientifique nationale alors même que les institutions internationales font de la ville le pivot des politiques de développement et, plus récemment, des stratégies de lutte contre la pauvreté ? Sur la base de quels arguments problématiques et institutionnels ce processus de marginalisation peut-il s’interrompre ?
Atouts
Le dispositif français reste, à ce jour, plus diversifié et plus riche que celui des pays européens comparables. Chaque catégorie d’acteurs dispose en effet d’institutions spécialisées dans la coopération internationale. Ces institutions - au premier rang desquelles l’IRD (ex ORSTOM) - bénéficient souvent d’une grande ancienneté, même si le champ urbain n’a commencé à y être exploré de manière systématique qu’à partir du milieu des années 70. Cette ancienneté, si elle est cause de pesanteurs préjudiciables aux adaptations à de nouveau contextes, explique néanmoins la construction progressive d’un véritable « savoir chercher en coopération » et une production cumulée de résultats de recherche sur longue période (citons, entres autres thématiques, les dynamiques démographiques, les questions foncières et immobilières, les politiques et les pratiques urbaine). Par ailleurs, du fait de leur taille, les établissements publics de recherche permettent de constituer des masses critiques intéressantes (une soixantaine de chercheurs dans le département spécialisé de l’ORSTOM au milieu des années 80) et réunissent les conditions de mise en oeuvre d’une véritable pluridisciplinarité non circonscrite aux frontières des seules sciences sociales. Ce fut le cas, au sein du dispositif urbain de l’ORSTOM jusqu’au milieu des années 90, avec les tentatives d’articulation entre sciences sociales et sciences bio-médicales d’une part, sciences de la terre d’autre part sur le thème du « risque urbain ». Ces essais de rapprochement furent de courte durée. A l’origine de ces échecs on trouve certes la réticence des spécialistes de sciences sociales à rentrer dans la « boîte noire » du technique ou à se familiariser avec les démarches d’autres sciences mais, plus encore, la contrainte de l’évaluation qui enferme particulièrement les « sciences dures » dans la monodisciplinarité.
Non contraints, du fait de leur statut, de consacrer une part significative de leur temps à chasser les contrats et d’épouser le « prêt-à-penser » du moment, les chercheurs français courent, dit-on, le risque de s’amolir dans un confort stérilisant. Ils ont en revanche les moyens d’user, dans certains domaines sensibles, des indispensables libertés sans lesquelles il n’est pas d’investigation scientifique digne de ce nom. On pense ici aux avancées obtenues sur les logiques d’acteurs et et les pratiques urbaines réelles et, plus récemment, sur la pauvreté vs inégalités. La laborieuse constitution du réseau NAERUS entre 1996 et 1999 montre qu’il existe malheureusement un écart considérable entre savoir et faire-savoir et que, dans l’ensemble européen, les travaux innovants en français voyagent mal dans des pays où prévaut la langue anglaise et le poids écrasant de la doctrine des institutions financières internationales.
En raison de ces atouts, l’offre de recherche a été foisonnante et la production scientifique publiée souvent de grande qualité mais, pour diverses raisons, nulle impulsion depuis plus de vingt ans n’a eu raison de l’atomisation du dispositif français de recherche urbaine sur les PED. Les résistances sont imputables à la fois au manque de continuité des initiatives publiques et à un certain « tribalisme » des communautés scientifiques concernées.
Manque de continuité des pouvoirs publics
La contraction préoccupante des moyens, observée depuis la fin des années 80, peut être mesurée à un indice : au milieu des années 80, le dispositif de recherche urbaine de l’ORSTOM (60 chercheurs) bénéficiait d’une dotation annuelle de fonctionnement (hors salaires) de l’ordre de 4 millions de francs. Au milieu des années 90 le même dispositif bénéficiait d’une enveloppe nettement inférieure à 2 millions. La rupture unilatérale de la démarche incitative en 1993 (par annulation d’un appel d’offres sur la crise urbaine pourtant arbitré par le Ministère de la Recherche ) obligea certaines équipes pourtant dynamiques à se mettre en sommeil, faute de pouvoir compenser l’érosion des moyens budgétaires nationaux en recourant à des guichets multilatéraux. Les programmes-cadres de l’Union européenne, par exemple, réduisaient et continuent de réduire à la portion congrue les budgets dévolus au champ urbain en général.
A la contraction des ressources s’ajouta l’instabilité des supports institutionnels nationaux. L’ORSTOM - devenu depui peu l’IRD - n’a eu de cesse de déconstruire un affichage urbain pourtant reconnu par nos partenaires du Sud comme du Nord. Passée dans la seconde moitié des années 80 du statut de département à celui de simple unité de recherche, la recherche urbaine a perdu en visibilité. L’entreprise de mise en réseau des pôles les plus actifs à travers le groupement Interurba, initiée et largement soutenue par l’ORSTOM au début des années 90, a subi un brutal coup d’arrêt en 1996 pour des motifs de nature bureaucratique. Dans la période récente, les mythes académiques de l’excellence et de l’universalité de la science ont justifié le rejet de toute démarche pluridisciplinaire sur le développement et aggravé l’atomisation du dispositif dédié à la ville en micro-unités peu enclines à se fédérer. L’IRD risque fort de perdre définitivement, non seulement toute capacité fédératrice du potentiel national de recherche sur le sujet mais aussi sa qualité de référent par rapport à des partenaires du Sud et du Nord pourtant très demandeurs. Le réseau européen NAERUS, également constitué à l’initiative de l’ORSTOM dans le cadre de la préparation d’Habitat II, n’a ni les moyens logistiques d’un opérateur de recherche, ni la stabilité institutionnelle nécessaire pour prendre le relais. Il faut donc craindre que la France se trouve mise hors jeu dans une partie où elle occupe une place reconnue depuis deux décennies.
Le recroquevillement observé à l’ORSTOM n’a pas été un phénomène isolé. La suppression du Programme Solidarité Habitat (PSH) par les trois grandes tutelles (Affaires étrangères, Recherche, Equipement) signifiait la disparation d’un précieux forum de rencontre entre les autorités publiques, les chercheurs stricto sensu, les acteurs du monde associatif et de l’économie sociale et les collectivités locales. En pleine préparation d’Habitat II, s’est enfin jouée la disparition du Programme Interdisciplinaire de recherche sur les villes du CNRS.
Cette « désertification » du paysage institutionnel allait de pair avec une inquiétante marginalisation des questions de développement et un désintérêt confirmé pour les pays du Sud (en témoigne l’érosion préoccupante de l’aide publique française au développement depuis 1995). On évoquera ici les difficultés rencontrées par l’IEDES depuis une dizaine d’années mais, plus généralement, l’indice de cette marginalisation est la chute des agréments accordés aux formations doctorales spécialisées sur le développement. La réforme de la Coopération française, amorcée en 1998, aurait pu être l’occasion d’une remobilisation du milieu de recherche ; elle n’a fait qu’accélérer la perte de substance et de qualifications en matière de développement. En renvoyant aux filières multilatérales une part croissante de l’aide publique, la France s’est alignée purement et simplement sur la vision du « développement urbain durable » (compétitivité, habitabilité, bonne gouvernance, bancabilité) produite par la Banque mondiale. On comprend dès lors que, jusqu’à une date récente, la demande publique de recherche n’ait guère été stimulée. A quoi bon « chercher » puisqu’on pense déjà avoir trouvé aussi bien les cadres théoriques pertinents que les modes opératoires adéquats ?
Marginalisation
Tout se passe comme si la promotion du savoir-faire l’emportait sur celle du savoir. Il est significatif que l’un des moments fort des « entretiens de Taksim » organisés par la partie française à Istanbul en 1996 ait mis en avant les opérateurs privés, exportateurs du modèle de « gestion déléguée » des services urbains. Les premières versions du rapport national adressé par la France en vue de la session de l’Assemblée des Nations-Unies « Habitat II + 5 » (2001) poursuivent dans la même direction et passent complètement sous silence le rôle de la recherche urbaine française dans la coopération internationale au développement.
D’un autre côté, une partie significative de la coopération non-gouvernementale conteste de plus en plus aux chercheurs professionnels leur monopole du savoir scientifique. Encore timide dans le cadre du programme « Jeunes-ville-emploi » en 1992, cette contestation s’est pleinement manifestée quelques années plus tard dans la conception et l’exécution d’un programme du GRET et de ENDA sur l’exportation en Afrique du modèle de « développement social urbain ».
A l’occasion de la préparation française d’Habitat II, en 1995-96, certains crurent pouvoir diagnostiquer une intériorisation par le milieu des chercheurs professionnels de sa propre marginalisation. La ville étant appréhendée désormais dans le discours international comme analyseur du changement social global, il s’est produit un décrochage entre l’évolution de la pensée scientifique sur la ville et ce changement global. Certaines initiatives récentes, en particulier au sein du réseau NAERUS, s’efforcent de rétablir un accrochage amorcé par les chercheurs français dans le cadre de l’appel d’offres sur la crise urbaine en 1993. Insuffisamment perméable aux grands modèles de discours - national-identitaire et libéral-mondial - structurant le changement global, le milieu français de recherche urbaine est longtemps resté à l’écart d’une nouvelle forme d’expertise collective internationale sur des thèmes à forte connotation idéologique (la pauvreté) ou technique (l’environnement). Ces champs furent abandonnés, jusqu’à une date récente, à diverses modalités de « recherche-action » manifestant le plus souvent aussi peu de solidité théorique que de rigueur méthodologique.
A l’intérieur même de la sphère « académique », la marginalisation a emprunté d’autres voies. Sous prétexte de surmonter la coupure Nord-Sud, il est aujourd’hui de bon ton de banaliser la recherche urbaine sur les PED. A quoi peuvent bien servir des recherches mettant en scène la diversité citadine et la singularité de certains processus d’urbanisation en un temps où « la globalisation (...) conduit à des transferts des activités commerciales et productives d’un grand nombre de centres urbains traditionnels vers de grandes agglomérations et des villes qui peuvent démontrer un avantage sur le marché » (Banque mondiale, Strategy Paper, 1999) ? La thèse de la « ville globale » postule un universalisme du fait urbain et privilégie une mécanique descendante de prise de décision à partir des seuls modèles occidentaux. Dans un numéro récent de la revue Esprit (novembre 1999), il est montré comment la « sécession urbaine » dessine la « ville émergente », cette ville « à la carte » où l’on cherche à s’abstraire de toute confrontation à l’altérité en s’établissant entre soi dans la recherche d’une affinité sociale et culturelle » (M.C. Jaillet, in Esprit, 1999). Ce modèle nord-américain de dynamique urbaine serait devenu mondial et appellerait à un renouvellement des catégories fondatrices de la citoyenneté. Or, peut-on sérieusement assimiler le processus d’exurbanisation (urban sprawl) africain ou latino-américain à celui décrit en Amérique du Nord ? Les travaux menés au Sud ne semblent devoir trouver leur place dans cette « nouvelle sociologie urbaine » qu’à condition d’épouser le modèle.
Enfin, nombre de nos partenaires des PED nous renvoient sans ménagement l’image d’un dispositif de recherche qui tourne à vide alors que se fabrique « au Sud » quelque chose de radicalement nouveau dans le champ urbain.
Nouvelles interpellation du milieu de recherche
Sur les orientations thématiques
Le meilleur moyen de limiter l’ingérence du politique dans le choix des thèmatiques scientifiques, c’est bien de s’attacher à la construction d’un tiers-discours entre national-identitaire et libéral-mondial. Le modèle de la « ville émergente » déjà évoqué ne semble pas ouvrir une telle option tant, à certains égards, il épouse certains présupposés du discours libéral-mondial. Il convient donc de reformuler des objets de recherche pertinents à l’intérieur du triangle démocratie, espace public et marché.
Quelles nouvelles configurations spatiales, sociales et politiques induisent la libéralisation des échanges et le désordre du monde qui l’accompagne ? quelles sont, dans les Suds, les figures spécifiques de la métropolisation ? Les « corridors de modernisation » ont-ils pour effet de bouleverser les hiérarchies urbaines ? Les camps de réfugiés constituent-ils une nouvelle forme d’urbanisation ?
En fonction de quels référents théoriques apprécier l’altération de l’interface Etat / ville ? La décentralisation - hâtivement assimilée à la démocratisation - conduit à renvoyer vers les collectivités locales des compétences qu’elles ne sont pas en mesure d’assumer. Les territoires municipaux ou infra-municipaux sont-ils susceptibles de jouer le rôle intégrateur des intérêts particuliers et des politiques nationales ? Certains enjeux majeurs (en matière de fiscalité, d’accès aux contrats publics et d’affectation des grands investissements) se mesurent-ils à l’aune de l’intérêt public ou déclenchent-ils au contraire un renouveau des pratiques clientélistes et in fine l’aggravation d’une violence politique locale ?
Les bailleurs de fonds internationaux subordonnent le succès de la « lutte contre la pauvreté urbaine » à l’adoption d’une « bonne gouvernance », c’est à dire d’une forme strictement administrée ou, au mieux, d’une sorte de management contractuel. Une telle approche se caractérise par l’occultation du politique et par une référence incantatoire à la démocratie. L’examen attentif des modalités de construction d’un champ politique à l’échelle locale met au contraire en évidence l’intervention d’un nombre croissant d’acteurs dont les stratégies hétérogènes ont peu de chance de se combiner pour former un territoire. Plus qu’à des acteurs collectifs locaux évoluant dans un authentique espace public, on a affaire à des coalitions d’intérêts éphémères qui développent de nouvelles pratiques de négociation en chevauchant les sphères publique et privée, légale et illégale.
Sur les relations avec les opérateurs
La place marginale de la France dans les débats conceptuels concernant les villes à l’échelle internationale a pour corollaire notre faible capacité à peser sur la définition des champs et procédures de négociation. Le rapport sur le développement durable adressé par Laurence Tubiana au premier Ministre dresse un constat identique et impute cette place marginale « à la faible articulation entre la communauté des chercheurs et des experts, les décideurs publics et les acteurs privés ». Les initiatives foisonnantes mais morcelées de la coopération urbaine internationale de la France ont été le plus souvent prises au nom de stratégies renvoyant à l’arrière plan les logiques de connaissance : stratégies de l’humanitaire ou de l’urgence, stratégies relevant de la visibilité diplomatique et du retour sur investissement.
On peut cependant évoquer, au cours de la dernière décennie, un certain nombre d’initiatives allant dans le sens d’une meilleure articulation. L’opération « Jeunes-ville-emploi », lancée en 1992 par le ministère de la Coopération, s’assignait comme objectif principal de décloisonner une décision publique fondée sur des approches essentiellement sectorielles ; elle invitait aussi chercheurs, experts et acteurs associatifs à formuler des questions communes et à en tester la pertinence dans des opérations situées au plus près du terrain. La démarche sera reprise avec un relatif succès dans la seconde moitié des années 90 par le Programme Solidarité Eau (programme eau et assainissement dans les quartiers périphériques des grandes villes et les petits centres urbains, puis programme déchets et excrétas). L’AITEC (Association internationale des techniciens, experts et chercheurs) soutient de son côté depuis sa création un forum de confrontation entre acteurs s’intéressant à la ville tant en France qu’à l’échelle internationale. Il est significatif que toutes ces initiatives se soient heurtées à une difficulté récurrente : mobiliser les entreprises. Tout se passe comme si cet acteur, eût-il la ville comme champ d’intervention principal, ne manifestait ni vision du champ urbain, ni intérêt à développer une réflexion sur cet objet.
Sur les relations avec les partenaires du Sud
Notre coopération scientifique dans le champ urbain n’est pas assez à l’écoute de ce que souhaitent nos partenaires. Un ambitieux programme en sciences sociales vient toutefois d’être financé par le Ministère des affaires étrangères. L’exécution, mais aussi - et c’est plus nouveau - la conception, en ont été confiées en maîtrise d’oeuvre au Conseil africain pour le développement de la recherche en sciences sociales (CODESRIA) et à l’IRD. L’opération qui s’amorce - et dont un des volets concerne la ville - inaugure une modalité de partenariat radicalement nouvelle mettant en avant les principes de parité et d’autonomie. Face à la montée de la pauvreté et à l’aggravation des inégalités, aux tentatives de modernisation exogène, à la démocratisation octroyée d’en haut ou imposée à la base, l’intention affichée est bien d’établir - s’agissant il est vrai de la seule Afrique sub-saharienne - les termes d’une co-responsabilité Nord-Sud. A l’alignement pur et simple sur le « prêt-à-penser » du moment ou à l’enfermement dans des représentations datées, est préférée une démarche prenant en compte les mutations rapides que les sociétés africaines ont connues au cours du dernier demi-siècle. L’appel à proprositions de recherche lancé en 2000 privilégie en particulier les nouvelles représentations de la ville et de la société urbaine, ainsi que les nouveaux modèles opérationnels qu’elles suscitent.
Le partenariat scientifique avec le Sud ne peut plus être fondé sur une relation inégale et univoque. Des initiatives Sud-Sud voient le jour dans le champ qui nous intéresse et notre coopération scientifique devra, dans l’avenir, y puiser les arguments de son renouvellement. C’est ainsi que le séminaire tenu en 1999 par le CODESRIA et la FLACSO (Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales) ouvre la voie à de nouvelles investigations sur le thème « globalisation et développement local ». Deux axes clés ont été identifiés pour la poursuite de l’exercice comparatif : c’est d’une part la question des citoyennetés et, d’autre part, la redéfinition des territorialités dans un contexte de remise en cause générale de la territorialité nationale.
La recherche urbaine française sur les pays du Sud se trouve donc, avec ses atouts et ses faiblesses, confrontée à un double défi. Le premier est intellectuel et consiste dans la réaffirmation d’une liberté de penser la ville dans des configurations singulières et non réductibles à des modèles à prétention universelle. Cette liberté est assortie - et c’est bien ce qui fonde la professionnalité du métier de chercheur - d’une obligation de démontrer. Il faut donc disposer de tous les moyens nécessaires pour « documenter » les nouvelles hypothèses échafaudées avec nos partenaires du Sud. Le second défi est d’ordre institutionnel et les chercheurs ne disposent pas de toutes les clés pour le relever. On a assisté dans la seconde moitié des années 90 à des relances ponctuelles du débat sans allocation significative de moyens ni consolidation institutionnelle des acquis : Si le Comité National de Coordination de la recherche en coopération (CNC) a, il y a cinq ans, formulé des analyses et des propositions intéressantes en vue de relancer la recherche urbaine, l’écho rencontré dans les ministères concernés a été à peu près nul. La « semaine des villes du Sud » organisée à la même époque dans le cadre de la préparation d’Habitat II a eu comme effet presque immédiat la liquidation d’Interurba par les institutions parties prenantes. La mission confiée récemment au GEMDEV par le Ministère des Affaires étrangères a comme effets bénéfiques une relance de la réflexion et, vraisemblablement, une allocation significative de moyens incitatifs. Cette relance est malheureusement limitée aux pays de la Zone de solidarité prioritaire et il est à craindre que le donneur d’ordre agisse en l’occurence sans perspective de consolidation structurelle d’un milieu de recherche pour le moins sinistré.