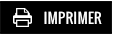Quand le fondateur du "libéralisme scientifique" défend les "services publics"
Publié par , le 13 mars 2007.
Note : Toutes les phrases en italiques de ce résumé sont des citations de L. Walras.
Six points :
– Le libéralisme scientifique.
– Les grandes exceptions au principe de libre concurrence : les services publics.
– Exception n° 1 : les monopoles moraux ou les services publics stricto sensu.
– Exception n° 2 : les monopoles économiques incluant les services publics lato sensu.
– Une logique planificatrice.
– Un réquisitoire contre la gestion privée des services publics.
Parmi les grands noms de la science économique, Léon Walras est unanimement considéré comme le principal fondateur de la pensée économique dominante qu’on appelle dans la discipline la pensée néo-classique et dans le grand public la pensée économique libérale. Or si l’économie politique pure walrasienne tend à accréditer cette qualité, son économie politique appliquée ne laisse pas de surprendre au regard de cette même qualité. En d’autres termes là où Walras se propose d’étudier l’économie concrète, il se révèle somme toute assez peu libéral pour apparaître au contraire comme un théoricien de l’intervention de l’État. Ce dernier point est examiné à travers l’étude des services publics.
En son XIX e siècle très scientiste, Walras se considère à l’évidence comme le père du libéralisme scientifique car « l’emploi du langage et de la méthode mathématiques [lui] a permis d’asseoir le principe de la libre concurrence ».
En l’occurrence les deux méthodes de résolution des problèmes de l’échange ou de la production (la méthode rationnelle qui est la résolution mathématique d’un système d’équations adéquat et la méthode expérimentale qui n’est autre que le fameux tâtonnement walrasien assimilé au mécanisme de la libre concurrence) conduisant au même résultat, il en résulte par là même que le principe de la libre concurrence est scientifiquement validé. Ce faisant Walras espère avoir ruiné du même coup la doctrine socialiste de l’intervention de l’État.
Toutefois en son économie politique appliquée qu’il distingue de son économie politique pure, Walras envisage au moins deux grandes exceptions au principe de libre concurrence : les monopoles moraux ou services publics stricto sensu (sécurité, justice, éducation...) et les monopoles économiques dont une sous-catégorie, les monopoles naturels et nécessaires, définit les services publics lato sensu (communications, distribution d’eau ou de gaz, mines...).
Les monopoles moraux désignent la production des produits et services d’intérêt public dont les besoins, qui intéressent les hommes comme membres de la communauté, ne sont bien ressentis que par l’État. Et comme il n’y aura généralement pour ces biens et services « qu’un seul consommateur-demandeur, l’État », il n’y aura donc qu’un seul offreur, l’État, et
« [non] point des producteurs-offreurs, chacun d’eux devant se dire que ce qu’il ne vendrait pas à l’État, il ne le vendrait à personne ».
A contrario, la production des produits et services d’intérêt privé, dont les besoins sont ressentis par les individus, relève de la libre concurrence car à la foule de consommateurs-demandeurs répond la foule de producteurs-offreurs assurés de vendre à l’un ce qu’ils ne vendront pas à l’autre.
Mais parmi les produits et services d’intérêt privé, Walras va admettre une deuxième entorse au principe de libre concurrence concernant « les produits ou services d’intérêt privé non susceptibles de concurrence indéfinie » qui doivent être produits en monopole par l’État. Si la première exception posait le problème de la non-multiplicité des demandeurs-consommateurs, cette deuxième pose le problème de la non-multiplicité des offreurs-entrepreneurs. Or Walras attache la plus grande importance à la multiplicité des entrepreneurs, car elle est une condition du mécanisme de libre concurrence comme moyen permettant l’obtention de l’équilibre de la production dont la caractéristique essentielle est l’égalité du prix de vente des produits et de leur prix de revient en services producteurs.
Dans une telle situation, la production revient tout naturellement à l’initiative individuelle. A contrario la non-multiplicité des entrepreneurs ne permet plus d’obtenir l’égalité du prix de vente et du prix de revient. On a alors (ou on tend vers) une situation de monopole caractérisée par un excédent du prix de vente sur le prix de revient. Et « c’est pour éviter cette prélibation onéreuse [du monopole] qu’il y a lieu, dans certains cas, de ne plus « laisser faire », mais, au contraire de faire intervenir l’État ». En d’autres termes, le modèle de l’entrepreneur walrasien en équilibre concurrentiel, c’est-à-dire l’entrepreneur pur intermédiaire, l’entrepreneur sans bénéfice ni perte, ce modèle doit manifestement prévaloir en toute situation. Et si le monopole survient et remet en cause ce modèle, l’État doit immédiatement intervenir pour restaurer ce modèle dans le cadre même du monopole. L’intervention de l’État n’a donc pas d’autre but que de faire fonctionner les monopoles selon la norme concurrentielle. Tels sont les monopoles économiques de Léon Walras.
Ce phénomène des monopoles économiques pose problème au libéralisme walrasien. Car si Walras réinjecte la norme concurrentielle (égalité prix de vente-prix de revient) dans le cadre du monopole devenu monopole public, si, de ce fait, son interventionnisme étatique reste un interventionnisme de concurrence, le prix à payer est extrêmement lourd : pour sauver la règle concurrentielle, Walras fait disparaître la liberté de l’industrie. Une renaissance contre une mort, rien de moins. Sinon c’est le maintien à tout prix de la liberté d’entreprendre et la disparition de la norme concurrentielle au sein du monopole privé. Alternative douloureuse pour un penseur libéral car d’un côté comme de l’autre il doit s’amputer d’une partie de ses principes.
Les monopoles économiques se subdivisent en deux catégories, non exclusives l’une de l’autre d’ailleurs, soit d’une part les industries à frais généraux fixes considérables qui se situent « en dehors du principe de la libre concurrence, par la raison que cette libre concurrence ne pourrait s’y exercer que moyennant des frais multipliés de premier établissement tout à fait inutiles en eux-mêmes » et d’autre part les monopoles naturels et nécessaires qui désignent les services publics lato sensu, en dehors du principe de la libre concurrence eux aussi, et dont la logique de fonctionnement s’avère être une logique planificatrice.
Lorsque Walras étudie les activités faisant l’objet d’un monopole naturel et nécessaire, notamment le chemin de fer, il le fait en pensant effectivement leur existence et leur développement en termes de « planification ». Pour preuves :
– la volonté d’éliminer l’anarchie que créerait le système de la libre concurrence dans l’ouverture et l’exploitation de lignes de chemin de fer, de voies routières, de conduites de distribution d’eau ou de gaz, etc.,
(« La concurrence ne peut autoriser un nombre indéfini d’entrepreneurs à enfouir des tuyaux dans les rues. Le monopole est inévitable »),
– la volonté d’éliminer le gaspillage économique engendré par la multiplication de frais de premier établissement en cas de concurrence entre plusieurs entreprises
(« une seule conduite peut suffire à desservir toute une population d’eau ou de gaz aussi bien que dix conduites »),
– la caractérisation de ces activités comme autant de « réseaux d’ensemble » dont la gestion serait programmée de telle sorte qu’on se donne la faculté d’anticiper l’avenir dans la politique présente en réalisant, une fois n’est pas coutume, des bénéfices volontaires actuels sur l’exploitation des premiers maillons pour investir dans les derniers maillons et permettre ainsi un achèvement plus rapide du réseau,
– la valorisation de la « marche rationnelle dans le système d’intervention de l’État » opposée à « la précipitation irréfléchie de l’initiative individuelle ».
Bref autant d’éléments tendant à prouver la supériorité du Plan sur le marché.
Enfin, dernier test auquel se livre Walras, celui du comportement des hommes dans la gestion comparée (publique ou privée) des services publics. Walras connaît et énumère les griefs traditionnels à l’encontre de toute gestion étatique. Quelle ne sera pas la surprise du lecteur de voir Walras retourner contre la gestion privée les griefs évoqués avant de se livrer à une charge rarement égalée contre les dirigeants des compagnies privées :
« à qui espère-t-on faire croire que les compagnies privilégiées de chemins de fer soient un type d’activité et d’intelligence et non de « mauvais petits États », comme les appelait Dupuit dans l’intimité ? A qui persuadera-t-on que le népotisme et le favoritisme y sont inconnus ? Qui ne sait combien l’esprit d’administration et d’exploitation y est médiocre et mesquin ? Mal payer leurs employés, traiter le public en matière exploitable, s’en tenir aux plus hauts tarifs ; bref, écumer avec lésinerie et nonchalance un fructueux monopole, voilà ce qu’elles font ».
La boucle est bouclée pourrait-on dire. Qu’il s’agisse de théorie ou qu’il s’agisse du comportement des hommes, il n’y a point d’échappatoire vers la privatisation des services publics dans le système de Walras.