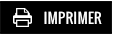La lÃĐgende libÃĐrale ou une gÃĐnÃĐalogie du capitalisme - François FOURQUET
PubliÃĐ par , le 14 mars 2007.
Ce texte met l’accent sur la nÃĐcessitÃĐ d’une vision de longue durÃĐe. En effet, la lÃĐgende libÃĐrale (c’est-à -dire le mythe des origines, forgÃĐ par les ÃĐconomistes classiques) fait naÃŪtre le marchÃĐ comme institution autonome à partir du XVIÃĻme siÃĻcle. Or, si l’on veut comprendre les relations entre Ãtat et marchÃĐ, la place des services publics…, il faut remonter au haut Moyen-à ?ge oÃđ les jeux sont faits. Du dÃĐsastre rÃĐsultant de l’ÃĐcroulement de l’Empire romain, naissent les institutions caractÃĐristiques de la modernitÃĐ :
â les Ãtats-nation modernes, avec les rois « empereurs en leur royaume »
â la laÃŊcitÃĐ, rÃĐsultat d’une dÃĐfaite mÃĐmorable de l’Ãglise face aux rois,
â les citÃĐs-Ãtat souveraines, les villes de l’intÃĐrieur munies de libertÃĐs,
â la propriÃĐtÃĐ privÃĐe, ÃĐchappÃĐe par miracle à l’aviditÃĐ de l’autoritÃĐ politique et mÃĻre du Capital, un concept ÃĐconomique d’origine politique,
â les dynasties marchandes porteuses du Capitalisme, un fait social total et d’emblÃĐe mondial,
â Le service public, hÃĐritier lointain de l’Ãglise, envers bienveillant de la puissance publique et source du droit public.
Toutes ces consÃĐquences sont liÃĐes en un Tout ; c’est l’ordre social inventÃĐ par l’Europe, fruit des compromis entre des forces sociales (bourgeoisie, propriÃĐtaires fonciers, classe administrative, classe ouvriÃĻre, etc…) ordre complexe et toujours remis en question.
THEMES DEBATTUS
â Est-ce que toute richesse privÃĐe n’est que dÃĐlÃĐgation (temporaire) de la puissance publique ?
â La richesse privÃĐe et la richesse publique sont-elles de mÊme nature ? Si oui comment traiter la question des externalitÃĐs ?
â Entre le dÃĐbut du moyen-ÃĒge et le passage au capitalisme, est-il possible de distinguer trois modes d’exploitation diffÃĐrents ; l’esclavage, le servage, le salariat ? En ne s’intÃĐressant qu’au captage de la richesse, le texte ne fait-il pas l’impasse sur sa production ?
â Quelle dÃĐfinition retenir de la valeur ? le texte ÃĐvoque celle de Saint Thomas d’Aquin : la valeur n’existe pas en dehors d’une estimation par la communautÃĐ entiÃĻre. N’y a-t-il pas d’autres approches de la valeur sociale ?
â La construction de l’Union EuropÃĐenne n’est-elle que la reconstitution du Saint Empire Romain Germanique ?
â Le service public qui a pris son essor à la fin du 19° siÃĻcle n’est-il qu’un prolongement des fonctions de l’Ãglise ? Plus gÃĐnÃĐralement comment articuler la nÃĐcessitÃĐ de l’ÃĐtude de l’Histoire longue avec la connaissance de la moyenne et courte pÃĐriode, ainsi qu’avec l’analyse des spÃĐcificitÃĐs nationales ?
(Cette liste de questions a ÃĐtÃĐ ÃĐtablie sans que soit parvenue la retranscription du dÃĐbat, il ne s’agit donc que d’une ÃĐbauche)
Intervention de François FOURQUET, UniversitÃĐ Paris VIII - Saint Denis