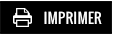Dette du tiers monde et financement du développement, un état des lieux - 1996
Publié par , le 14 mars 1996.
Par l’Aitec, in Revue Pôle, juillet-septembre 1996, pp. 65-71
Que ce soit vis-à-vis des problèmes du chômage, de la redistribution ou la dette, chaque fois qu’une conférence internationale, particulièrement celle des sept pays les plus riches, se tient, il y a des contre propositions qui émergent, portées par la résistance aux conséquences négatives, souvent inacceptables, de la mondialisation du modèle de transition.
Depuis quinze ans, les objectifs poursuivis pour le traitement de la dette, libéralisation des échanges, maîtrise du crédit, dévaluation n’ont pas permis la croissance, l’emploi ou même l’épargne nécessaire au remboursement. La priorité au remboursement de la dette à des taux d’intérêt prohibitifs pour les plus pauvres et injustifiés pour les autres, au détriment de l’investissement, a abouti à une impasse.
DES FLUX DE CAPITAUX PRIVÉS CONSIDÉRABLES MAIS TR� ?S CONCENTRÉS
La Banque mondiale insiste sur le rôle des flux privés, qui constituent 72% des flux totaux (« Aggregate net resource flows ») (1). Ces flux sont concentrés sur un petit nombre de pays. Douze pays, dont deux à faibles revenus, (Inde et Chine), ont absorbé 80% des flux privés depuis 1990 : Chine, Mexique, Brésil, Corée, Malaisie, Argentine, Thaïlande, Russie, Inde, Turquie, Hongrie, Pologne. La Banque mondiale distingue, parmi ces flux privés, les prêts des banques commerciales, les émissions de titres (« bonds ») sur le marché et les investissements directs d’entreprises étrangères ou « investissements de portefeuille ». Le développement de ce dernier type de ressource résulte de l’intérêt des investisseurs institutionnels vers les « marchés émergents » (c’est à dire les pays du tiers monde considérés comme prometteurs), en raison de la faiblesse des taux d’intérêt et de la faiblesse de la croissance dans les pays développés, face à une forte croissance dans certains pays du tiers monde, particulièrement en Asie, dans un contexte général de mondialisation de la production et de libéralisation des échanges et des mouvements de capitaux. Les flux de capitaux privés ont connu des augmentations considérables (en moyenne de 50% par an) de 1990 à 1993. Ils continuent à croître, mais à un rythme plus modeste : 3% en 1994 et 5% en 1995.
Les prêts des banques commerciales, au centre de la crise de la dette de 1982, semblent aujourd’hui marginaux en termes de flux. Les flux nets, après avoir été négatifs (4,9 milliards de dollars) en 1993, ont atteint 9,2 milliards de dollars en 1994 et 17,1 milliards de dollars en 1995, montant modeste par rapport à un total de flux privés de 167,1 milliards de dollars. La Banque mondiale souligne que les nouveaux engagements se sont concentrés sur des emprunteurs « de haute qualité ». L’encours, qui s’est sensiblement réduit depuis un pic de 360 milliards de dollars en 1987, est aujourd’hui de l’ordre de 200 milliards de dollars.
La dette du tiers monde n’est plus considérée comme un problème par les dirigeants des pays industrialisés, non pas parce que le fardeau de la dette n’écraserait plus les pays pauvres, mais parce que la dette ne fait plus peur aux banques, qui ont opéré, avec l’aide de leurs gouvernements et des institutions de Bretton Woods, un désengagement massif, qui n’est pas remis en cause par le rebond timide et sélectif des dernières années. L’année 1995 a été marquée par la poursuite de la croissance des investissements directs, qui ont atteint le montant record de 90 milliards de dollars (38% du total mondial), dont 54 milliards de dollars pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, et 38 milliards de dollars pour la Chine.
Cette croissance des investissements directs contraste avec le déclin des investissements de portefeuille, de 84 milliards de dollars, en 1993, à 67 milliards de dollars en 1994, et 56 milliards de dollars en 1995. Ce déclin est attribué à l’augmentation des taux d’intérêts aux Etats Unis, en février 1994, à la crise mexicaine de fin 1994, aux performances boursières nord-américaines en 1995 et à quelques pré occupations quant à une surchauffe des économies asiatiques fin 1995.
Une nette différenciation entre l’Asie et l’Amérique latine est apparue en 1995, à la suite de la crise mexicaine, qui a constitué un événement majeur de la fin de l’année 1994 et de l’année 1995, en matière de financement du développement.
L’Asie orientale concentre maintenant 59% des flux de capitaux privés, au détriment de l’Amérique latine, qui passe de 38% en 1993 à seulement 20% en 1995. L’Asie orientale bénéficie de conditions nettement plus favorables en termes de taux et de durée (ainsi, une durée moyenne de 11,7 ans contre 3,7 ans). La Chine conserve une place prédominante dans les apports de capitaux privés et recueille 45 milliards de dollars de flux nets, sur un total de 98 milliards de dollars pour l’Asie orientale et un total général de 167 milliards de dollars. ^ L’Afrique n’est pratiquement pas concernée par les flux privés, qui ne dépassent pas deux milliards de dollars par an, principalement en direction du pétrole et des produits miniers.
LA CRISE MEXICAINE
Le Mexique avait été à l’origine de la crise de la dette d’août 1982. L’opération de titrisation de la dette mexicaine, en février 1988, avait constitué le prototype d’actions de plus grande ampleur, dans le cadre du plan Brady. Un accord massif de restructuration, portant sur 48 milliards de dollars, avait ainsi été conclu en mars 1990. Alors que la Banque mondiale et le FMI se réjouissaient du « retour à la confiance », que marquait la reprise de flux privés positifs vers l’Amérique latine, certains observateurs s’interrogeaient sur la pérennité de ce mouvement : les entrées de capitaux n’avaient-elles pas un caractère conjoncturel, lié à la mise en oeuvre de programmes de privatisation ?
N’allaient-elles pas avoir pour contrepartie des paiements massifs d’intérêts et des rapatriements de dividendes ? Des désinvestissements n’étaient-ils pas à craindre si la conjoncture se détériorait ou si, tout simplement, la confiance faiblissait. L’économie mexicaine restait instable, excessivement dépendante des ressources pétrolières, marquée par un déséquilibre structurel de la balance courante des paiements et par un poids considérable de l’endettement à court terme. Les tensions sociales et politiques, dans lesquelles les rigueurs de l’ajustement ont certainement joué leur rôle, ont contribué à la défiance des « marchés ».
Sans prétendre entrer dans le détail des origines de la crise, une dévaluation de 15% du peso en décembre 1994, considérée comme insuffisante par les « marchés », a provoqué un mouvement de repli au Mexique, puis des effets de contagion, immédiats, en Argentine et au Brésil, étendus à l’ensemble des « marchés émergents ».
Une aide exceptionnelle, tant par son montant que par ses délais de mise en oeuvre, a été accordée au Mexique en réponse à cette crise, au début de 1995 : 50 milliards de dollars, dont 20 milliards de dollars des Etats-Unis, 18 milliards de dollars du FMI, 10 milliards de dollars de la banque des règlements internationaux et, plus modestement, 3 milliards de dollars de banques commerciales.
Des apports nets de 11 milliards de dollars sur l’année 1995 ont permis au Mexique de passer en tête des pays endettés, devant le Brésil, avec un encours de plus de 150 milliards de dollars.
Un certain retour à la confiance est apparu sur les « marchés émergents » à partir du deuxième trimestre de 1995, mais plus sélectif et surtout orienté vers l’Asie, et on a assisté à une chute d’un tiers des flux privés vers l’Amérique latine et à une reprise de la fuite des capitaux latino-américains.
Les leçons de la crise mexicaine ont été tirées de manières diverses. Les épargnants nord-américains y gagneront en prudence. Le FMI et la Banque mondiale n’ont pas manqué de donner au Mexique quelques leçons rétrospectives de bonne gestion macroéconomique (sur le poids des dettes à court terme, le taux des dévaluations et le montant souhaitable des réserves monétaires, par exemple).
Il n’est pourtant pas certain que ces leçons soient utiles. Le système financier international est caractérisé par la volatilité d’énormes masses de capitaux spéculatifs, que les États et la communauté internationale sont peu armés pour réguler, sauf à rompre avec les dogmes du libéralisme dominant, problème qui est tout autant celui de la France dans l’Europe de Maastricht, que celui du Mexique.
UNE DETTE QUI CONTINUE A CRO� ?TRE
L’encours de la dette a continué à croître à un rythme soutenu : de 8% en 1994, puis en 1995. Elle dépasse maintenant 2000 milliards de dollars (2068 milliards de dollars selon la Banque mondiale). Le ratio dette/exportations s’est légèrement amélioré, passant de 163 % à 150%, mais masque des disparités très importantes entre les régions et les pays.
Les principaux pays endettés sont le Brésil, avec 151 milliards de dollars fin 1994, et le Mexique, avec 128 milliards de dollars fin 1994, et plus de 150 mil liards de dollars aujourd’hui. La Chine atteignait 100 milliards de dollars fin 1994 et la Russie s’en approchait. La Russie pose d’ailleurs de difficiles problèmes à la communauté inter nationale, tant comme débiteur que comme créancier. Pays fortement endetté et a l’évolution incertaine, elle est également un des premiers créanciers du tiers monde. A la suite de l’accord d’avril 1993, dit de l’« option zéro », la Russie assume l’ensemble des créances et des dettes de l’Union soviétique Elle estimait ses créances sur le tiers monde à 173 milliards de dollars fin 1993 ce qui constituerait un quart de la dette extérieure des pays pauvres lourdement endettés (« heavily indebted poor countries »), si l’on accepte cette évaluation Celle ci est cependant contestée par l’ensemble des débiteurs, en particulier en matière de taux de change du rouble.
La situation de la dette latino-américaine, d’un montant total estimé à 607 milliards de dollars, reste préoccupante. Le ratio dette/exportations reste élevé a 254%. Il atteint le record de 2500% au Nicaragua.
La dette de l’Afrique subsaharienne reste le sujet de préoccupation majeur malgré son montant relativement modeste, de 223 milliards de dollars fin 1995. Le Nigeria concentre 15% de la dette de l’Afrique subsaharienne. Le ratio dette/exportations continue à augmenter en Afrique subsaharienne et atteint 270% (mais 389% sans l’Afrique du Sud). La dette de l’Afrique subsaharienne est caractérisée par le poids des dettes multilatérales (FMI, Banque mondiale, Banque africaine de développement), qui constituent 35% de l’encours La dette de l’Asie orientale s’accroît à un rythme très rapide (12% en 1995 et 24% pour la Malaisie...), mais elle ne préoccupe aucunement les institutions internationales, en raison de la croissance rapide de la production et des exportations de la plupart des pays concernés.
LE TRAITEMENT DE LA DETTE BILATÉRALE DES PAYS LES PLUS PAUVRES : LES CONDITIONS DE NAPLES
Le traitement de la dette publique dans le cadre du Club de Paris a été assorti de conditions concessionnelles à partir de mi 1987, date à laquelle on a reconnu que les pays concernés souffraient d’insolvabilité structurelle et non de difficultés de trésorerie temporaires. Les conditions de rééchelonnement ont été progressivement améliorées. Après les conditions de Toronto, puis les conditions de Londres ou conditions de Toronto renforcées, une nouvelle étape a été franchie avec les conditions de Naples, ainsi dénommées parce qu’elles font suite a la réunion du G7 à Naples, en juin 1994.
Dix huit accords de restructuration de la dette ont été conclus en 1995 dont 13 en application des conditions de Naples. Celles-ci prévoient deux options : traitement de l’encours ou traitement du service de la dette. Le traitement de l’encours n’est cependant applicable qu’après une période probatoire de trois ans en matière de respect des accords avec le FMI, et en interdisant tout nouveau rééchelonnement. Il n’a été appliqué qu’à l’Ouganda (février 1995) et à la Bolivie (mars 1995, revu en décembre 1995). L’option de traitement du service de la dette a été appliquée à dix pays : Guinée, Cambodge, Guinée Bissau, Togo, Tchad Nicaragua, Sénégal, Haïti, Mauritanie et Cameroun. Les conditions de Naples prévoient une réduction de 67% de la valeur actualisée des montants consolidés. Il faut se garder de croire qu’elles réduisent la dette de 67% puisqu’elles ne s’appliquent qu’à la fraction de la dette envers les pays du Club de Paris qui est « consolidée », excluant les dettes contractées après la date butoir (« cut-off date ») et traitant au cas par cas les arriérés et les dettes déjà consolidées.
Cinq accords ont par ailleurs été conclus pour des pays à revenus moyens : Algérie (pour 6,4 milliards de dollars), Croatie, Gabon, Macédoine et Russie (pour 7,3 milliards de dollars). Au-delà de la constatation d’une amélioration des conditions, il convient, pour apprécier si ces mesures sont suffisantes, de poser la question de leur impact sur l’encours et sur le service de la dette totale.
Le FMI a réalisé une analyse de la capacité à faire face au service de la dette (« extemal debt substainability ») des pays pauvres lourdement endettés (« / leavily indebted poor countries »). Il s’agit de 40 pays (2) : 31 pays à faibles revenus, lourdement endettés, 7 pays ayant bénéficié de rééchelonnements à des conditions concessionnelles, l’Angola et le Congo ; parmi ces pays, 33 appartiennent à l’Afrique subsaharienne. Selon cette analyse, l’application des termes de Naples, selon l’option de traitement de l’encours, assurerait cette capacité, sous réserve de l’impact de l’ajustement sur l’accroissement des recettes d’exportation, d’un traitement comparable par les autres créanciers bilatéraux (ne faisant pas partie du Club de Paris) et privés (non multilatéraux...) et de la poursuite d’apports de ressources concessionnelles. Malgré cette accumulation d’hypothèses optimistes, les termes de Naples resteraient insuffisants pour trois ou quatre pays à faibles revenus (Mozambique, Nicaragua, Zambie et éventuellement Sierra Leone).
La Banque mondiale semble avoir une analyse moins restrictive, ou plus réaliste, de l’impact de l’application des conditions de Naples, et considère qu’il existe peu de perspectives de sortie du processus de rééchelonnement pour la plupart des pays à faibles revenus.
Le fait que certains pays ne sont pas éligibles aux conditions de Naples, qu’ils ne peuvent passer en Club de Paris du fait d’arriérés envers le FMI ou la Banque mondiale, les délais d’application du traitement de l’encours (période probatoire) face à l’urgence de la situation, les incertitudes sur les apports futurs de ressources concessionnelles sont autant d’éléments qui militent en faveur de nouvelles initiatives plus radicales pour les pays pauvres lourdement endettés.
LE POIDS DE LA DETTE MULTILATÉRALE ET LA « MULTILATERAL DEBT FACILITY »
II est maintenant reconnu que l’une des limites du traitement de la dette publique provient de l’exclusion des dettes multilatérales, considérées jusqu’à présent comme intangibles. On a vu que celles-ci constituaient une part importante de la dette des pays d’Afrique subsaharienne et de quelques autres pays pauvres, dont la situation continue à s’aggraver. De nouvelles initiatives sont en cours de discussion à ce sujet. Un projet de facilité de la dette multilatérale (« Multilatéral Debt Facility) a été rendu public en septembre 1995, et pourrait concerner vingt pays. Le rapport de la Banque mondiale indiquait que de nouveaux développements étaient attendus de la réunion du 23 avril 1996 du Comité de développe ment, et donneraient lieu à un supplément aux « tableaux de la dette mondiale ». Il semble cependant que les résultats aient été décevants. Le FMI préférerait prolonger la facilité d’ajustement structurel renforcé (FASR) et en améliorer les conditions (par exemple en étendant la durée des prêts), ce qui ne réduirait pas la dette multilatérale. Un cadre d’action (« Framework for action ») aurait cependant été préparé conjointement par le FMI et la Banque mondiale, mal gré leurs divergences initiales, et mentionnerait un accord sur quelques principes généraux, mais aussi la nécessité d’approfondissements, avec l’objectif de parvenir à une décision lors de la prochaine assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, en septembre 1996.
Le problème de ressources semble être le point essentiel. Le FMI et la Banque mondiale souhaitent associer des contributeurs bilatéraux, mais l’on sait que ceci risque de poser de sérieux problèmes dans la conjoncture de restrictions budgétaires actuelle, alors qu’une part importante des crédits d’ajuste ment structurel français a servi depuis plusieurs années, avant la dévaluation du franc CFA, à refinancer des échéances du FMI ou de la Banque mondiale. Tout en approuvant l’idée d’un traitement de la dette multilatérale, on doit rappeler que l’émergence de la question à la Banque mondiale est probable ment liée au fait que de multiples crédits d’ajustement structurel arrivent main tenant en période de remboursement, sans que l’économie des pays ayant bénéficié de cet ajustement ait été améliorée. Ce qui devrait poser la question de l’évaluation des politiques d’ajustement structurel.
LA RÉGRESSION DE L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT
Le rapport de la Banque mondiale souligne la stagnation des flux officiels, en baisse en 1992, 1993 et 1994. Leur croissance en 1995 (de 48,6 à 64,2 milliards de dollars) est liée à l’effort exceptionnel consenti au Mexique. Parmi ces crédits publics, les concours concessionnels constituant l’aide publique au développement stagnent en montants : 47,4 milliards de dollars en 1994, 47 milliards de dollars en 1995, ce qui constitue une baisse en termes réels, en 1995, du fait de l’inflation, survenant après une baisse en termes réels de 6% en 1994. L’aide publique au développement n’est que de 0,29% du PIB des pays de l’OCDE en 1994, soit le niveau le plus faible depuis 1973. La place de la France y reste honorable : au troisième rang en montant total, après le Japon et les Etats-Unis en 1994, et seulement derrière la Norvège, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, en pourcentage du PIB, où l’on constate le niveau particulièrement faible des Etats-Unis.
La part des opérations d’urgence et de maintien de la paix, dans des pays tels que Haïti, le Rwanda, la Somalie, la Bosnie, de l’ordre de 6 milliards de dollars (8% de l’aide bilatérale en 1993,3% en moyenne avant 1990), réduit par ailleurs les montants consacrés aux opérations de développement à long terme. Les contraintes budgétaires, qui se poursuivront et s’accentueront probablement, risquent de réduire encore l’aide publique au développement. L’annonce d’une forte baisse des crédits du ministère des Affaires étrangères (et donc du ministère délégué à la Coopération, qui en dépend), est à cet égard particulièrement inquiétante.
Elles font également naître des craintes quant aux fonds alimentant les flux concessionnels des institutions multilatérales (IDA, etc.), notamment en raison des positions des représentants républicains aux Etats-Unis. On a assisté à un arrêt des opérations du Fonds africain de développement (FAD), branche concessionnelle de la Banque africaine de développement, pendant deux ans et demi, en raison des difficultés de reconstitution du FAS VII. On a mentionné les doutes des contributeurs quant à l’efficacité de l’institution et à la qualité des projets financés par la Banque africaine de développement, mais les difficultés sont identiques pour la Banque asiatique de développement et pour la Banque interaméricaine de développement. Elles n’ont pas épargné le renouvellement des fonds de FIDA, branche concessionnelle de la Banque mondiale, qui a fait l’objet d’un accord en mars 1996 pour trois ans, portant sur un montant de 22 milliards de dollars, mais dont il est estimé qu’il crée de sérieuses contraintes sur la capacité financière de l’IDA à répondre aux besoins des pays les plus pauvres. Comment, dans ce contexte de restrictions, ne pas poser encore la question de la cohérence et de la qualité de l’aide, donc celle d’une évaluation objective et démocratique, tout en souhaitant que la découverte du qualitatif ne soit pas que l’alibi de la réduction de l’aide ?
Une remarque pour conclure, puisqu’une réunion du G7 sur l’environne ment s’est tenue les 9 et 10 mai à Cabourg et a lancé un « cri d’alarme » : où sont les flux supplémentaires considérables jugés nécessaires au développement durable, identifiés lors de la Conférence de Rio ? Où en est-on donc aujourd’hui ? Les membres de l’AITEC constatent : « En 1982, la course à l’endettement des économies du Sud, croisée avec l’envolée des taux d’intérêts et les politiques monétaristes se traduit par la gigantesque crise de la dette qui va occuper l’ordre du jour des sommets pendant dix ans. Les principes du traitement sont depuis lors constamment réaffirmés : traitement au cas par cas et refus de toute négociation d’ensemble ; refus de toute reconnaissance de coresponsabilité et de toute discussion sur l’illégitimité d’une partie de la dette ; obligation de subordonner toute négociation à l’ajustement structurel au marché mondial ; imposition du rééchelonnement comme seule technique d’allégement des remboursements. Au sommet de 1992, trois innovations sont annoncées en matière de dette. La situation en Russie, et sa dette, fait désormais l’objet d’un traitement prioritaire. La reconnaissance du caractère politique du traitement est officielle ; la Pologne et l’Egypte sont récompensées pour leur engagement militant dans la croisade du marché et dans la guerre du Golfe. Le G7 lance enfin, hypocrisie maximum, un appel pressant à l’ensemble des détenteurs publics de créances, le Club de Paris, c’est-à-dire lui-même, pour rechercher des solutions à la dette du Sud. » Et de conclure : « II faut dire qu’en dix ans, la situation a évolué. Le système monétaire a été consolidé. Une partie des grands pays payent leurs annuités et empruntent ; les autres sont marginalisés. Les créanciers on provisionné, leurs pertes, et le système bancaire, au prix de quelques faillites, n’est plus en danger. La dette ne fait plus peur, on n’en parle presque plus ; le problème est-il pour autant réglé ? En apparence, peut-être, et pourtant. La gestion de la crise de la dette a eu des effets déflationnistes considérables. Les flux financiers vont du Sud vers le Nord ; si l’on y ajoute la baisse des cours et la réduction des recettes d’exportation, on a réduit à néant le financement du développement. La gestion de la crise de la dette est analogue à celle des années 1890 qui s’est traduite par le regain de l’expansion coloniale, et à celle des années vingt qui n’a pas été étrangère à la seconde guerre mondiale ». (3)
(1) Le flux net de ressources (Aggregate net resource flows) ne prend cependant pas en compte les intérêts sur la dette et les profits sur les investissements privés.
(2) 41 pour le FMI, qui inclut le Nigeria.
(3) Gustave Massiah in « Politique La Revue »