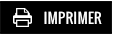Développement urbain, ou ajustement sectoriel des villes ? La politique urbaine de la Banque mondiale - Annik Osmont - 2005
Publié par , le 26 septembre 2005.
Lorsque la Banque mondiale décida d’intervenir sur le développement urbain dans les pays du Sud, ce fut au nom de la lutte contre la pauvreté urbaine, identifiée au début de la décennie 70 comme problème majeur des villes en pleine explosion démographique. L’intention n’était nullement philanthropique, mais s’inscrivait dans une logique de croissance économique : il convenait d’intégrer une population potentiellement productive mais dont les conditions de vie étaient trop précaires et trop misérables pour qu’elle puisse devenir une main-d’œuvre profitable à l’économie. Des populations urbaines mieux logées, vivant dans de meilleures conditions de salubrité, mieux nourries, mieux éduquées, seront plus productives : l’hygiénisme du XIXème siècle n’est pas loin ...Les mesures préconisées ont été de plusieurs ordres : pour atteindre les populations les plus défavorisées, il faut que les Etats cessent de subventionner un habitat dit économique accessible seulement aux classes moyennes et supérieures pour concentrer l’aide publique à un meilleur ajustement de l’offre de logement à la demande solvable des plus défavorisés. Cela est possible, au moins pour 80 % d’entre eux selon la Banque, grâce à une réduction drastique du coût du logement, notamment par une diminution importante des normes d’habitabilité et d’équipement et par une forte incitation à la participation des bénéficiaires à la construction de leur maison, et grâce à un système de recouvrement des coûts qui permette de reproduire les opérations, rendant ainsi les villes plus autosuffisantes et plus productives. Ce faisant, la Banque mondiale remettait en cause la théorie économique du « biais urbain », selon laquelle la ville est réputée dévoreuse d’investissements non productifs et sans effet sur le développement.
Ce premier modèle de développement urbain, venu d’ailleurs et considéré comme universel, ignorant les spécificités sociales et culturelles et les itinéraires singuliers de développement, engendra un modèle opérationnel fait d’opérations d’aménagement foncier, de lotissements sommairement équipés (les « parcelles assainies »), de formules d’auto-construction assistée pour le logement, et d’opérations de réhabilitation de bidonvilles ou d’autres formes d’habitat incontrôlé. La structuration d’activités économiques, notamment « informelles » devait accompagner ces actions, pour en faire des projets dits « intégrés ».
Le résultat de ces opérations menées à partir de 1972, est maigre : pour environ un million d’unités logements ainsi réalisées jusqu’en 1982, le coût de revient a été de 2300 $ en moyenne par logement. L’objectif le plus important, qui était de mettre à la disposition du développement industriel des PED une main-d’œuvre bon marché s’est révélé un échec le plus souvent, puisque l’industrialisation n’a pas accompagné de manière décisive les très forts taux d’urbanisation de l’époque. Faute d’une intégration économique manifeste qui aurait dû aider les bénéficiaires de ces opérations d’habitat à supporter le coût d’amélioration de leurs conditions de vie, on les a vu se tourner de plus en plus vers le secteur informel. On a vu également se déclencher un effet secondaire non prévu, celui d’une spéculation foncière et immobilière au profit de couches urbaines populaires d’un niveau supérieur à celui de la population très défavorisée qui constituait la cible des opérations : les changements de titulaires de parcelles ont vite atteint 40 à 70 % des attributions initiales, grâce à la revente, illégale, de titres. D’autre part, on constate que les pays ayant bénéficié de cette aide au développement n’ont jamais vraiment renoncé à leur propre politique de production d’un habitat subventionné à destination des couches moyennes, notamment pour les fonctionnaires dont les Etats ont le plus grand besoin.
Au total, des résultats plutôt décevants. La Banque mondiale, tirant les leçons de l’expérience, va transférer l’application de sa politique urbaine à des ONG, internationales et locales, et à la coopération bilatérale, par exemple l’Agence française de développement pour les pays francophones d’Afrique. Cela permettra à la Banque de concentrer tout son potentiel de réflexion, de modélisation et d’action, sur le vaste chantier de réformes économiques, institutionnelles, et politiques, qui constitue ce qu’on appelle l’ajustement structurel, mis en place au début des années 80. En fait le désengagement - relatif- de la Banque vis-à-vis de l’aménagement physique des villes, fera place à un engagement renforcé dans la gestion urbaine et les réformes qu’elle nécessite. On ne parlera plus que de restructuration des services techniques et financiers municipaux, de la mise en place de plans comptables et de cadres budgétaires locaux. On ne parlera plus que de la restructuration des systèmes de financement de l’habitat et des organismes publics de construction, de la privatisation des parcs de logements sociaux et, bientôt, de l’ensemble des services urbains. Selon une logique descendante, les mesures prises à l’échelle urbaine seront du même ordre que celle prises au niveau national, au nom de la recherche d’efficacité maximum des investissements et des institutions qui les gèrent. C’est en fonction de cette logique que la Banque va entreprendre l’ajustement sectoriel des villes, qui sera légitimé par les programmes de décentralisation, échelon local de la « bonne gouvemance ». La décentralisation, modèle opérationnel de l’ajustement sectoriel urbain, va être mise en œuvre à peu près partout dans les PED, là encore sans se préoccuper de l’histoire singulière de chaque pays.
Au cours de la décennie 90, la démarche s’est encore consolidée, rigidifiée et vise à couvrir effectivement la totalité du champ économique et social du développement urbain, dans une perspective ultra-libérale. Parce que les villes - surtout les grandes - sont considérées comme « le moteur de la croissance mondiale », et qu’en conséquence, le développement requiert l’urbanisation, le développement intégré des villes revêt une importance prioritaire. A telle enseigne qu’un « traitement plus consistant et plus complet des questions urbaines » doit figurer dans les stratégies d’assistance par pays (CAS : Country assistance stratégies), véritables programmes déclencheurs d’aide et de projet, établis en étroite coordination avec le FMI, et en collaboration avec l’OMC (Organisation mondiale du commerce). En fonction d’une analyse des contributions potentielles du système urbain national à l’économie mondiale, la Banque procède à une sélection des villes auxquelles elle se propose d’apporter son assistance. Il ne s’agit plus de répondre à du mal-développement urbain, il s’agit bien d’une sélection, effectuée en fonction de quatre critères :
• La compétitivité : comment la ville s’adapte dans son ensemble pour mieux attirer les investisseurs étrangers, comment elle est susceptible d’impliquer des partenaires capables de monter des projets de développement, en cohérence avec le cadre macro-économique.
• La qualité de vie : comment la ville peut lutter contre la dégradation de l’environnement, la criminalité et la violence, les désastres naturels. Il faut faire une « coalition internationale » pour améliorer les services urbains. Pour améliorer le sort des pauvres, il s’agit de savoir comment la ville se propose de mobiliser le développement communautaire.
• Bonne gouvemance : cette condition vise l’amélioration des ressources communales et de leur allocation, et implique d’encourager la gestion privée des services urbains.
• « Banquabilité » : les villes doivent faire la démonstration du sérieux de leur gestion financière et de leur capacité à accroître leurs ressources budgétaires, pour que la Banque puisse apporter sa caution aux municipalités soucieuses d’emprunter, même sur les marchés privés. C’es une sorte de « crédito-mérite » qui est ainsi défini par la Banque.
Et parce qu’il faut viser l’efficacité économique maximum, ce sont les grandes métropoles (66 en tout) qui font l’objet d’une priorité dans la sélection.
Le résultat le plus évident d’un tel modèle opérationnel est l’apparition d’un nouveau « biais urbain » véhiculé, cette fois, par la Banque. Si la pauvreté se généralise en ville avec l’apparition de nouveaux pauvres - tous les « défiâtes » de l’ajustement, essentiellement femmes et jeunes citadins, il appartient aux instances locales, qui disposent des instruments rénovés de la gestion urbaine, d’assumer le poids de problèmes sociaux dont 1 origine est externe et de mettre en œuvre des mesures concrètes pour les résoudre. Mais ce biais social urbain ne peut pas masquer très longtemps l’actuelle spirale du mal-développement. Il repousse bien loin, aussi, les perspectives de participation des populations à leur propre développement, sauf à en avoir une conception strictement instrumentalisée dans le carcan des aiustements. Il compromet lourdement les tentatives des organisations de solidarité internationales et nationales de concourir à ce développement. Le recours croissant aux ONG dans les quartiers urbains de relégation ne saurait masquer en effet le caractère irréversible des dégâts entraînés par l’ajustement néo-libéral.
Face à un tel désastre, il n’y a pas d’autre alternative que de déconnecter, résolument, le développement urbain de l’ajustement, et de donner, enfin, une voix au peuple des villes.
Annik OSMONT, Maître de conférences honoraire, Institut français d’urbanisme (Paris 8), AITEC
2005